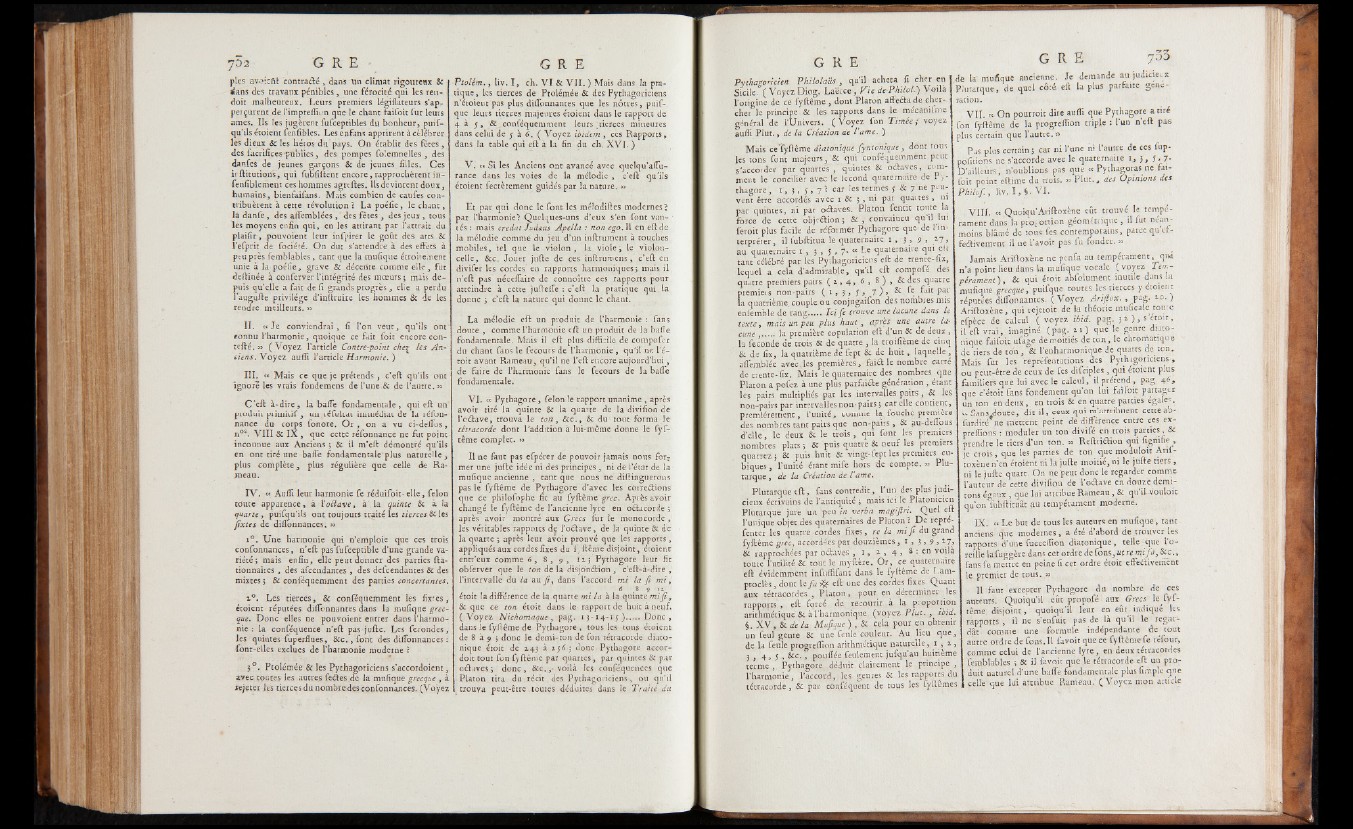
pies avoicfifc contracté, dans un climat rigoureux &
i a ’ns des travaux pénibles, une férocité qui les ren-
doit malheureux. Leurs premiers légiflateurs s’ap-
perçurent de l’impreflion que le chant faifoit fur leurs
âmes. Ils les jugèrent fufceptibles du bonheur, puisqu'ils
étoient fenfibles. Les enfans apprirent à célébrer
les dieux & les héros du pays. On établit des fête s ,
des Sacrifices publics, des pompes folemnelles , des
dan Ses de jeunes garçons & de jeunes filles. Ces
irftitutio.iSs, qui fubfiftent encore, rapprochèrentin-
fenfiblement ces hommes agreftes. llsdevinrent doux,
humains, bienfaiSans. Mais combien de cauSes contribuèrent
à cette révolution? Lapoéf ie, lé ch an t ,
la danSe, des alTemblées , ‘ des fêtes , des jeu x, tous
les moyens enfin qui, en les attirant par l’attrait du
p la ifir, pouvoient leur infpirer le goût des arts &
l’eSprit de Société. On dut s'attendre à des effets à
ptuprès Semblables, tant que la mufique étroitement
unie à la poéfie, grave & décente comme elle , fut
deftinée à conferver l’intégrité des moeurs $ mais depuis
qu’elle a fait de fi grands progrès , elie a perdu
1 augufte privilège d’inftruire les hommes & de les
rendre meilleurs. »
II. ce Je conviendrai, fi l’on veut, qu’ ils onth
connu l’harmonie, quoique ce fait Soit encore con-
tefté. » (V o y e z l’article Contre-point che% les Anciens.
V o y e z auffi l’ article Harmonie. )
III. ce Mais ce que je prétends, c’ eft qu’ils ont
ignoré les vrais fondemens de l’une.& de l’autre.
C ’eft à -dire , la baffe fondamentale, qui eft un'
produit primitif, un réfultat immédiat de la réfon-
nance du corps Sonore. O r , on a vu ci-deffus,
nos. V I I I & I X , que cette réSonnance ne fut point-
inconnue aux Anciens ; & il m’eft démontré qu’ils
en ont tiré une baffe fondamentale'plus naturelle ^
plus complète, plus régulière que celle de Rameau.
IV . ce Audi leur harmonie Se réduiSoit- elle , Selon
toute apparence, à Y octave, à la quinte & à la
quarte, puiSqu’ils ont toujours traité les tierces & les
fixtes de diffonnances. »
i ° . Une harmonie qui n’emploie que ces trois
conSonnances, n’ eft pas fufceptible d’une grande variété
j mais enfin, elle peut donner des parties ftâ-
tionnaires , des aScendantes , des descendantes & des
mixtes j & conSéquemment des parties concertantes.
z ° . Les tierces, & conSéquemment les fixtes ,
étoient réputées diffonnantes dans la mufique grecque.
Donc elles ne pouvoient entrer dans l’harmonie
: la conSéquence n’eft pas jufte. Les Secondes,
les quintes Superflues, & c . , font des diffonnances
font-elles exclues de l’harmonie moderne ?
3°. Ptolémée & les Pythagoriciens s’accordoient,
avec toutes les autres feâies de la mufique grecque , à
rejeter Jes tierces du nombre des conSonnances. (Voyez
Ptolém. y liv. I , ch. VI & V II. ) Mais dans la pratique,
les tierces de Ptolémée & des Pythagoriciens
n’étoient pas plus diffonnantes que les nôtres, puif-
que leurs tierces majeures étoient dans le rapport de
4 à j , & conSéquemment leurs ^tierces mineures
dans celui de 5 à 6. ( Voyez ibidem , ces Rapports,
dans la table qui eft à la fin du ch. XVI. )
V . « Si les Anciens ont avancé avec quelqu’affu-
rance dans les voies de la mélodie , c’eft qu’ils
étoient Secrètement guidés par la nature. »
Et par qui donc le Sont les mélodifles modernes?
par l’harmonie^ Quelques-uns d'eux s’en Sont vantés
: mais credat Jud&us Apella : non ego. 11 en eft de
là mélodie comme du jeu d’un infiniment à touches
mobiles, tel que le violon, la viole', le violoncelle,
&c. Jouer jufte de ces infhumens , .c’eft en
diviSer les cordes en rapports harmoniques j mais.il
n’eft pas néceffaire de connoître ces rapports pour
atteindre à cette jufleffe : c’eft la pratique qui. la
donne j c’eft la nature qui donne le chant.
La mélodie eft un produit de l’harmonie : Sans
doute , comme l’harmonie eft un produit de la bafie.
fondamentale. Mais il eft plus difficile de compoScr
du chant Sans le Secours'de l’harmonie, qu’il ne l’é-
; toit avant Rameau, qu’il ne l’eft encore aujourd’hui,
de faire de l’harmonie Sans le Secours de la baffe
fondamentale.
VI. ce Pythagore, Selon le rapport unanime , après
avoir tiré la quinte & la quarte de la divifion de
l’cCtave, trouva le ton, & c ., & du tout forma le
tétracorde dont l’addition à lui-même donne le SyS-
tême complet. »
Il ne faut pas efpérer de pouvoir jamais nous for?
mer une jufte idée ni des principes, ni de l’état de la
mufique ancienne , tant que nous ne diftinguerôns
pas le fyftême de Pythagore d’avec les corrections
que ce philofophe fit au fyftême grec. Après avoir
changé le fyftême de l’ancienne lyre en oâaeorde ,
■ après avoir montré aux Grecs fur le monocorde,
les véritables rapports de l’oCtave, de la quinte & de
la quarte î après leur avoir prouvé que les rapports,
appliqués aux cordes fixes du f, ftême disjoint, étoient
entr’eux comme é , 8 , 9 , n ; Pythagore leur fit
obferver que le ton de la disjo'nélion, c’eft-à-dire ,
l’intervalle du la au f i , dans l’accord mi la f i mi,
fî 6 8 ÿ u
étoit la différence de la.quarte mi la à la quinte mi f i ,
& que ce ton étoit dans le-rapport de huit à neuf.
(V o y e z Nichomaque, pag. 13 -14-1 ly ......Donc,
dans le fyfiême de Pythagore , tous les tons étoient
de 8 à 9 5 donc le demi-ton de Son tétracorde diatonique
étoit de 143 à 2.56-3 donc Pythagore accor-
doit tout Son fy ftême par quartes, par quintes & par
o&aves3 donc, &c.,- voilà les conféquences que
Platon tira du récit des Pythagoriciens , ou qu’il
; trouva peut-être toutes déduites dans le T r a i t é du
Pythagoricien Philolaüs, qu’il acheta fi cher en
Sicile. ( V o y ez Diog. L a ërce, Vie de'Philol.) V o ilà
l ’origine de ce fyftême, dont Platon affeCta de chercher
le principe & les rapports dans le mécanifme
général de l’Univers. (V o y e z Son Tintée;' voyez
auffi P lu t ., de la Création de Came.')
Mais cefyftême diatonique fy ni dnique , dont tous
les tons Sont majeurs, & qui conSéquemment peut
s’accorder par quartés , quintes & oCtaves, comment
le concilier avec le fécond quaternaire de. P y thagore
, 1 , 3 , 5 » 7 • c^r les termes 5 & 7 ne peuvent
être accordés avec 1 8c 3 , ni par quai t e s , ni
par quintes, ni par oÇtaves. Platon Sentit toute la
force de cette objedion 5 & , convaincu qu il lut
feroit plus facile de réformer Pythagore que de l’interpréter,
il (ubftitua le quaternaire 1 , 3 > 9 > »
au quaternaire 1 , 3 , 5 > 7* cc Le quaternaire qui eft
tant célébré par les Pythagoriciens eft de trente-fix,
lequel a cela d’admirable, qu’il eft compofé des
quatre premiers pairs ( 1 , 4 » 6 » % ) >. & des quatre
premieis non-pairs ( 1 , 3 , 5 y, 7 ) » & fe fait par
la quatrième, couple ou conjugaifon des nombies mis
enfemble de rang......Ici fe trouve une lacune dans le
texte, mais iin peu plus haut , apres une autre lacune
la première copulation eft d’un & de deux ,
la Seconde de trois & de quatre , la troifième de cinq
& de fix, la quatrième.de Sept & de h u it , laquelle,
affemblée avec.les premières, faiét le nombre carre
de trente-fix. Mais le quaternaire des nombres qüe
Platon a pofez à une plus parfaiÇte génération , étant
les pairs multipliés par les intervalles pairs, & les
non-pairs par intervalles non-pairs 5 car elle contient,
premièrement, l’unité, comme la. Souche première
des nombres tant pairs que non-paus , & gu-deflous
d’e lle , le deux & le trois , qui font les premiers
nombres plats 5 & puis quatre & neuf les premiers
quarrez 3 & puis huit & vingt-fept les premiers cubiques
, l’unité étant mife hors "de compte. » Plutarque,
de la Création de Vame.
Plutarque e f t , Sans contredit, P un des plus judicieux
dè la mufique ancienne. Je demande au judicieux
Plutarque, de quel coté eft la plus parfaite génération.
écrivains de l’antiquité 3 mais ici le Platonicien
Plutarque jure un peu in verba magiftri. Quel eft
l ’unique objet.des quaternaires de Platon ? De représenter
les quatre cordes fixes, re la mi f i du grand
V I I . « On pourroit dire auffi que Pythagore a tiré
Son fyftême de la progreffion triple : l’un n’eft pa«
plus certain que l’autre.»
fyftême grec, accordées par douzièmes , 1 , 3 , 9 , 2 . 7 ,
Ht rapprochées par oétaves , 1 , 1. , 4 , 8 : en voila
toute l’utilité & tout le myftère. O r , ce quaternaire
eft évidemment infuffifant dans le fyftême de Lam-
proclès, dont le fia ^ eft une des cordes fixes Quant
aux tétracordes , Platon , pour en déterminer les
rapports , eft forcé de recourir à la proportion
arithmétique"& à l ’harmonique (vo y e z Plut. , ibid.
§ .X V ,8 t d e la Mufique ) , & cela pour en obtenir
un Seul genre & une Seule couleur. Au lieu que,
de la Seule progreffion arithmétique naturelle, 1 , 2.,
3 j 4 , 5 . , & c . , pouffée .Seulement jufqu au huitième
terme , Pythagore déduit clairement le principe ,
l’harmonie., l'accord, les genres & les rapports du
tétracorde, & par cûnféquent de tous les fyflèmes
Pas plus certain j car ni l’anc ni l’autre de ces fup-
poficions ne s’accorde avec le quaternaire 1 , 3, 5 ,7 .
D’ailleurs, n’oublions pas que « Pythagoras ne fai-
foit point eftime du trois. « P lu t ., des Opinions des
P kilo fi. , liv. I , §. V I .
V I I I . « Quoiqu’Ariftoxène eût trouvé le tempérament
dans la proportion géométrique , il fut néanmoins
blâmé de tous-fes contemporains, parcequ’et-
feélivement il ne l’avoit pas Su fonder. »•
Jamais Ariftoxène ne penfa au tempérament, quâ
n’â point lieu dans la mufique vocale ( v o y e z Tempérament
) , & qui éroit abfolument inutile dans la
mufique grecque y puifque toutes les tierces y étoient
réputées diffonnantes. (V o y e z Ariftox. , pag. 1 9 .)
Ariftoxène, qui rejetoit de la théorie muficalc route
efpèce de calcul ( vo y e z ibid. pag. s ’étoit,
il eft v rai, imaginé (p ag . i l ) que le genre diatonique
faifoit ufage de moitiés de ton , le chromatique
de tiers de to n , & l’enharmonique de quarrs de ton.
Mais Sur les représentations des Pythagoriciens,
ou peut-être de ceux de Ses difciples , qui étoient plus
familiers que lui avec le calcul, il prétend , pag. 46,
que c’étoit fans fondement qu’on lui faifoit partager
un ton en deux, en trois & en quatre parties égales,
te Sans.doute, dit- il, ceux qui m’attribuent cetteab-
furdité ne mettent point de différence entre ces ex-
preffions : moduler un ton divifé en trois parties &
prendre le tiers d’un ton. » Reftri&ion qui figriifie ,
je cro is, que les parties de ton que moduloit A r iftoxène
n’en étoient ni la jufte moitié, ni le jufte tiers ,
ni le jufte quart. On ne peut donc le regarder comme
l’auteur de cette divifion de 1 oétave en douze demi-
tons é<*aux , que lui attribue Rameau, & qu’il vouloit
i qu’on Subftituât au tempérament moderne.
IX. « Le but de tous les auteurs en mufique, tant
anciens que modernes, a été d’abord de trouver les
rapports d’ une fucceffion diatonique, telle que l’oreille
la Suggère dans cet ordre de Sons, ut re mi fia, & c „
Sans Se, mettre en peine fi cet ordre étoit effectivement
le.premier de tous. » ,
11 faut excepter Pythagore du nombre de ce$
auteurs. Quoiqu’il eût propofé aux Grecs le f y f tême
disjoint, quoiqu’il leur en eût indiqué les
rapports , il ne s’enfuit pas de là qu’il le regardât
comme une formule indépendante d e tout
autre ordre de Sons. Il Savoir que ce fyftême fe téfour,
comme celui de l’ancienne ly re , en deux tétracordes
Semblables ; & il fiivoit que le tétracorde eft un pro-
| duit naturel d’une baffe fondamentale plus fimplc que
j celle que lui attribue Rameau. (V o y e z mon article