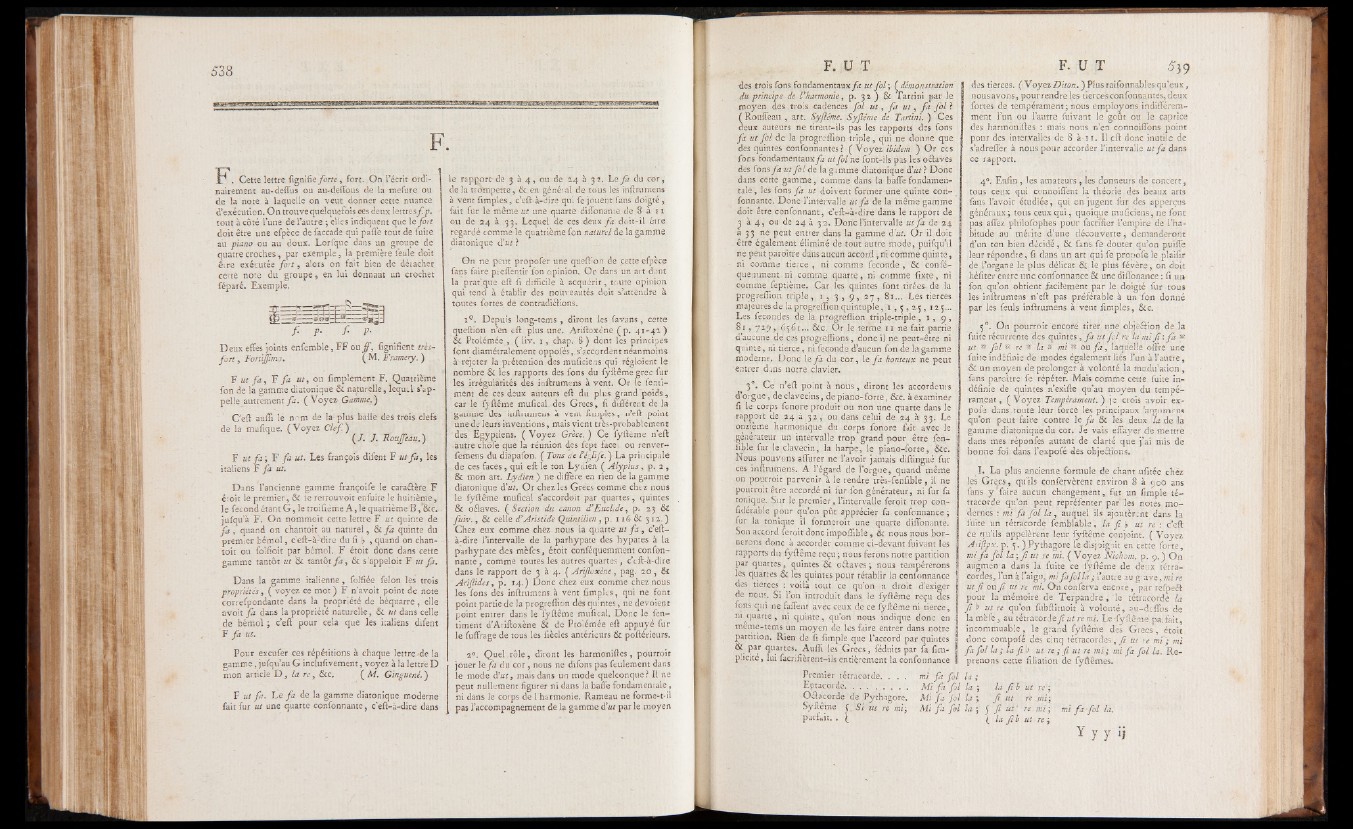
F.
P * . Cette lettre lignifieforte, fort. On l’écrit ordinairement
au-deffus ou au-deffous de la mefure ou
de la note à laquelle on veut donner cette nuance
d’exécution. O n trouve quelquefois ees deux lettres ƒ p.
tout à côté l’une de l’autre ; elles indiquent que le fort
doit être une efpèce de faccade qui paffe tout de fuite
au piano ou au doux. Lorfque dans un groupe de
quatre croches, par exemple, la première feule doit
être exécutée fo r t, alors on fait bien de détacher
cette note du g roupe, en lui donnant un crochet
féparé. Exemple.
f- p ■ f p ■
D eu x effes joints enfemble, FF ou j f , lignifient r r à -
fo r t, FortiJJimo. (M . Framery.)
F ut f a , F fa ut, ou Amplement F. Quatrième
fon de la gamme diatonique & naturelle, lequel s’appelle
autrement fa . ( Voyez- Gamme. )
C ’eft aulli lè n^m de la-plus baffe des trois clefs
de la mufique. .(V o y e z C le f )
( ƒ . J. Rouffeàu.)
¥ ut fa ; F fa ut. Les françois difent F ut fa , les
italiens F fa ut.
D an s l’ancienne gamme françoïfe le caraâèfe F
écoit le premier, & le rerrouvoit enfuite le huitième,
le fécond étant G , le troifième A , le quatrième B , &c.
jufqu’à F . O n nommoit cette lettre F ut quinte de
fa. , quand on chantoit au naturel, & fa quinte du
premier b ém o l, c’eft-à-dire du fi , quand on chantoit
ou folfioit par bémol. F étoit donc dans cette
gamme tantôt ut & tantôt fa , & s’appeloit F ut fa.
Dans la gamme italienne, fol'fiée félon les trois
propriétés, ( voyez ce mot ) F n’avoit point de note
correfpondante dans la propriété de béquarre, elle
avoit fa dans la propriété naturelle j & ut dans celle
de bémol ; c’eft pour cela que les italiens difent
F fa ut.
Pour exeufer ces répétitions à chaque lettre/de la
gamme, jufqu’au G inclufivement, v o y e z à la lettre D
mon article D , la re, & c . ( M. Ginguené. )
F ut fa. L e fa de la gamme diatonique moderne
fait fur ut une quarte confonnante, c ’eft-à-dire dans
le rapport de 3 à 4 , ou de 2.4 à 32. L e fa du co r ,
de la trompette, & en général de tous lés inftrumens
à vent Amples, c’eft-à-dire qui fe jouent fans doigté,
fait fur le même«* une quarte diffonante d e ,8 à 11
o.u de 24 à 33. Lequel de ces deux fa doit-il être
regardé comme le quatrième fon naturel de la gamme
diatonique d’«/ ?
0 n ne peut propofer une queft’on de cette efpèce
fans faire preffentir fon opinion. O r dans un art dont
la pratique eft fi difficile à acquérir, toute opinion
qui tend à établir des nouveautés doit s’attendre à
toutes fortes de contradi&ions.
i Q. Depuis long-tems , diront les fa v an s , cette
queftion n’en eft plus une. Ariftoxène ( p . 4 1 - 4 2 )
& Ptolémée , ( liv. 1 , chap. 8 ) dont les principes
font diamétralement oppofés,. s’accordent néanmoins
à rejeter la prétention des müficiens qui régloi'ent le
nombre & les rapports des fons du fyftême grec fur
les irrégularités des inftrumens à vent. O r le fenti-
ment de ces deux auteurs eft du plus grand poids,
car le fyftême muficaFaes Gre cs, fi différent de la
gamme des inftrumens à vent Amples, n’eft point
une de leurs inventions, mais vient très-probablement
des Egyptiens. ( V o y e z Grèce.) Ce fyftême n’eft
àutre chofe que la réunion des fept face, ou renver-
femens du diapafon. ( Tons de l’églife. ) La principale
de ces fa ce s , qui eft le ton Lydien ( Alypius, p. 2 ,
& mon art. Lydien ) ne diffère en rien de la gamme
diatonique d'ut. O r chez les Grecs comme chez nous
le fyftême mufical s’accordoit par quartes, quintes
& oâaves. ( Section du canon d’Euclïde, p. 23 &
| fuiv. , & celle d'Aristide Quintilien ,p . 1 16 & 312. )
| Chez eux comme chez nous la quarte ut f a , c’eft-
à;dire l’intervalle de la parhypate des hypates à la
parhypate des mèfes, étoit conféquemment confonn
an te, comme toutes les autres quartes, c’eft-à-dire
dans le rapport de 3 à 4. ( Arifloxène, pag. 2 0 , &
Ariflides, p. 14 .) Donc chez eux comme chez nous
les fons des inftrumens à vent Amples, qui ne font
point partie de la progreffion des quintes, ne dévoient
point entrer dans le fyftême mufical. Donc le fen-
timent d’Ariftoxène & de Ptoiémée eft appuyé fur
le fuffrage de tous les fiècles antérieurs & poftérieurs.
20. Q u e l,r ô le , diront les harmoniftes, pourroit
jouer le fa d u c o r , nous ne difons pas feulement dans
le mode d'ut, mais dans un mode quelconque? Il ne
peut nullement figurer ni dans la baffe fondamentale,
ni dans le corps de 1 harmonie. Rameau ne forme-t-il
pas l’accompagnement de la gamme d’ut par le moyen
des trois fons.fondamentaux fa ut fol; ( démonstration
du principe de Tharmonie, p. 32 ) & Tartini par le
moyen des trois cadences fo l u t , fa u t , fa fo l ?
( Rouffeau , art. Syjlême. Syflême de Tartini. ) Ces
deux auteurs ne tirent-ils pas les rapports des fons
fa ut fo l de la progreffion triple, qui ne donne que
des quintes confonnantes ? ( V o y e z ibidem. ) O r ces
fons fondamentaux fa ut fol ne font-ils pas les o&aves
des fons fa ut fol de la gamme diatonique d’ut ? Donc
dans cette gamme, comme dans la baffe fondamenta
le , les fons fa ut doivent former une quinte confonnante.
Donc l’intervalle ut fa de la même gamme
doit être confonnant, c’eft-à-dire dans le rapport de
3 à 4 , ou de 24 à 3 2. Donc l’intervalle ut fa de 24
a 33 ne peut entrer dans la gamme d'ut. O r il doit
être également éliminé de tout autre mode, puifqu’il
ne peut paroître dans aucun accord, ni comme quinte,
ni comme tierce , ni comme fécondé , & conféquemment
ni comme quarte, ni comme fix te , ni
comme feptième. Car les quintes font tirées-de la
progreffion triple ,, 1 , 3 , 9 , 2 7 , 81... Les tierces
majeures de la progreffion quintuple , 1 , 5 , 2 3 , 12 5...
Les feçondes de la progreffion triple-triple, 1 , 9 ,
81 , 729 ,; 6 561... & c . O r le terme 1 1 ne fait partie
d’aucune de ces progreffions, donc il ne peut-être ni
quinte, ni tierce,, ni féconds d’aucun fon rie la gamme
moderne. Donc le fa du c o r , le fa honteux ne peut
entrer dans notre clavier.
30. C e n’eft point à n ou s, diront les accordeurs
d’o rgu e , de clavecins, de p iano-forte, & c . à examiner
fi le corps fonore produit ou non une quarte dans le
rapport de 24 à 3 2 , ou dans celui de 24 à 33. Le ,
onzième harmonique du corps fonore fait avec le 1
.générateur un intervalle trop grand pour être fen-
lible fur le clavecin, la harpe, le piano-forte, & c .
Nous pouvons affiner ne l’avoir jamais diftingué fur
ces inftrumens. A l’égard de l’orgue, quand même
on pourroit parvenir à le rendre très-fenfible, il ne
pourroit être accordé ni fur fon générateur, ni fur fa
tonique. Sur le premier, l’intervalle feroit trop con-
fiderable pour qu’on pût apprécier fa confonnance ;
fur la tonique il formeroit une quarte diffonante.
Son accord feroit donc impoffible , & nous nous bornerons
donc à accorder comme ci-devant fuivant les g
rapports du fyftême reçu ; nous ferons notre partition 8
par quartes, quintes & o& av es ; nous tempérerons 8
les quartes & les quintes pour rétablir la confonnance f
des tierces : voilà tout ce qu’on a droit d’exiger |
de nous;. Si l’on introduit dans le fyftême reçu des |
fons qui ne faffent avec ceux de ce fyftême ni tierce, |
ni cp a rte , ni quinte, qu’on nous indique donc en J
meme-tems un moyen de les faire entrer dans notre 8
partition. Rien de fi fimple que l’accord par quintes J
& par quartes. Au ffi les G re c s , féduits par fa fim- I
pîicite, lui facrifièrent-ils entièrement la Confonnance 8
Premier tétracorde. . . . mi fa fol
Eptacorde. . . . . . . . . Mi fa fol
Oâ acord e de Pythagore. Mi fa fol
Syftême C Si ut rç mi; Mi fa fel
parfait. . (
des tierces. ( V o y e z Diton. ) Plus raifonnables qu’eu x ,
nous avons, pour rendre les tierces confonnantes, deux
fortes de tempérament; nous employons indifféremment
l’un ou l’autre fuivant le goût ou le caprice
des harmoniftes : mais nous n’en connoiffons point
pour des intervalles de 8 à 1 1 . Il eft donc inutile de
1 s’adreffer à nous pour accorder l’intervalle ut fa dans
ce rapport.
40. E nfin, les amateurs, les donneurs de concert,
tous ceux qui connoiffent la théorie ,des beaux arts
fans l’avoir étudiée, qui en jugent fur des apperçus
généraux ; tous ceux q u i, quoique müficiens, ne font
pas affez philofophes pour facrifier l’empire de l’habitude
au mérite d'une dé cou ve rte, demanderont
d’un ton bien décidé, & fans fe douter qu’on puiffe
leur répondre, fi dans un art qui fe propofele plaifir
de l’organe le plus délicat & le plus févère, on doit
héfiter entre une confonnance & une diffonance : fi un
fon qu’on obtient facilement par le doigté fur tous
les inftrumens n’eft pas préférable à un fon donné
par les feuls inftrumens à vent Amples, & c .
50. On pourroit encore tirer une obje&ion de la
fuite récurrente des quintes, fa ut foire la mi fi\ fa x
ut x fo l x re x la » mi x ou f a , laquelle offre une
fuite indéfinie de modes également liés l’un à l’autre,
& un moyen de prolonger à volonté la modu’ation ,
fans paroître fe répéter. Mais comme cette fuite indéfinie
de quintes n’exifte qu’au moyen du tempérament
, ( V o y e z Tempérament. ) j e crois avoir ex-
pofè dans.toute leur force les principaux,'argumens
qu’on peut faire contre le fa & les .deux la de la
gamme diatonique du cor. Je vais effàyer de mettre
dans mes réponfes autant de clarté que j’ai mis de
bonne foi dans l’expofé des ôbjeâions.
I. La plus ancienne formule de chant ufitée chez
les G re c s , qu’ils çonfervèrent environ 8 à 900 ans
fans y faire aucun changement, fut un fimple tétracorde
qu’on peut repréfenter par' les notes modernes':
mi fa fo l la , auquel ils ajoutèrent dans la
fuite un tétracorde femblable, la fi\y ut re : c’eft
ce qu’ils appelèrent leur fyftême conjoint. ( Voyez
Aiiffox. p. 5. )_Pythagore le disjoignit en cette forte,
mi f a fo l la; f u t re mi. .( V o y e z Nichom. p. 9. ) O n
augmen a dans la fuite ce fyftême de deux tétra-
cordes, l’un à l’aigu, mi fa fo lia ; l’autre au grave, mi re
Ut f i ou f i ut re mi. On conferva encore, par refpeéfc
pour la mémoire de Terpandre , le tétracorde la
fi\> ut re qu’on fubftituoit à v o lo n té , au-deffus de
la mèfë, au tétracorde f i ut re mi. Le fyftême pa: fait,
incommuable, le grand fyftême des G re c s , étoit
donc compofé des cinq téfracordes, f î ut re mî; mi
fa fo l la ; Ici f i i> ut re ; f i ut re mi; mi fa fo l la. R eprenons
cette filiation de fyftêmes.
la ;
la ; la f i b ut re';
la ; f i ut re jrii ;
la ; ( f i u t * re. mi; mi f a ‘f o l la.
\ la f i b ut re ;
Y y y ij