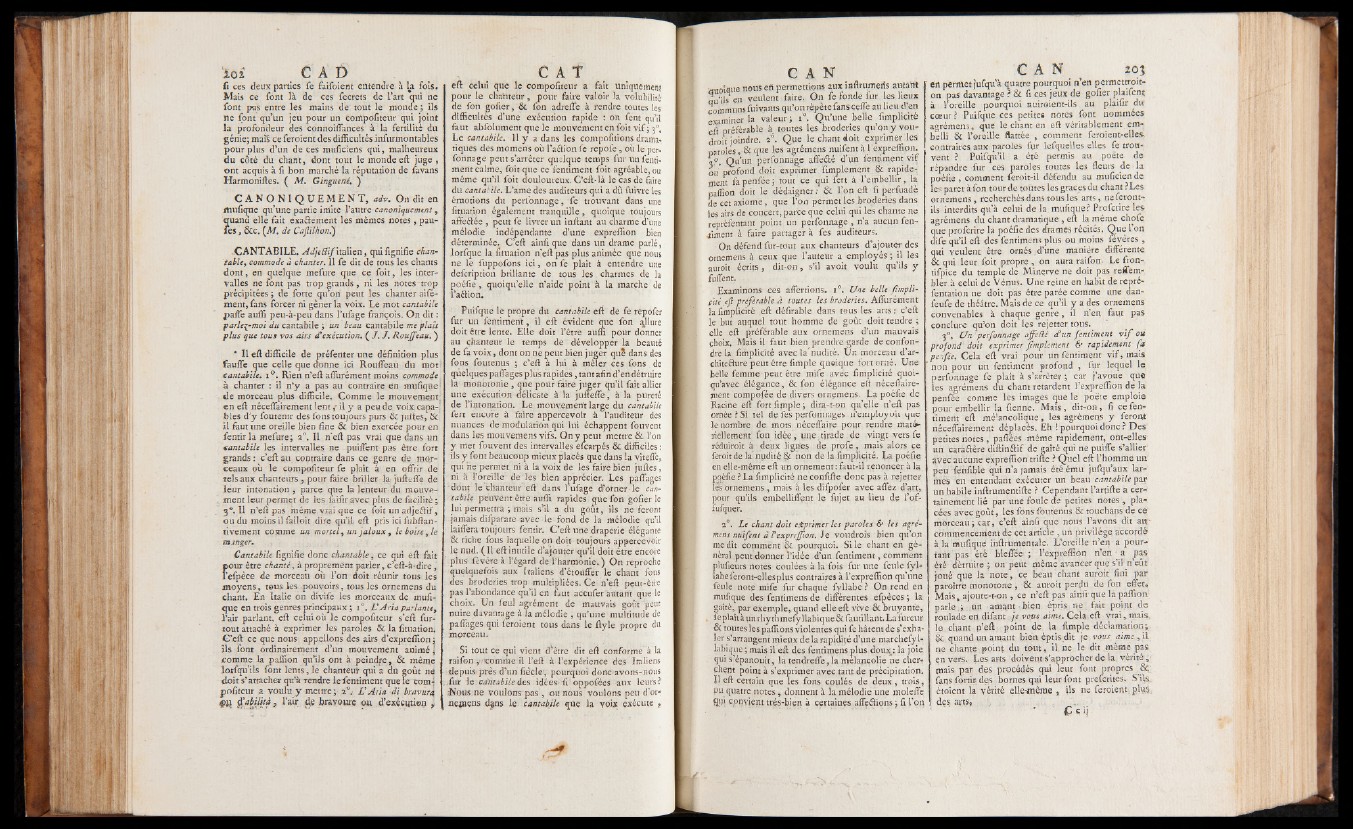
l o i C A D
fi ces deux parties fe faifoient entendre a l%a fois.
Mais ce font là de ces fecrets de l’art qui ne
font pas entre les mains de tout le monde ; ils
ne font qu’ün jeu pour un compofiteür qui joint
la profondeur des cbnnoiffances à la fertilité du
génie; maîl ce feroient des difficultés infurmontables
pour plus d’un de tes muficiens qui, malheureux
du côté du chant, dont tout le monde eft juge ,
ont acquis à fi bon marché la réputation de favans
Harmonises. ( M. Ginguené. )
C A N O N I Q U E M E N T , adv. On dit en
mufique qu’une partie imite l’autre canoniquement,
quand elle fait exa&ement les mêmes notes, pailles
, &C. (Àf. de Caflilkon.j
-CANTABILE. Adje&if italien, quifignifie chantable,
commode à chanter. Il fe dit de tous les chants
dont, en quelque mefure que ce foit, les intervalles
ne font pas trop grands , ni les notes-trop
précipitées ; de forte qu on peut les chanter aifé-
ment, fans forcer ni gêner la voix. Le mot cantabile
j>afte auffi peu-à-peu dans l’ufage frariçôis. On dit :
parlez-moi du cantabile ; un beau cantabile me plaît
plus que tous vos airs £ exécution. ( J. J. Roujfcau. j
* Il eft difficile de préfenter une définition plus
fauffe que celle que donne ici Rouffeaü du moti
cantabile. i ° . Rien n’eft aflùrément moins commode.
à chanter : il n’y a pas au contraire en mufique S
de morceau plus difficile. Comme le mouvement'
en eft néceffairement lent,' il y a peu de voix, capa-l
blés d’y foütenir des fons toujours purs & juftes, &
il faut une oreille bien fine & bien exercée pour en
fentir la mefure ; a°. Il n'eft pas vrai que dans un
cantabile les intervalles ne puiffent pas être fort
grands: c’eftau contraire dans ce genre de morceaux
où le compofiteür fe plaît à en offrir de
tels aux chanteurs , pour faire briller la jufteffe de,
lëur intonation , parce que la lenteur du mouvement
leur permet de les faifir avec plus de facilité ;
3®. Il n’eft pas même, vrai que ce loit un ad je â if,
ou du moins il failoit dire qu’il eft pris ici fubftan-
tivement comme un mortel^ un jaloux, le boire , le
manger.
Cantabile fignifié donc chantable, ce qui eft fait
pour être chanté, à proprement parler, c’eft-à-dire,
l’efpëce de morceau où l ’on doit réunir tous les
moyens, tous les pouvoirs, tous les ornemens du
chant. En Italie on divife les morceaux de mufi-
que en trois genres principaux; i° . L'Aria parlante,
l ’air parlant, eft celui où le compofiteür s’eft fur-
tout attaché à exprimer les paroles & la fituatiom
C ’efi: ce que nous appelions des airs d’expreffion :
ils font ordinairement d’un mouvement animé ]
comme la paffion qu’ils ont à peindre , & même ,
lorfqu’ils font lents, le chanteur qui a du goût ne
doit s’ attacher qu’à rendre le fentiment que le com4
pofiteur a voulu y mettre ; a0.- V Aria di bravura
#ii habilita ? l ’air de bravoure ou d’exécution )
C A T
efl celui que le compofiteür a fait uniquement
pour le chahteùr, pour faire valoir la volubilité
de fon gofier, & fon adreffe à rendre toutes les
difficultés d’une exécution rapide : on fent qu’il
faut abfolument que le mouvement en foit vif ; 30,
Le cantabile. 11 y a dans les compofitions draina»
tiques des momens où l’a&ibn fe repofe, où le per-
fonnage peut s’arrêter quelque temps fur un fenti-
ment calme, foit que ce fentiment foit agréable, ou
même qu’il foit douloureux. C ’eft-là le cas de faire
du cantabile. L ’ame des auditeurs qui a dû fuivre les
émotions du perlonnage, fe trouvant dans une
fituaffon également tranquille, quoique toujours
affeélee , peut fe livrer un inftant au charme d’une
mélodie indépendante d’une expreffion bien
déterminée. C ’eft ainfi que dans un drame parlé,
lorfque la fituation n’eft pas plus animée que nous
ne le fuppofons ic i , on fe plaît à entendre une
defcription brillante de tous les charmes de la
poéfie, quoiqu’elle n’aide point à la marche de
l’a&ion.
Puifqüe lê propre du cantabile eft de fe rèpofer
fur un fèntiment, il eft évident que fon pliure
doit être lente. Elle doit l’être aum pour donner
au chanteur le temps de développer la beauté
de fa vo ix , dont on ne peut bien juger qu? dans des
fons foutenus ; c’eft à lui à mêler ces fons de
quelques paftages plus rapides, tant afin d’en détruire
la monotonie , que pour faire juger qu’il fait allier
une exécution délicate à la jufteffe, à la pureté
de l ’intonation. Le mouvement large du cantabile
fert encore à faire appercèvoir à l’auditeur des
nuances de modulation qui lui échappent fouvent
dans les mouvemens vifs. On y peut mettre & l’on
y met fouvent des intervalles efearpés & difficiles :
ils y font beaucoup mieux placés que dans la vîteffe,
qui ne permet, ni à la voix de les faire bien juftes,
ni à l’oreille de'les bien apprécier. Les paftages
dont le chanteur eft dans l’ufage d’orner le cantabile
peuvent être àuffi rapides\ que fon gofier le
lui permettra ; mais s’il a du goût, ils ne feront
jamais difparate avec le fond de la mélodie qu’il
laiflera toujours fentir. C ’eft une draperie élégante
& riche fous laquelle ou doit toujours appercevbir
le nud. ( I l eft inutile d’ajouter'qu’il doit être encore
plus févère à l’égard de l’harmonie. ) On reproche
quelquefois aux Italiens d’étoûffér le chant fous
des broderies trop multipliées. Ce n’eft peut-être
pas l’abondance qu’il en faut accufer alitant que le
choix. Un feu-1 agrément de mauvais goût "peut
nuire davantage à Ta mélodie , qu’une multitude de
paftages qui feroient tous dans le ftyle propre du
mprceau.
Si tout ce qui vient d'être dit eft conforme à la
raifon yrcomiiae il Feft à l’expérience des Italiens
depuis; près d’un fièçle!, pourquoi donc avons-nous
.fur caiitabile des idées» fi: oppofées aux leurs?
.Nous ne voulons pas , ou nous voulons peu d’or-
nejnens d p s le cantabile que la voix exécute *
/moîque nous permettions aux mflrumeiis autant
qu’ils en veulent faire. On fe fonde fur les lieux
communs fuivants qu’on répète fans ççffe au lieu d’en
examiner la valeur ; i°. Q u ’une belle fimplicité
eft préférable à toutes les broderies qu’on y vou-
droft joindre. 2*. Que le chant doit exprimer les
paroles ,& que les agrémens nuifent à l ’expreffion.
V . Qu’un perfonnage affe&é d’un fentiment vif
ou profond doit exprimer Amplement & rapide-;
meut fa penfée ; tout ce qui fert à -l’embellir, la
paffion doit le dédaigner : & l’on eft fi perfuadé
de cet axiome, que l’on permet les broderies dans
les airs de conçert, parce que celui qui les chante ne
repréfentant point un perfonnage , n’a aucun fen~
piment à faire partager à fes auditeurs.
On défend fur-tout aux chanteurs d’ajouter des
ornemens à ceux que l’auteur a employés ; il les
anroit écrits, dit-on, s’il avoit voulu qu’ils y
fiiflent.
Examinons ces aflertions. i° . Une belle fîmpli-
çité efl préférable à toutes les broderies. Afliirément
la fimplicité eft défirable dans tous les arts : c’eft
le but auquel tout homme de goût doit tendre ;
elle eft préférable aux ornemens d’un mauvais
çhoix. Mais il faut bien prendre garde de confondre
la fimplicité avec la nudité. Un morceau d’ar-
chîteâure peut être fimple quoique fort orné. Une
belle femme peut être mife avec fimplicité quoi-
qu’avec élégance , & fon élégance eft néceflaire-
jnent compofée de divers ornemens. La poéfie de
Racine eft fort fimple ; dira-t-on qu’elle n’eft pas
ornée ? Si tel de fes perfonnages n’employoit que
le nombre de mots néceflaire pour rendre matériellement
fon idée, une.tirade de vingt vers fe
réduiroit à deux lignes de profe, mais alors ce
feroitde la njjdité non de la fimplîcjté. La poéfie
en elle-même eft un ornement : faut-il renoncer à la
pqéfie ? La fimplicité ne confifte donc pas à rejetter
les ornemens , mais à lés difpofer avec aflez d’art,
pour qu’ils einbelliffent le fujet au lieu de i’of- '
lufquer.
a0. Le chant doit exprimer les paroles & les agrémens
ntiifent à Vexpreffion. Je voudrois bien qu’on
médît comment & pourquoi. Si le chant en général
.peut donner l ’idée d’un fentiment, comment
plufieurs notes coulées à la fois fur une feule fyl*
labe feront-elles plus contraires à l’expreffion qu’une
feule note mife fur chaque fyllabe ? On rend en
mufique des fentimens de différentes efpèces ; la
gaîté, par exemple, quand elle eft vive & bruyante,
. fe plaît à un rhy thmefy llabique & fautillànt. La fureur
& toutes les paffions violentes qui fe hâtent de s’exhaler
s’arrangent mieïix de la rapidité d’une marchefy 1-
labique ; mais il eft des fentimens plus doux.: la joie
qui s?épanouit, la tendreffe, la mélancolie ne cher-?
client point à s’exprimer avec tant de précipitation.
Ï1 eft certain que les fons copiés de deux, trois,
pu quatre notes, donnent à ia mélodie une molefle
cpnyjent très-bien à certaines affections ; fi l’on
en permet jufqu'à quatre pourquoi n’en permettroir-
on pas davantage ? & fi ces jeux de gofier plaifent
à l’oreille pourquoi nuiroient-ils au plaifir du
coeur ? Puifque ces petites notes font nommées
agrémens , que le chant en eft véritablement embelli
& l’oreille flattée , comment feroient-elles
contraires aux paroles fur lefquelles elles fe trouvent
? Puifqu’U a été permis au poëte de
répandre fur ces paroles toutes les fleurs de la
poéfie , comment feroit-il défendu au muficien de
les parer à fon tour de toutes les grâces du chant ? Les
ornemens , recherchés dans tous les arts, ne feront-
ils interdits qu’à celui de la mufique? Profcrire les
agrémens c!u chant dramatique , eft la même chofe
que profcrire la poéfie des drames récités. Que l’on
dife qu’il eft des fentimens plus ou moins févères ,
qui veulent être ornés . d’une manière différente;
oc qui leur, ipit propre , on aura raifon. Le fron-
tifpice du temple de Minerve ne doit pas reffem-
bler.à celui de Vénus. Une reine en habit de repré-
fentation ne doit pas être parée comme une dan-
feufe de théâtre. Mais de ce qu’il y a des ornemens
convenables à chaque genre, il n’en faut pas
conclure qu’on doit les rejetter tous.
30, Un perfonnage ajfefîè d'un fentiment v i f ou
profond' doit exprimer fimplcment & rapidement fa
penfée. Cela eft vrai pour un fentiment v i f , mais
non pour un fentiment profond , fur lequel le
perfonnage fe plaît à s’arrêter ; car j’avoue quç
les agrémens du chant retardent l’expreffion de la
penfée comme les images que le poëte emploie
pour embellir la fienrie. Mais , dit-on, fi ce fen-
timent eft mélancolique , les agrémens y feront
néceffairement déplacés. Eh ! pourquoi donc ? Des
petites notes, paflees même rapidement, ont-elles
un caractère diftinftif de gaîté qui ne puiffe s’allier
avec aucune expreffion'trifte ? Quel eft l’homme un
peu fehfible qui n’a jamais été ému jufqu’aux lar-
îirés en entendant exécuter un beau cantabile par
un habile inftrumentifte ? Cependant l’artifte a certainement
lié par unè foule de petites notes , placées
avec goût, les fons foutenus & touchans de ce
morceau; car, ç’eft ainfi que nous l’avons dit an
commencement de çet article ,yn privilège, accordé
à la mufique ihftriimentale. L’oreille n’en a pourtant
pas été bleffée ; l’expreffion n’en a pas
été détruite ; on peut même avancer que s’il n’eut
joüé que la note, çe beau chant auro.it fini par
paroître monotone , & auroit perdu de fon effet.
Mais* ajoute-t-on , ce n’eft pas aiiifrque la paffion
p a r l e ;un am^nt ■ bien épris, nel ftût point de
roulade ert difant je vous aime. Cela.eft vrai, mais,
le chant p’eft point de la fimple déclamation;
I & quand un amant bien épris dit je , vous aime , il
ne chante poinç du tout, i f ne le dit même pas
envers. Les arts doivents’gpprOcher de la, vérité ,•
mais par des procédés qui leur font propres 8c
fans fortir des bornes qui leur font preferites» S’ils.
| étoient la vérité elle-même , ils ne feroient, plv$,
des arts?
€ C ij