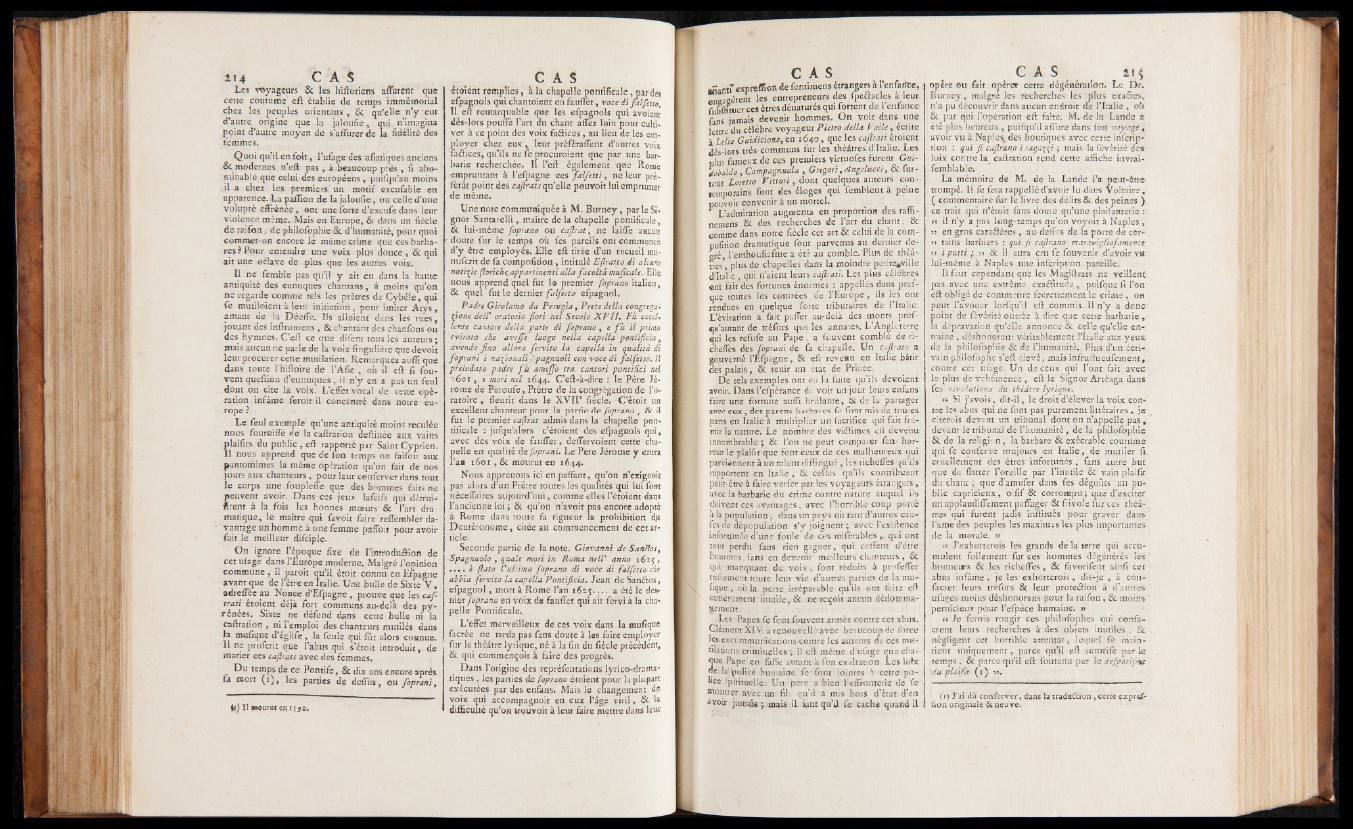
i \ 4 C A S
Les voyageurs & les hiftoriens affurent que
cette coutume eft établie de temps immémorial
chez les peuples orientaux, 6c qu’elle n’y 'eut
d’autre origine que la jaloufie, qui n’imagina
pçint d’autre moyen de s’affurer de la fidélité des
femmes.
Quoi qu’il en fo it, l’ufage des afiatiques anciens
.& modernes n’eft pas , à. beaucoup près , fi abominable
que celui des européens , puifqu’au moins
il a chez les premiers un motif excufable en
apparence. La paflion de la jaloufie, ou celle d’une
volupté effrénée, ont une forte d’excufe dans leur
violence même. Mais en Europe, & dans un fiécle
de raifon, de philofophie & d’humanité, pour quoi
commet-on encore le même crime que ces barbares
} Pour entendre une voix plus douce , & qui
ait une oâave de plus que les autres voix.
Il ne femble pas qu’il y ait eu dans la haute
antiquité des eunuques chamans, à moins qu’on
ne regarde comme tels les prêtres de Cybè le , qui
fe mutiloient à leur initiation , pour imiter A ty s ,
amant de la Déeffe. Us alloient dans les rues,
jouant des inftrumens , & chantant des chanfons ou
des hymnes. C ’eft ce que difent tous les auteurs ;
mais aucun ne parle de la voix fingulière que devoit
leur procurer cette mutilation. Remarquez aufli que
dans toute l'hiftoire de l’Afie ,. où il eft fi fou-
vent queftion d’eunuques, il n’y en a pas un feul
dont on cite la voix. L’effet vocal de cette opération
infâme ferait il concentré dans notre eu-
rope ?
Le feul exemple qu’une antiquité moins reculée
nous foumifle de la caftration deftinée aux vains
plaifirs du public, eft rapporté par Saint Cyprien.
I l nous apprend que de fon temps on faifoir aux
pantomimes la même opération qu’on fait de nos
jours aux chanteurs , pour leur conferver dans tout
le corps une foupleue que des hommes faits ne
peuvent avoir. Dans'-ces jeux lafcifs qui'détrui-
nrent à la fois les bonnes moeurs & Part dramatique,
le maître qui favoit faire refTembler davantage
un homme à une femme paffoit pour avoir
fait le meilleur difciple.
On ignore l’époque fixe de l’introduétion de
cet ufage dans l’Europe moderne. Malgré i ’opinion
commune , il parait qu’il étoit connu en Efpagne
avant (jue de l’être en Italie. Une bulle de Sixte V ,
adreffée au Nonce d’Efpagne , prouve que les caf-
trati étoient déjà fort communs au-dela des py-
rénées. Sixte ne défend dans cette bulle ni la
caftration , ai l ’emploi des chanteurs mutilés dans
la mufique d’êglife, la feule qui fut alors connue.
11 ne proferit que l’abus qui s’étoit introduit, de
marier ces cafirats avec des femmes.
Du temps de ce Pontife, 8c dix ans encore après
fa mort ( i ) , les parties dç deflùs, ou foprani y
fe) Il *»ouru{ en 15
C A S
étoiént remplies, à la chapelle pontificale, par des
efpagnols qui chantoient en fauffet, voce di falfetto.
Il eft remarquable que les efpagnols qui avaient
dès-lors pouffé l’art du chant allez loin pour cultiver
à ce point des voix fa&ices, au lieu de les employer
chez eux , leur préféraffent d’autres voix
factices, qu’ils ne fe procuraient que par une barbarie
recherchée. Il l’eft également que Rome
empruntant à l ’efpagne ces falfetti, ne leur préférât
point des cajlracs qu’elle pouvoit lui emprunter
de même.
Une note communiquée à M. Burney, par le St-
gnor Santarelli, maître de la chapelle pontificale,
8c lui-même foprano ou caflrat, ne laiffe aucun
doute fur le temps où fes pareils ont commencé
d’y être employés. Elle eft tirée d’un recueil ma-
nufcrit de fa çompofition , intitulé Eflratto di alcurie
notifie (loriche, appartinenti alla fxcoltà mufle ale. Elle
nous apprend quel fut 1® premier foprano italien,
& quel fut le dernier falfetto efpagnol.
Paire Girolamo da Perugia, Prete délia congre ga-
fione de II* oratorio fiori nel Secolo X V IL Fii e ccd-
lente cantore délia parte di foprano, e fît il primo
evirato che aveffe luogo nella capella pontificia t
avendo fino allora fervito la capella in qualità di
foprani i nafionali Spagnuoli con voce di falfetto. Il
p'relodato padre f u ameffo tra canton pontifici nel
' '6 0 1 y e mori nel 1644. C ’eft-à-dire : le Père Jérome
de Péroufè, Prêtre de la congrégation de l’oi-
ratoire, fleurit dans le XVIIe fiécle. C ’éteit un
excellent chanteur pour la partie de foprano , & il
fut le premier coffrât admis dans la chapelle pontificale
: jufqu'alors c’étoient des efpagnols qui,
avec des voix de fauffet, deffervoient cette chapelle
en qualité de foprani. Le Pere Jérome y entra
l’aa 1601 , & mourut en 1644.
Nous apprenons ici enpaffant, qu’on n’exigeoit
pas alors d’un Prêtre toutes les qualités qui lui font
néceffaires aujourd’hui, comme elles l’étoient dans
l’anciennè loi ; & qu’on n’avoit pas encore adopté
à Rome dans toute fa rigueur la prohibition dja
Deutéronome, citée au commencement de cet ar-.
ticle.
Seconde partie de la note. Giovanni de San(losy
Spagnuolo , quale mori in Roma nelV anno 162 e ,
. . . . è flato Vultimo foprano di voce di falfetto che
abbia fervito la capella Pontificia. Jean de Sanftos,
efpagnol, mort à Rome l’an 16 2 5 .... a été le^dernier
foprano en vôix de fauffet qui ait fervi à la char
pelle Pontificale.
L ’effet merveilleux de ces voix dans la mufique
facrée ne tarda pas fans doute à les faire employer
fur le théâtre lyrique, né à la fin du fiécle précédent,
& qui commençoit à faire des progrès.
Dans l’origine des repréfentations lyrico-drama-
tiques , les parties de foprano étoient pour la plupart
exécutées par des enfans. Mais le changement d<s
voix qui accompagnoit en eux l’âge v ir il, & 1*
difficulté qu’on trouroit à leur faire mettre dans leur
C A S
»atin expreffion de fentimens étrangers à l’enfarite,
engagèrent les entrepreneurs des fpeâacles à leur
fubfhtuer ces êtres dénaturés qüi fortent de 1 enfance
fans jamais devenir hommes. On voit dans une
lettre du célèbre voyageur Pietro délia Valle, écrite
à lelio Guidicioney en 1640, que les caftrati étoient
dès-lors très-communs fur les théâtres d’Italie. Les
plus fameux de ces premiers virtuofes furent Gui-
dobaldo , Campagnuola , Gregori, Angelucci, & fur-
iout Loretto Vittori, dont quelques auteurs contemporains
font des éloges qui femblent à peine
pouvoir convenir à un mortel. jj
r L’admiration augmenta en proportion des raffi-
nemens & des recherches de l’art du chant, &
comme dans notre fiécle cet art & celui de la com-
pofition dramatique font parvenus au dernier dç-
gré, renthoufiafme a été au comble. Plus de théâtres,
plus de chapelles dans la moindre petite^ville
d’Italie , qui n’aient leurs cafbafi. Les plus célèbres
«nt fait des fortunes énormes : appellés dans pref-
que toutes les contrées de l’Europe, ils les ont
rendues en quelque forte tributaires de l’Italie.
L’éviration a fait pafTer au-delà des monts pref-
«pi’autant de tréfors que les annates. L’Angleterre
qui les refufe au Pape, a fouvent comblé de ri-
chefles des foprani de fa chapelle. Un cafliato a
gouverné l’Efpagne, & eft revenu en Italie bâtir
des palais, & tenir un état de Prince*
De tels exemples ont eu la fuite qu’ils dévoient
avoir. Dans l’efpérance de voir un jour leurs enfans
faire une fortune auffi brillante, & de la partager
avec eux, des parens barbares fe font mis de tou ! es
parts en Italie à multiplier un facrifice qui fait frémir
la nature. Le nombre des viétimes eft devenu
innombrable ; & l’on ne peut comparer fans horreur
le plaifir que font ceux de ces malheureux qui
parviennent à un talent diftingué, les richefles qu’ils
rapportent en Italie , & celles qu’ils contribuent
peut-être à faire verfer par les voyageurs étrangers ,
avec la barbarie du crime contre nature auquel ils
doivent ces avantages, avec l’horrible coup porté
à-la population , dans un pays où tant d’autres cau-
fes de dépopulation s’y joignent ; avec l’exiftence
infortunée d’une foule de ces miférables , qui ont
tout perdu fans rien gagner, qui ceffent d’être
hommes, fans en devenir meilleurs chanteurs , &
qui manquant de voix , font réduits à profeffer
teiftement toute leur vie d’autres parties de la mu-
tique,, où la perte irréparable qu’ils ont faite eft
entièrement inutile, & ne reçoit aucun dédommagement.
Les Papes fe fontfouvent armés contre cet abus.
Clément XIV a renouvell? avec beaucoup de force
le» excommunications'Contre les auteurs de ces mutilations
criminelles ; il eft même d’ufage que chaque
Pape en- fafie autant à fon exaltation Les lois
de; la: policé humaine ■ fie- font jointes à cette police
fpïrituelle. Un pere a bien l'effronterie de fe
montrer ayèc un; fil- qu’il a mis hors d’état d’en
avoir jamais ; »mais. il. faut qu’il fe cache quaad il
opère ou fait opérer cette dégénératîon. Le Dr.
Burney, maigre les recherches les plus exactes,
n’a pu découvrir dans aucun endroit de l ’Italie , où
& par qui l’opération eft faite. M. de la Lande a
été plus heureux , puifqu’il affure dans fon voyage,
avoir vu à Naples, des boutiques avec cette inferip-
tion : qui f i cafirano i raga^i ; mais la févérité des
loix contre la^ caftration rend cette affiche invrai-
femblablei
La mémoire de M. de la Lande l’a peut-être
trompé. Il fe fera rappellé d’avoir lu dans Voltaire,
( commentaire fur le livre des délits & des peines )
ce trait qui n’étoit fans doute qu’une plaifamterie :
c« il n’y a pas long-temps qu’on voyoit à Naples ,
j j en gros caractères , au-deffus de la porte de cer-
j j tains barbiers : qui f i cafirano maravigliofomente
j j i putti ; j j & il aura cru fe foüvenir d’avoir vu
lui-même' à Naples une infeription pareille.
Il faut cependant que les Magiftrats ne veillent
pas avec une extrême exactitude, puifque fi l’on
eft obligé de commettre fecrettement le crime , on
peut l’avouer lorfqu’il eft commis. Il n’y à donc
point de févérité outrée à dire que cette barbarie,
la dépravation qu’elle annonce & celle qu’elle entraîne
, déshonorent véritablement l’Italie aux yeux
de la philofophie 8c de l’humanité. Plus d’un écrivain
philofophe s’eft élevé, mais infructueufement,
contre cet ufage. Un de ceux qui l ’ont fait avec
le plus de véhémence , eft le Signor Artéaga dans
fes révolutions du théâtre lyrique.
es Si j’avois, dit/il, le droit d’élever la voix contre
les abus qui ne font pas purement littéraires , je
citerais devant un tribunal'dont on n’appelle pas ,
devant le tribunal de l’humanité, de la philofophie
& de là religù n , la barbare & exécrable coutume
qui fe conferve toujours en Italie, de mutiler fi
cruellement des êtres infortunés , fans autre but
que de flatter l’oreille par l’inutile & vain plaifir
du chant ; que d’amtifer dans fes dégoûts un public
capricieux , oifif & corrompu ; que d’exciter
un applaudiffement paffager & frivole fur ces théâtres
qui furent jadis inftitués pour graver dans
l’ame des peuples les maximes les plus importantes
de la morale, jj
«s J’exhorterois les grands de la terré qui accumulent
follement fur ces hommes dégénérés les
honneurs & les richefles, & favorifent ainfi cet
abus infâme , je les exhorterais , dis-je , à con-
facrer leurs tréfors & leur protection à d'autres
ufages moins déshonorans pour la raifon, & moins
pernicieux pour l’efpèce humaine. »
es Je ferais rougir ces philofophes qui confa-
crent leurs recherches à des objets inutiles , Si
négligent cet horrible attentat, lequel fe maintient
uniquement, parce qti'il eft autorifé par le
temps , & parce qu’il eft foutenu par le defpotifmt
du plaifir (1) ».
• ( j ) J’ai dû' conferver, dans la tradnCli'on , cette expraf-
fion originale & neuve.