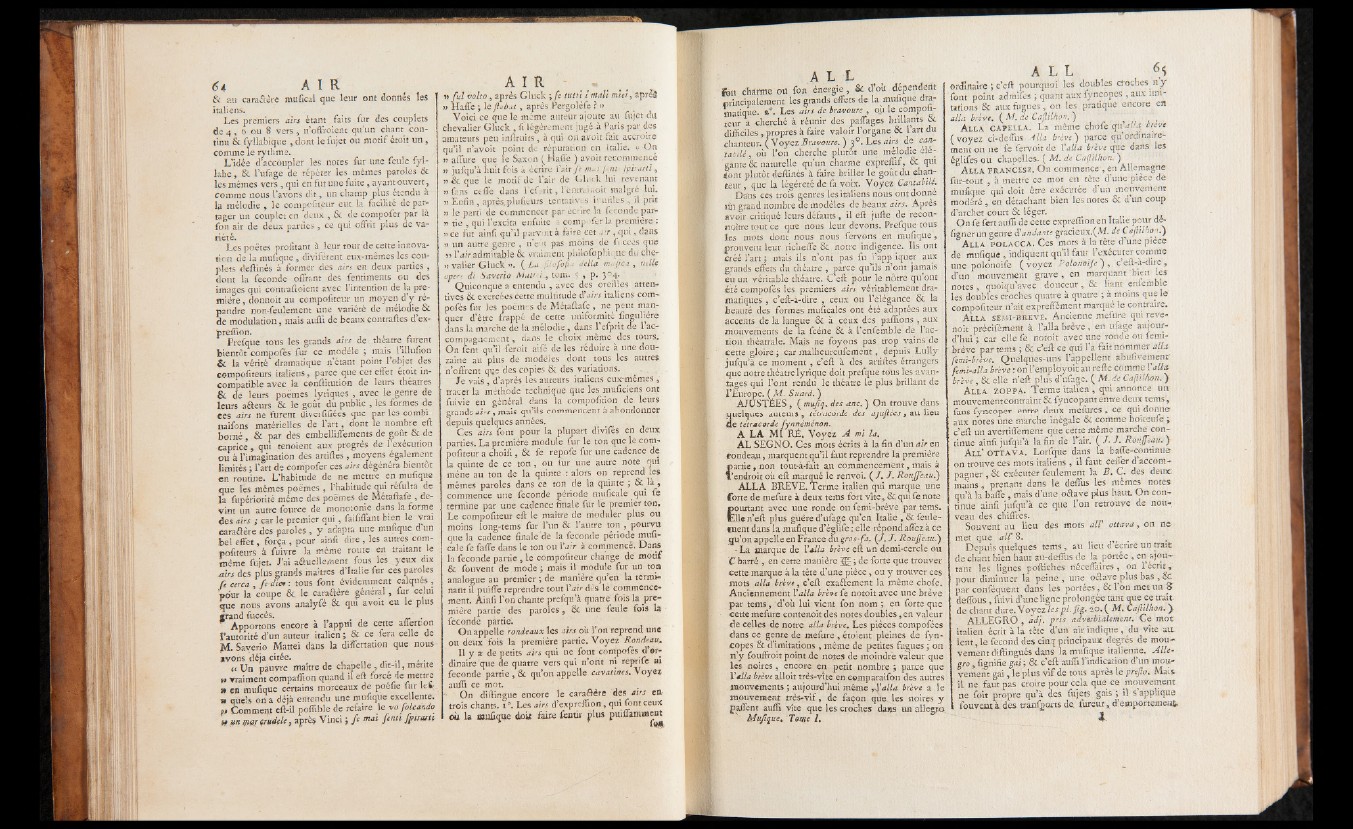
64 AIR
& au caraftére mufical que leur ont donnés les
italiens.
Les premiers airs étant faits fur des couplets
de 4 , 6 ou 8 v e r s , n’oftYoient qu'un chant continu
& fyllabique , dont le fujet ou motif éioit u n ,
comme le rythme.
L ’idée d’accoupler les notes fur une feule fyl-
ïabe, & l’ufage de répéter les mêmes paroles &
les mêmes vers , qui en fut une fuite, ayant ouvert,
comme nous l’avons d it, un champ plus étendu à
la mélodie , le composteur eut. la facilité de partager
un couplet en deux , & de compofer par la
fon air de deux parties , ce qui offrit plus de va- j
riété.
Les poètes profitant à leur tour de cette innovation
de la mufique, différent eux-mêmes les couplets
devinés à former des airs en deux parties ,
dont la fécondé offrant des fentiments ou des
images qui contraftoient avec l’intention de la première
, donnoit au compofiteur un moyen d y répandre
non-feulement une variété de mélodie &
de modulation, mais aufli de beaux contraires d ex-
prefiion. jjj t
Prefque tous les grands airs de theatre furent
bientôt conipofés fur ce modèle ; mais^ 1 illufion
& la vérité dramatique n’étant pointTobjet des
eempofiteurs italiens, parce que cet effet etoit incompatible
avec la conftitution de leurs théâtres
& dé leurs poèmes lyriques , avec le genre de
leurs afteurs & le goût du public , les formes de
ces airs ne furent diverfifiées que par les combi-
naifons matérielles de 1 art , dont le nombre eff
borné, & par des embelliffements de goût & de
caprice, qui tenoient aux progrès de 1 execution
ou à l’imagination des artiffes, moyens egalement
limités ; l’art de compofer ces airs dégénéra bientôt
en routine. L’habitude de ne mettre en mufique
que lès mêmes poèmes , l’habitude qui réfulta de
la fupériorité même des poèmes de Metaftafe , devint
un autre fource de monotonie dans la forme
des airs j car le premier q u i, faififfant bien le vrai
caraéière des paroles , y adapta une mufique d un
bel effet, força , pour ainfi dire , les autres com-
pofiteurs à fuivre la même route en traitant le
même fujet. J’ai actuellement fous les yeux dix
jfirs des plus grands maîtres d’Italie fur ces paroles
ft cerca , fe die* : tous font évidemment calques |
pour la coupe & le caractère général, fur celui
que nous avons anaiyfé & qui avoit eu le plus
grznd fuccès. .
Apportons eneore à l’appui de cette afiertson
l ’autorité d’un auteur italien ; & ce fera celle de
;M. Saverio Mattéi dans la differtation que nous
avons déjà citée. .. , .
c< Un pauvre maître de chapelle , dit-il, mente
?» vraiment compaflion quand il eft forcé de mettre
9 en mufique certains morceaux de poefie fur lek.
» quels on a déjà entendu une mufique excellente.
p, Comment cfl-il poffible de refaire le vo folcando
& yn mar çrudele, après Vinci j f mal f entl fpirafti
A I R
i» fui v o l to , après Gluck \fe tutti i m a l lmiel, apret
» Haffe ; le ftabat, après Pergolèfe ? »
Voici ce que le meme auteur ajoute au fujet du
chevalier G lu c k , fi légèrement jugé-a Paris par des
amateurs peu infiruits , à qui on avoit fait accroire
qu’il n’avoit point de réputation en Italie. (< On
»? affine que le Saxon ( Haffe ) avoit recommencé
» jufqu’à huit fois à écrire l’air Jè mai (ent fpirarti,
» 8c que le motif de l’air de Gluck lui revenant
»fans ce fie dans le f i r i t , 1 entrai aoit malgré lui.
» Enfin, après,plufieurs tentatives inutiles , il prit
» le parti de commencer par écrire la fécondé par-
» tie 1 qui l’excita enfuite a compofer la première :
» ce fut ainfi qu’ il parvint à faire cet air , qui, dans
» un autre genre , n’eut pas moins de fuccès que
ss Vair admirable 8c vraiment philofophique du che-
» valier Gluck ». {L a fUcfofiu délia mufic a , utile
opère di Saverio Matin , tpm. 5 » P* 3° 4*
Quiconque a entendu , avec des oreilles attentives
& exercées cette multitude cl'airs italiens com-
pofés fur les poèmes de Metaftafe , ne peut manquer
d’être frappé de cette uniformité fingulière
dans la marche de la mélodie , dans l’efprit de l’accompagnement,
dans le choix même des tours.
On fent qu’il feroit aifé de les réduire à une douzaine
au plus de modèles dont tous les autres
n’offrent que des copies & des variations.
Je vais , d’après les auteurs italiens eux-mêmes ,
tracer la méthode technique que les muficieris ont
fuivie en général dans la compofition de leurs
grands airs, mais qu’ils commencent à abondonner
depuis quelques années.
Ces airs font pour la plupart divifés en deux
parties. La première module fur le ton que le compofiteur
a choifi , & fe repofe fur une cadence de
la quinte de ce ton , ou fur une autre note qui
mène au ton de la quinte : alors on reprend les
mêmes paroles dans ce ton de la quinte , 8c l a ,
commence une fécondé période muficale qui fe
termine par une cadence finale fur le premier ton.
Le compofiteur eft le maître de moduler plus ou
moins long-tems fur l’un 8c l ’autre ton , pourvu
que la cadence finale de la fécondé période muficale
fe £afie dans le ton ou Vair à commencé. Dans
la fécondé partie , le compofiteur change de motif
& fouvent de mode ; mais il module fur un ton
analogue au premier ; de manière qu’en la terminant
il puiffe reprendre tout Vair dès le commencement.
Ainfi l’on chante prefqu’à quatre fois la première
partie des paroles , 8c une feiile fois 1$
fécondé partie.
On appelle rondeaux lès airs ou l’on reprend une
ou deux fois la première partie. Voyez Rondeau»
Il y a de petits airs qui ne font compofes^ d ordinaire
que de quatre vers qui n’ont ni reprife ai
fécondé partie , 8c qu’on appelle cavatines. Voyez
aufli ce mot.
On diftingue encore le cara&ère des airs en-
trois chants. i°. Les airs d’expreflion, qui font ceux
où la mufique doit faire feu tir plus pui flamme nt
ton chimie ou fon énergie, & cl'ou dépendent
principalement les grands effets de la mufique dra-
matique. s.0. Les airs de bravoure , ou le compon-
teur a cherché à réunir des paftages brillants oc
difficiles , propres à faire valoir l’organe & l’art du
chanteur. (V o y e z Bravoure. ) 30. Les airs de can-
ïabilê, où Ton cherche plutôt une mélodie ele-
gante 8c naturelle qu’un charme expreffif, & qui
ibnt plutôt deftinés à faire briller le goût du chanteur
, que la légèreté de fa voix. Voyez CantabilL
Dans ces trois genres les italiens nous ont donne
1Ù1 grand nombre de modèles de beaux airs. Après
avoir critiqué leurs défauts, il eft jufte de recon-
«oître tout ce que nous leur devons. Prefque tous
les mots dont nous nous fervons en mufique,
prouvent leur richeffe 8c notre indigence. Ils ont
créé l’art ; mais ils n’ont,, pas fu i’app iquer aux
grands effets du théâtre , parce qu’ils ri’ont jamais
eu un véritable théâtre. C ’eft pour le nôtre qu’ont
été compofés les premiers airs véritablement dra- _
manques , c’eft-à-dire , ceux ou l’élégance & la
beauté des formes muficales ont été adaptées aux
accents de la langue & à ceux des pallions , aux
mouvements de la fcène & à l’enfemble de l’action
théâtrale. Mais ne foyons pas trop vains de
cette gloire ; car maiheuretifement, depuis Lully
jufqu’à ce moment , c’eft à des artiftes étrangers
que notre théâtre lyrique doit prefque tous les avantages
qui l ’ont rendu le théâtre le plus brillant de
l ’Europe. ( M. Suard. )
AJUSTÉES , ( mufiq. des anc. ) On trouve dans
quelques auteurs , tétracorde des ajuftées , au lieu
de tétracorde fynnéménon.
A L A M l RÉ. Voyez A mi la.
A L SEGNO. Ces mots écrits à la fin d’un air en
tondeaji, marquent qu’il faut reprendre la première
fartie, non tout-à-fait an commencement, mais à
endroit où eft marqué le renvoi. ( / . /. Roujfeau.)
ALLA BREVE. Terme italien qui marque une
forte de mefure à deux tems fort vite, & qui fe note
pourtant avec une ronde 011 femi-brêve par tems.
Elle n’eft plus guère d’ufage qu’en Italie , & feulement
dans la mufique d’églife ; elle répond affez à ce
qu’on appelle en France du çros-fa. (/. /. Roujfeau.).
- La marque de Voila brève eft un demi-cercle ou
C barré , en cette manière ^ ; de forte que trouver
cette marque à la tête d’une pièce, ou y trouver ces
mots alla brève, c’eft exa&ement la même chofe.
Anciennement Voila brève fe notoit avec une brève
par tems, d’où lui vient fon nom ; en forte que
cette mefure contenoit des notes doubles, en valeur
de celles de notre alla brève. Les pièces compofées
dans ce genre de mefure , étoient pleines de fyn-
copes & d’imitations , même de petites fugues ; on
n’y fouffroit point de nojes de moindre valeur que
les noires, encore en petit nombre ; parce que
Voila brève alloit très-vîte en comparaifon des autres
mouvements ; aujourd’hui même ffa lla brève a le
mouvement très-vif, de façon qüe, les noires y
paffent aufli vîte que les croches dans un allegro
Mufique. Tonie /.
ordinaire ; c’eft pourquoi les doubles croches n y
font point admifes ; quant aux fyncopes , aux imitations
8c aux fugues, on les pratique encore en
alla brève. (AJ. de Caflilhon.) „ , .
A lla c a pe l la . La même chofe qi^alla, brève
(v o y e z ci-deffus Alla brève ) parce qu’ordinaire-
ment on 11e fe fervoit de l'alla brève que dans les
églifes ou chapelles. ( M. de Cajlilhon. )
A lla francesz. On commence , en Allemagne
fur-tout , à mettre ce mot en tête d une piece de
mufique qui doit être exécutée d’un mouvement
modéré , en détachant bien les notes 8c d’un coup
d’archet court & léger.
On fe fert aufli de cette expreflion en Italie pour dé»
fignerun genre d'andante gracieux.(M. de Cajtilho-i.)
A lla p o l a c c a . Ces mots à la tête d’une piece
de mufique , indiquent qu’il faut l’exécuter comme
une polonoife (v o y e z Polomije) , c’eft-à-dire,
d’un mouvement grave , en marquant bien les
notes, quoiqu’avec douceur, 8c liant enfemble
les doubles croches quatre à quatre ; à moins que le'
compofiteur n’ait expreffément marqué le contraire.
A lla semi-b reve. Ancienne mefure qui reve-
noit précifément à l’alla brève, en ufage aujourd’hui
; car elle fe notoit avec une ronde pu femi-
brève par tems j 8c c’eft ce qui 1 a fait nommer alla
femi-brève. Quelques-uns l’appellent abufivemenr
femi-alla brève : on l’employoît an refte comme l'alla
brève , & elle n’eft plus d’ufage. ( M. de Cajlilhon. )
A lla z o p p a . Terme italien , qui annonce un
mouvement contraint & fyncopant entre deux tems ,
fans fyncoper entre deux mefures, ce qui donne
aux notes une marche inégale & comme boiteufe ;
c’eft un avertiffement que cette même marche continue
ainfi jufqu’à la fin de 1 air. ( /■ J. Roujfeau. )
A ll’ o t t a v a . Lorfque dans la baffe-continue
on trouve ces mots italiens , il faut çefler d accompagner
, & exécuter feulement la B. C. des deux:
mains, prenant dans le. deffus les mêmes notes
qu’à la baffe , mais d’une o&ave plus haut. On continue
ainfi jufqu’à ce que l’on retrouve de nouveau
des. chiffres. ;
Souvent au lieu des mots all' ottava, on ne
met que a lf S.
Depuis quelques tems, au lieu d écrire un trait
de chant bien haut au-deflus de la portée , en ajoutant
les lignes poftiches riéceffaires , on l ’écrit,
| pour diminuer la peine , une oélave plus bas , 8t
par conféquent dans les portées, 8c I on met un 8
deffous, fuivi d’une ligne prolongée tant que ce trait-
de chant dure.1Voyez les pl-fig- 2.0. ( M. Cajlilhon. y
ALLEGRO , adj. pris adverbialement. Ce mot
italien écrit à la tête d’un air indique , du vite au.
lent, Le fécond des cinq principaux degrés de mouvement
distingués dans la mufique italienne. A lle gro
, lignifie gai ; & c’eft aufli l ’indication d’un mouvement
gai, le plus v if de tous après le preflo. Mais
il ne faut pas croire pour cela que ce mouvement
ne foit propre qu’à des fujets gais j il s applique
fouveut à des. tranfports de fureur , d’emportement