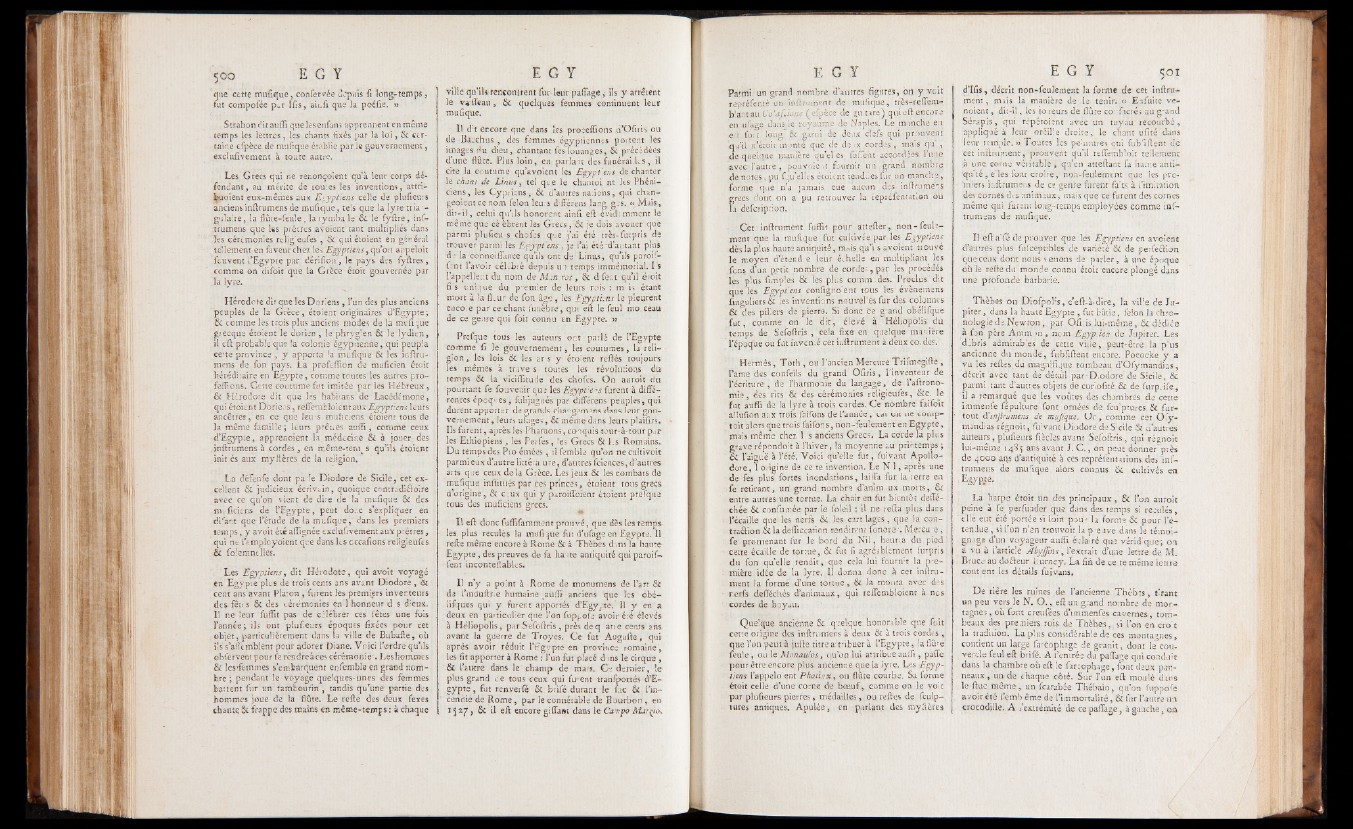
que cette mufique, confervée depuis fi long-temps,
fut compofée pur Ifis, aii.fi que la poéfie. »
Strabon cit auffi que lesenfan; apprennent en même
temps les lettres, les chants fixés par la l o i , & certaine
efpèce de mufique établie par le gouvernement,
exclufivement à toute autre.
Les Grecs qui ne renonçoient qu’à leur corps défendant,
au mérite de tou:es les inventions, attri-
buoient eux-mêmes aux Egyptiens celle de plufieurs
anciens inftrumens de mufique, tels que la lyre-tria -
gulaire, la flûte-feule, la tymba le &. le fy ft re , inftrumens
que les prêtres avoient tant multipliés dans
-les cérémonies relig eufes , &. qui étoient en général
tellement en faveur chez les Egyptiens, qu’on appeloit
feu vent l’Egyp te par dérifion, le pays des fyftres ,
comme on difoit que la Grèce étoit gouvernée par
la lyre.
Hérodote dit que les Dorîens , l’un des plus anciens
peuples de la G rè c e , étoient originaires d’Egypte ;
&. comme lés trois plus anciens modes de la mcfiîjue
grecque étoient le dorien , le phrygien & le lydien ,
il efl probable que !a colonie égyptienne, qui peupla
cette province , y apporta la mufique & les inflru-
mens de fon pays. La prefeffion de muficîen étoit
héréditaire en E g y p te , comme toutes les autres proférions.
Cette coutume fut imitée par les Hébreux,
& Hérodote dit que les habitans de Lacédémone,
qui étoient Dorier-s 5 reffembloient aux Egyptiens leurs
ancêtres, en ce que leurs muficiens étoient tous de
la même famille; leurs prêtres au ffi, comme ceux
■ d’E g yp te , apprenoient la médecine & à jouer, des
inftrumens à cord es, en même-ten^s qu’ils étoient
init és aux myiières de la religion.
La défenfe dont pa le Diodore de Sicile, cet excellent
& judicieux écrivain, quoique conrtediéloire
avec ce qu’on vient de dire de la mufique & des
miliciens de l’E g yp te , peut dor.c s’expliquer en
disant que l’étude de la mufique,” dans les premiers
temps, y avoit été affignée exclufivement aux p rêtres,
qui ne i’emplcyoient que dans les cccafions reiigi.eufes
& falemnelles.
Les Egyptiens, dit Hérodote, qui avoit voyag é
en Egyp te plus de trois cents ans avant Diodore , 6t
cent ans avant Platon , furent les premiers inventeurs
des fêtes & des cérémonies en 1 honneur d s dieux.
11 r.e leur fufüt pas de célébrer ces fêtes une fois
l’année 'y ils ont plufeu rs époques fixées pour cet
objet, particulièrement dans la ville de Bubafle, où
ils s’afîèmblent pour adorer Diane. Voici l’ordre qu’ils
obfêrvent pour fe rendre à ces cérémonie-. Les hommes
& les'femmes s’embarquent enfemble en grand nomb
re ; pendant le voyag e quelques-unes des femmes
battent fur un' tambourin , tandis qu’une partie des
hommes joue de la flûte. L e .refie des deux fexes
chante & frappe des mains en même-temps : à chaque
ville qu’ils rencontrent fur leur paffage, ils y arrêtent
le va’fleau, & quelques femmes continuent leur
mufique.
Il d:t encore que dans les proceffions ci’Ofiris ou
de Bacchus , des femmes égyptiennes postent les
images du dieu, chantant fes louanges, & précédées
d’une flûte. Plus lo in , en parlait des fun éra i.k s , il
cite la coutume qu’a voient les Egyptens de chanter
le chant de Linus-, tel que le chantoi nt les Phéniciens,
les C yp r isn s , & d’autres na.ions, qui chan-
geoient ce nom félon .leurs d-fférens lang gcs. « Mais,
d i t - il, celui qu’ils honorent ainfi eft évidemment le
même que cé èbrent les G re c s , & je dois avouer que
parmi pfufieu s chofes que j’ai été très-fur pris, de
trouver parmi les Egypt ens , je l’ai é té 'd ’autant plus
de la connoiffance qu’ils ont de Linqs, qu’ ils paroif-
-frnt l’avoir célébré depuis in temps immémorial. I s
l’appellent du nom de Man.ros, &. d fent qu’il évoit
fi s unique du p -emier de leurs rois : m is étant
mort à la fLur de fon .â g e , les Egyptiens le pleurent
enco.e par ce chant funèbre, qui eft le feul mo.ceau
de ce genre qui foit connu "en Egypte. »
Prefque tous-les auteurs ont parlé de l’Egypte
comme fi le gouvernement, les coutumes, la religion
, les lois & les ar s y étoient refiés toujours
les mêmes à trave s toutes les révolutions du-
temps & la vicifïitude des chofes. O n auroit du.
pourtant fe foevenir que les Egyptiens furent à différentes
époq e s , fubjugués par différens peuples, qui
durent apporter de grands changent ens dans leur gouvernement,
leurs ufages, & même-dans leurs plaifirs.
Ils furent, après les Pharaons, conquis tour-à-tour p,.r
les Ethiopiens , les Perfes, les Grecs & l.s Romains-
Du temps des Pto émées , il femble qu’on ne cultivoit
parmi eux d’autre littéra ure, d’autres fciences, d ’autres
arts que ceux de là Grèce. Les jeux & les combats de
mufique inflitués par ces princes, étoient tous grecs
d’origine, & ceux qui y paroiffoient étoient prefque
tous des muficiens grecs.
Il efl donc fuffifamment prouvé, que dès les temps-
les plus reculés la mufique fut d’ufage en Egypte. Il
refie même encore à Rome & à Thèbes dans la haute
E g y p te , des preuves de fa haute antiquité qui paroif-
fent incontestables.
Il n’y a point à Rome de monumens de l’art &
de l’ induflrie humaine ■ âufff anciens que les obé-
lifques qui y forent apportés d’Egypte. Il y en a
deux en particulier que l’on fuppole avoir é:é élevés
à Héliopolis, par Sefoflris, près deq an e cents ans.
avant la guerre de Troyes . C e fut A u g u fle , qui
après avoir réduit l’Egypte en province romaine',
les fit apporter à Rome : l’un fut placé d ins le cirque ,
& l’autre dans le champ de mars.. G-e dernier, le
plus grand c e tous ceux qui firent tranfportés d’Eg
y p t e , fut renverfé & brifé durant le fac & l’incendie
de R om e , par le connétable de Bourbon en
1 5 27 > & d eft encore giflant dans le Cavpo Mar^iox
Parmi un grand nombre d’autres figures , ôn y voit
repréfenté'un infiniment de mufique, tfès-reffem-
blantau Co’afàone (efpèce de guitare) qui eft encore
en ufage dans Je royaume de Naples. Le manche en
eit foit long & garni de deux clefs qui prouvent
qu’il n’étoit monté que de de.ix cordes, mais q u :,
de quelque manière qu’eles, fij fient'-accordées Tune
avec l’autre , pouvoie.it fournir un grand nombre
de notes, pu fqu’elies étoient tendues fur un manche,
forme que n’a jamais eue aucun des inftrumens
grecs dont on a pu retrouver la fepréfentation oü
la defeription.
Ce t infiniment fuffit pour attefter, n on -feu lement
que la mufique fut cultivée par les Egyptiens
dès la plus haute antiquité, m«is qu’i s avoient trouvé
le moyen d’ëtend e leur échelle en multipliant les
.fons d’un petit nombre de co rd e;, par les procédés
les plus Amples & les plus comm.des. Proclus dit.
que les Egyptiens configno’ent tous les évènemens
fmguliérs& les inventions nouvel1 es fur des colonnes
& des piliers de pierre. Si donc ce g'and obélifque
fu t , comme on le d i t , élevé à HéliopoUs du
temps de Sefoflris , cela fixe en quelque manière
l’époque ou fat inventé cét inflrument à deux co- des.
Hermès, Toth , ou l ’ancien Mercure Trifmegifle,
famé des confeils du grand O ffr is , l’inventeur de
l’écriture , de l’harmonie du langage, de l’aflrono-
m îe , des rits & des cérémonies religieufes, & c . le
fut auffi de la ly fe à trois cordes. Ce nombre faifoit
allufion aux trois faifons de l’année ; car on ne comptoir
alors que trois faifons, non-feulement en E g y p te ,
maïs même chez 1 s anciens Grecs. La çprde la plus
grave répondoit à l’hiver, la moyenne au printemps ;
6t l’aigue à l’été. V o ic i qu’elle fu t , fuivant Apollo-
dore, 1 origine de ce te invention. Le N 1 , après une
de fes plus fortes inondations, laiffa fur la terre en
fe retirant, un grand nombre d’anim .ux morts, &
entre autres une tortue. La chair en fut bientôt deffé-
chée & confuirée. par le foleil : il ne refta plus dans
l’écaille que les nerfs & les cart.lages, que la con-
traélion & la defficcation rendirent fonore-. Mercu e *
fe promenant fur le bord du N i l , heu ri a du pied
cette écaille de tortue, & fut fi agréablement furpris
du fon qu’elle rendit, que cela lui fourn't la première
idée de la lyre. Il donna donc à cet infiniment
la forme d’une tortue , & la monta avec des
rerfs defféchés d’animaux, qui reffembloient à nos
cordes de boyau.
Quelque ancienne & quelque honorable que foit
cette origine des infini mens à deux & à trois cordes ,
que l’on peut à jufte titre aitribuer à l’E g yp te , la flûte’
feu le, ou le A-Jon.au/os, qu’on lui attribue au ffi, paffe
pour être encore plus ancienne que la lyre. Les Egyptiens
l’appelo'ent Photinx, ou flûte courbe. Sa forme
étoit celle d’une corne de boe u f, comme on le voit
par plufieurs pierres, médailles, ou refies de fculp-
lures antiques. A p u lé e, en parlant des myfières
d’Ifis, décrit non-feulement la forme de cet infiniment,
mais la manière de le tenir; « Enfuite ve-
noient, dic-il, les joueurs de flûte co:;fiicré> au g'and
Sérapis, qui répétoient avec un tuyau recourbé,
appliqué à leur oreille droite, le chant ufité dans
leur temple, n Toutes les peintures qui fubfiftent de
cet infiniment, prouvent qu’il reffembloit tellement
à une corne véritable i qu’en atteflant fa haute anti-
qu 'té , e'les font croire, non-feulement que les premiers
inftrumens de ce genre furent fa’ts à l’imitation
des cornes des animaux, mais que ce furent des cornes
même qui furent long-temps employées comme inftrumens
de mufique.
Il eft a lé de prouver que les Egyptiens en avoient
d’autres plus fufceptibles de variété & de perfeélion
que ceux dont nous t étions de parler , à une époque
où le refte du monde connu étoit encore plongé dans
une profonde barbarie.
Thèbes ou D io fp o lis, c’efl-à-dire, la ville de Jup
iter, dans la haute Egypte , fut bâtie, félon la chronologie
de N ew to n , par Offris lui-même , & dédiée
à fon père A mm >n , nom Egyp.ien de Jupiter. Les
débris admirables de cette v ilie , peut-être la p'us
ancienne du monde”, 'ftibffflent encore. Pococke y a
vu les reftes du magnifique tombeau d’Ofymandias,
décrit avec tant de détail par'Diodore de Sicile, &
parmi tant d'autres objets de curioffté & de fu rp.ife,
il a remarqué que les voûtes des chambrés de cette
immenfe fépulture font ornées' de fcu’prures & fur-
tout Ôl inftrumens de mufique. O r , comme Cet O f y -
mandias régnoit, fuivant Diodore de Sicile & d’autres
auteurs, plufieurs fièclés avant Sefoflris, qui régnoit
lui-même 1485 ans avant J. C . , on peut donner près
de 4000 ans d’antiquité à ces repréfent uions des inftrumens
de mufique alors connus ôc cultivés en
Egyp.té.
La harpe étoit un des principaux, & l’on auroit
peine à fe, perfuader que dans des temps si reculés,
elle eut été portée si loin pour h forme & pour l’étendue
, si l’on n’en trouvoît la p euve dans le témoignage
d’un voyageur auffi éclairé que véridique; on
a vu à l’article Abyjfins, l’extrait d’une lettre de M.
Bruce au doéleur Kurney. La fin de ce.te même lettre
cont ent les détails fui vans.
D e rière les ruines de l’ancienne T h èb e s , tirant
un peu vers le N. O . , efl un grand nombre de montagnes
, où font creufées d’immenfes cavernes, tombeaux
des premiers rois de T h èb e s, si l’on en cro t
la tradition. La plus considérable de ces montagnes,
contient un large^ farcophagè de g ran it, dont le°couvercle
feul eft brifé. A l’entrée du paffage qui conduit
dans la chambre où eft le farrophage, font deux panneaux
, un de chaque côté. Sur l’un eft moulé dans
le fluc même , un fearabée T héba in, qu’on fuppofe
avoir été llemb ême de l’immortalité, & fn r l’autre 11.1
crocodillç. A l’extrémité de ce paffage, à gauche, ©a