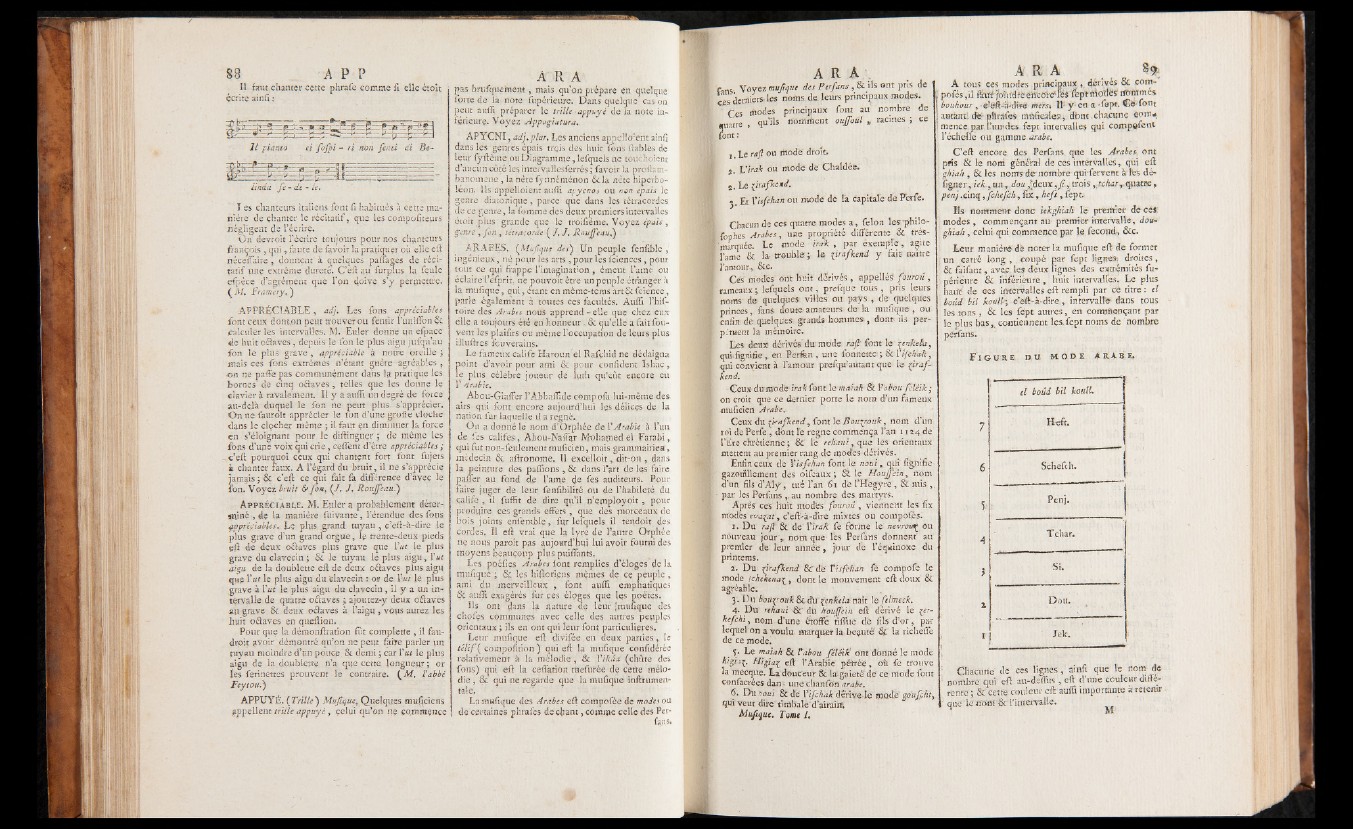
88 A P P
Il faut chanter cette phrafe comme fl elle étoit
écrite ainfl :
I l pianto ci fofpi - ri non fenti di Bem
z f c | = E l f c
Linda je
I es chanteurs italiens, font fi habitués à cette manière'
de chanter le récitatif ? que les çpnipoüteprs
négligent de l’écrire.
On devroit l’écrire toujours pour nos chanteurs
françois , q u i, faute de favoir la pratiquer où elle eff
néceffaire , donnent à quelques paliages de récitatif
une extrême dureté. C ’eff gu" furplus la feule
efpèce d’agrément que l’on doive s’y perpiçttrç.
F ramer y , )
APPRÉCIABLE , ad). Les fons appréciables
font ceux dont,on peut trouver ou fenrir l’uniffon
calculer les intervalles. M. Euler donne un efpace
de huit oékves , depuis le fon le plus aigu jufqii’au
fon le plus grave , appréciable à notre oreille ;
mais ces fons extrêmes i f étant guère agréables ,
on ne paffe pas communément dans la pratique les
bornes’ de cinq oéîaves , telles que les donne le
davier à ravalement. Il y a auffi un degré de force
au-delà duquel le fon ne peut plus s’apprécier.
On ne fauroit apprécier le fon d’une grofie cloche
dans le clçcher même ; il faut en diminuer la force
en s’éloignant pour le diRin^uçr ; de même les
fons d’uné voix qui crie, ceffènt d’être appréciables ;
.c ’eft pourquoi ceux qui chantent fort font fujets
à chanter faux. A l’égard du bruit, il ne s’appréciç
jamais ; 8ç c’eft ce qui fait & différence d’âveç le
fon. Voyez bruit &Jon, {J, J , Rouffeau.)
A p p r é c ia b l e . M. Euler a probablement déterr-
suiné , dç la manière fuivante, l’étendue des fons
appréciables. Le plus grand tuyau , c’eft-à-dire le
plus grave d?un grand orgue, le trente-deux pieds
gft de dçux oélaves plus grave que Y ut le plus
grave du clavecin ; & le tuyau le plus aigu, Y ut
aigu de la doublette eff de deux oftayes plus aigu
que Y ut le plus aigu du clavecin : or de Y'ut le plus
grave g Y ut le plus aigu du clavecin, il y a un intervalle
de quatre ocîavês ; ajoutez-y deux oéîaves
au grave & deux oâaves à l’aigu , vous aurez les
huit o&aves en queffion.
Pour que la démonffration fût complette, il fau-
droit gvoir démontré qu’on ne peut faiye parler un
tuyau moindre d’un pouce & demi ; car Y ut le plus
aigu de la doublette n’a que cette longueur ; or
tes fermettes prouvent le contraire. ( M. l'abbé
Feytou.)
APPUYÉ. ( Trille) Mufique, Quelques mufteiens
appellent trille appuyé, celui qu’on ne commence
A R A
pas brufquehient, mais qu’on prépare çn quelque
forte de là note fupérieure. Dans quelque cas on
peut auffi préparer le trille-appuyé d elà note inférieure.
Voyez Appogiatura
APYCNI ? adj.plur. Les anciens appelloient ainfî
dans lçs genres épais trois des huit fons fiables de
leur fyftême.ou Diagramme, lefquels ne touchoienr
d’aucun côté les intervallesferrés ; favoir la profin m-
banomene , la nète fy n'némènon & lg nète hiperbo-
leon. Ils appelloient aufîl apyenos ou non épais le
genre diatonique, parce que dans les têtracordes
de ce genre, la fomme des deux premiers intervalles
étoit plus grande que le troifieme. Voyez épais,
genre , fon , tét 'racorde ( J, J, Rouffeau,) •
ARABES, (Mufique des) Un peuple fçnfible ,
ingénieux , né pour les arts , pour les fçiences, pour
tout ce qui frappe l’imagination, émeut l’ame ou
éclaire l’efpritj ne pouvoit être un peuple étranger à
la mufique, qui, étant en même-tems art&fciehce,
parle également à toutes ces facultés. Auffi l’hif-
toire des Arabes nous apprend - elle que chez eux
ëlle a toujours été en honneur , & qu’elle a fait fou-
vent les plaifirs ou même l’occupation de leurs plus
illuflres feuverains.
Le fameux calife Haroun el Rafçhid ne dédaigna
point d’avoir pour ami & pour confident Ishac,
le plus célébré joueur dé luth qifeùt encore eu
1’ érable.
Abcu-Giaffer l’Abbaffide eompofa lui-même des
airs qui font encore aujourd’hui lgs délices de la
nation fur laquelle il g régné..
On g donné le nom d’Orphée de Y Arabie g l’un
de les califes, Abou-Naffgr Mohamed el Fgrabi,
qui fut non-feulement muficien, mais grammairien,
médecin & afîronome. Il excelloit, dit-on, dans
la peinture des pafïions , & dans l’grt de les faire
paffer au fond de l’ame de fes auditeurs. Pour
faire juger de leur fenfibilité ou de l’habileté du
calife , il fuffit de dire qu’il n’employoit, pour
produire ces grands effets, que des morceaux de
bois joints çnfemble, fqr lefquels il tendoit des
corçjes, Il eff vrai que lg lyre de l’autre Orphée
ne nous parôît pas aujourd’hui lui avoir fourni des
moyens beaucoup plus puiffants,
Les poéfies Arabes font remplies d’éloges de la
mufrqijè ; 8c lçs bifforipns mêmes de ce peuple,
aipi du merveilleux , font auffi emphatiques
& auffi exagérés fur çes éloges que les poètes.
Ils ont dans la nature de leur jmuffque des
chofes communes avec celle des autres peuples
Orientaux ; ils en ont qui leur font particulières.
Leur mufique eff divifée,en deux parties, le
te lif ( composition ) qui eff la mufique confidérée
relativement à la mélodie, & Vikda (chute des
fons) qui eff la ceffation mefuréè de cette mélod
ie , & qui ne regarde que la mufique inftrumen-
tale.
La mufique des Arabes eff compofée de modes ou
de certaines phrafes de chant, comme celle des Perfans
»
a r a .
fans. Voyez mufiqm des Perfans, 8c Ils ont pris de
ces dernierst les ne-ms de. -leurs principaux modes.
I Ces modes principaux font au nombre de
»uatre , qu’ils nomment ouffoût % racines ; ce
•lont:
i. Le raft ou rtlode droit.
I 2. V'irak ou mode de Chaldèe.
a. Le firafkend.
y Et Yisfehan ou riiode de là capitale de Ferfe.
I ç iracun de ces quatre modes a , félon les/philo-
Ifophes A ra b e s , une propriété différente & très-
pmarquée. Le mode irAc , par exemple, agite-
[ l’ame & la- trouble; le lira fk e n d y fait-' naître
[ l’amour , &£•
Ces modfes' ont huit dérivés, appellés four ou ,
' rameaux ; lefquels o n t , prcfque tous , pris leurs
noms de- quelques; villes ou pays , de quelques
princes, fans doute-amateurs de'la mufique, ou
enfin de.quelques- grands hommes-, dont* iis per-
pltaent la mémoire.
Les deux» dérivés dur mode raft font le {enkefa,
qui fîgnifie , en Perfen , une fonnette ; & Yifchak,
qui convient à l’amour prefqif alitant que le ÿraf-
kend.
Ceux- du mode Irak font le rftaiaA K Y'abou feUik ;
on croit que ce dernier porte le nom d?un fameux
-mufieien Arabe..
Ceux du ftrafkend, font le Bourj'ouk, nom d’un
; roi de Perfe , dbnt le régné commença l’an 1124. de
l’ tlre chrétienne ; le rekaui, que les orientaux
mettent au premier rang de modes dérivés.
Enfin ceux de Yisfehan font le noui, qui fignihe
gazoïMlement des oifeaux ; & le HouJJ'eih, nom
d’un fils d’A ly , tué l’an 61 de rH égÿ re, & mis ,.
• par les Perfans „au nombre des martyrs.
Après ces huit mod'es foiiroû , viennent les fix
rn'odês evaçat, c’eff-à-dire mixtes ou compofës.
1. Du raft & de l’înzÆ fe forme le nevrou^ ou
nouveau jour ,, nom que lès Perfans donnent au
premier de- leur année, jour de l’équinoxe du
printeras.
2. Dü: ÿrafkend &Tde Yisfehan fe compofe le
mode Ichehenaç , dont le mouvement -eff doux &
agréable.
3. Du boufrouk & thïçenKtla naît le felmeck.
4. Du rehaut & dii houffeïn eff dérivé le %er-
kefehi L nom d’une étoffe tifffie dé fils d’o r , par
lequel on a voulu, marquer là beauté' 8c la richeffe
de ce modei
y. Le rnaiah & Tabou fetéifé ont dônné le mode
higiaç. Higiaç eff l’Arabie pétrée, oh fe trouve
la mécqUe. La douceur & la-gaieté4de ce mode font
confacrées dan^ une.chanfon arabe.
6. Du noui & de Yifchak dérive-le mode goïifcht
qui' veut dire' ti mbale'd’airaiif.
Mufique, Tome J,
A R A H
A tous çes modes p r in c ip a u xp r iv é s & com-
pofés,il ffrirÉjbtridfèencô-rÊ?féS'fep'tModês' nommes
bouhour nier s % Iî; y-en a *fept. Cé-font
amànti pliràfeS rtuffteales!,. dbnt .chacune commence,
par. l’iintdes, fept intervalles qui compôfent
l’échelle ou gamme arabe.
C ’eft encore des Perfans que les Arabes\ ont
pris & le nom général de ces intérvallës, qiii eff
[ ghiah, & les nonrs de- nombre qu'rfervent à fes de-
figner , ^ ,u n - yya^,fdeux,yi.,;trois ytcharr <Q\ztoe,
penj .cinq ffchef ch, fix , heft, fept.
Ils nomment donc iekghiah le premier de c e i
' modes , commençant au- premier intervalle, dov«
ghiah, celui qui commence par le fécond-, &c.
Leur manière dê noter la mufique eff- de former
, un carré long , coupé par fept lignes droites,
& faifant, avec les deux lignes des extrémités fu-
périéure & inférieure, huit intervalles. Le plus
haiff de ces intervalles eff rempli par de titre : el
: boûd bil koülk'y o’èft-à-dire., intervalle dans tous
les tons., & les fêpt autres, en commençant par
le plus bas,, contiennent les.fept noms de nombre
perfans.
F I G U R E D U M O D E A R A B E,
Chacune de ces lignes, ainfi que le nom dé
BOinbire qui eft ali-dsffus', eft tVune couleur diffé-
renfé; & cette couleur eft auffi importante à retenir
que le n'offl &'l'iutervalle.
- M