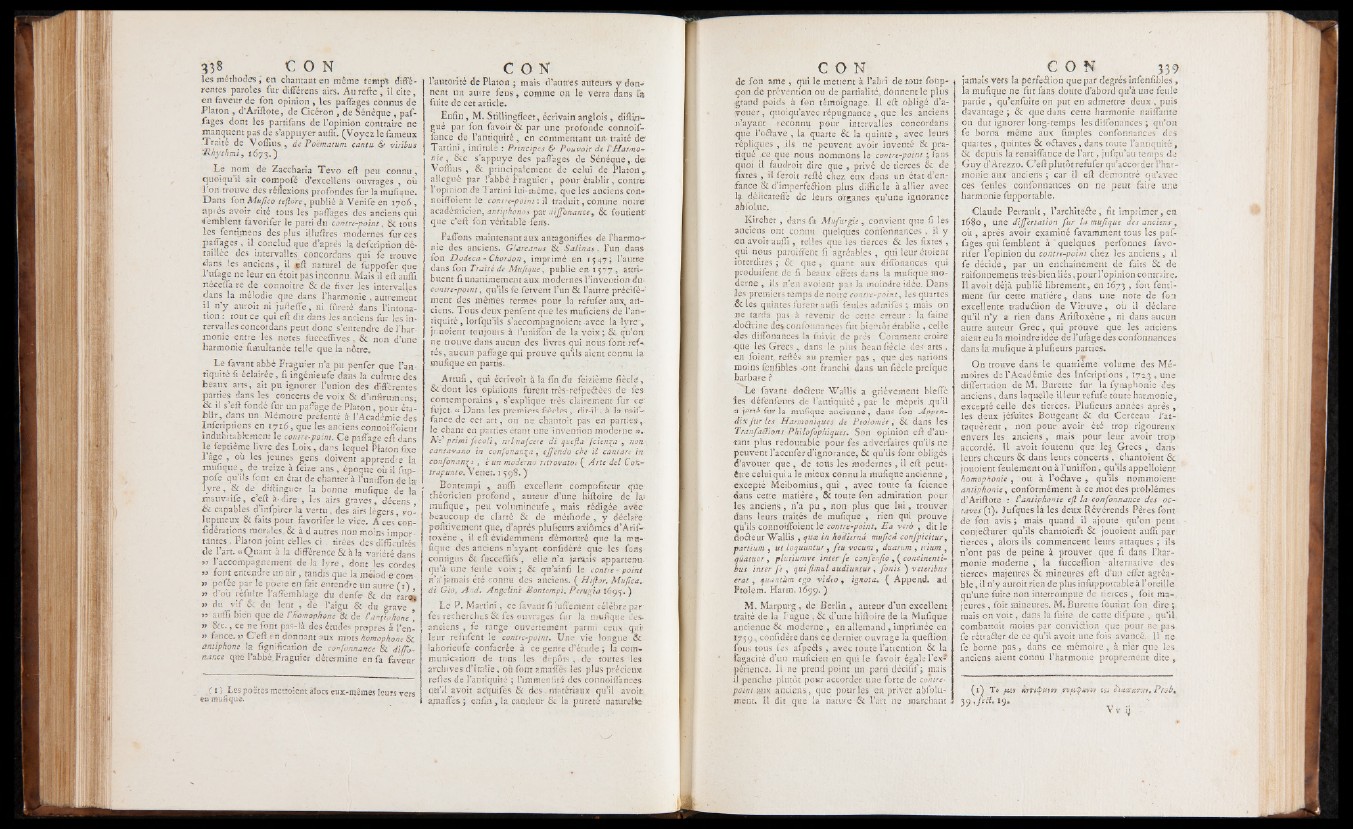
3 3 8 , C O N
les mé thod e sen chantant en même temps différentes
paroles fur différées airs. Aurefte , il cite,
en faveur de fon opinion , les paffages connus de
Platon, d’Ari'ftote, de Cicéron , de Sénèque , paf-
iages dont les partifans de l’opinion contraire ne
manquent pas de s’appuyer aufli, (Voyez le fameux
■ Traité de V o fluis , de Poctnatum cantu. & viribus
Hhythmï, 1673. )
Le nom de Zaccharia Te v o eft peu connu,
quoiqu il ait compofe d’excellens ouvrages , où
1 on trouve des réflexions profondes fur la mufleue.
Dans fon Mufico teftdre, publié à Venife en 1706 ,
apres avoir cite tous les paffages des anciens qui
Semblent favorifer le parti du contre-point, & tous
les fentimens des plus illuflres modernes fur ces
paffages , il conclud que d’après la defeription détaillée
des intervalles concordans qui fe trouve
dans les anciens, il ^ft naturel de fuppofer que
l ’ufage ne leur en étoit pas inconnu. Mais il eft aufli
néc.effa:re de connoître & de fixer les intervalles
dans la meiodie que dans l’harmonie , autrement
il n y auroit ni jufteffe, ni fureté dans l’intonation
: tout ce qui eft dit dans les anciens fur les intervalles
concordans peut donc s’entendre de l'harmonie
entre les notes fucceffives . & non d’une
harmonie fimultanée telle’ que la nôtre.
Le favant abbé Fragnier n’a pu penfer que l’antiquité
fi éclairée, fi ingénieufe dans la cultute des
beaux arts, ait pu ignorer l’union dès différentes
parties dans les concerts de voix & d’inftrumens;
& il s’eft fondé fur un paffage de Platon , pour étab
lir, dans un Mémoire prétenté à l’Académie des
Inferiptions en 17 16 , que les anciens conuoiffoient
indubitablement le contre-point. Ce paffage eft dans
le feptième livre des L o ix , dans lequel Platon fixe
l ’âge , où les jeunes gens doivent apprendre la
mufique , de treize à feïze ans , époque où il fup-
pofe qu’ils four en état de chanter à Punition, de la-
ly r e , & de^ diftinguer la bonne mufique de la
mauvaife, c’eft à-dire , les airs graves, décens
& capables d’infpirer la vertu . des airs légers , voluptueux
& faits pour favorifer le vice. A ces con-
fidérations morales, & à d autres non moins importantes.
Platon joint c'elles ci . tirées des difficultés
de l’art. « Quant à la différence & à la variété dans
si l’accompagnement de la ly r e , dont les cordes
” font entepdre un air, tandis que la mélod-e com
» pofée par le poète en fait entendre un autre (1) ,
» d’où réfui té l ’affemblage du denfe & du rar^,
v du v if & du lent , de l’aigu & du grave ,
” aufli bien que de l’Homophone & de Can[%hone
” Sec-, ce ne font pas-là des études propres a Fen-
” fonce, p C ’eft en donnant aux mots homophone &
antiphone la lignification de confonnance & diffo-
nance que l’abbé„Fraguier détermine en fa faveur
CD Les postes mettoient alors eux-mêmes leurs vers
ea mufique. •
C O N
l’autorité de Platon ; mais d’autres au'teufs y don>
nent un autre feu s , comme on le verra dans l’a-
fuite de cet article.
Enfin, M. Stillingfleet, écrivain anglois , diftin-
gué par fon favoir & par une profonde connoif-
fance de l’antiquité , en commentant un- traité de
Tartinï, intitulé : Principes & Pouvoir de l'Harmonie
, &c. s’appuye des paffages de Sénèque,. de
Voffius , & principalement de celui de Platon,,
allégué’ par l’abbé Fraguier, pour établir ’ contre
l’opinion de T artini lui-même. que les anciens con-
noiffoient le contre-point : il traduit, comme notre
académicien, antiphonos par diffanancer & foutient
que c’eft fon véritable -fens.
Paffons maintenant aux amagoniftes de l’harmo--
nie des anciens. Glareanus & Satinas. l’un dans
fon Dodeca- Chordon, imprimé en 1547; l’autre
dans fon Traité de Mufique, publie en-15 7 7 , attribuent
fi unanimement aux. modernes l’invention dm
contre-point, qu’ils fe fervent l’un & l’autre précifé--'
ment des mèmès termes pour la refufer aux anciens.
Tous deux penfent que les muficiens de l’an--
tiquité, lorfqu’ils s’accompagnoient -avec la lyre y
jonoient toujouts à i’unifion de la voix ; & qU’on
ne tiouve dans aucun des livres qui nous font ref-«.
tés, aucun paffage qui prouve qu’ils aient connu la
mufique en partis-.
Artufi , qui écnvoit à la fin du feizième fièclè,
& dont les opinions furent très-refpedées de les
contemporains , s’explique très clairement fur ce*
fujet. u Dans les premiers fié cl e s , dit-il. à la naif--
fanee de cet art, on ne. chamoit pas en parties,,
le cjiant en parties étant une invention moderne »,
Ne’ primi fecoli, mlnajcere di que fia fcïenqa , non-
cantavano in confonança, ejfendo che il cantate in
confomanq-i, è un moderno tittovatoi ( A rte del Coh--
trapunto. Venet. 1 598. )’
Bontempi , auffi excellent compofiteur que
théoricien profond , auteur d’une hiftoire de lai
mufique , peu volumineufe, mais rédigée, avec
beaucoup de clarté & de méthode , y déclare
positivement que, d'après plufièurs axiomes d’Arif-
toxène , il eft évidemment démontré que la mu--
fique des anciens n’ayant eonfidéré que les fens
contigus & fucceffifs , elle n’a jamais appartenu-
qu’à une feule voix ; & qu’ainfi le contre - point
n Y jamais été connu des anciens. ( Hiflor. Mufica..
di Gïo. And. Angelini Bontempi. Perugia 169 5. )
Le P. Martini, ce Savant fi iuftèment célèbre par
fes recherches & fes, ouvrages fur la mufique dès*
anciens , fe range ouvertement parmi ceux qui
leur refufent le contre-point. Une vie longue &
laborieufe confacrée à ce genre d’ étude ; la communication
de tons les dépôts,.d'e toutes les
archives d’ Italie , où font zmaffês les plus précieux
refies de l’antiquité ; l’immenfité des connoiffanccs
qu’il avoir aequifés & des - matériaux qu’il avoir
aiuaffés ; enfin, la, candeur & la pureté natureiktc
° N
de fon atîie , qui le mettent à l’abri de tout fotip-
<çon de prévention ou de partialité, donnent le plus
grand poids à fon témoignage. Il eft obligé d’avouer
, quoiqu’avec répugnance , que les anciens
n’ayant reconnu pour intervalles concordans
.que l’o&ave , la quarte & la quinte, avec leurs
répliques , ils ne peuvent avoir inventé & pratiqué
.ce que nous nommons le contre-point ; fans
quoi il faudroit dire que , privé de tierces & de
fixtes , il feroit refié chez eux dans un état d’enfance
& d’imperfe&ion plus difficile à allier avec
la délicateffe de leurs organes qu’une ignorance
abfolue.
Kircher, dans -fa Mufurgie , convient que fi les
.anciens ont connu quelques cohfonnances , Ü y
«n avoitrauffi , telles que les tierces & les fixtes ,
qui nous paroiffent fi agréables , qui leur étoient
•interdites ; & q u e , quant aux diffonances qui
produifem de fi beaux effets dans la mufique moderne
, ils n’en avoient paï la moindre idée. Dans
il.es premiers temps de notre contre-point, les quartes
.& les quintes furent auffi feules admifes ; mais on
jje tarda pas à revenir de cette erreur: ia faine
■ doârine des. confonnances fut bientôt établie , celle
'des diffonances la fuivit de près Comment croire
■ que les Grecs , dans le plus beaufiècle des arts,
en foient, reftés au premier pas , que des nations
moins fenfibles -ont franchi dans un fiècle prefque
barbare ?
Le favant da&eur Wallis a grièvement bleffé
les défenfeurs de l’antiquité , par le mépris „qu’il
3t jetté fur la mufique ancienne, dans fon Appen-
dix fur les Harmoniques de Ptolomèe , & dans les
Tranfatiions Philofophiques. Son opinion efi d’autant
plus redoutable pour fes adverfaires qu’iis 11e
peuvent l’acciifer d’ignorance, & qu’ils font obligés
d’avouer que , de tous les modernes , il eft peut-
être celui qui a le mieux connu la mufique ancienne,
excepté Meibomius., qui , avec toute fa fcience
dans cette matière , & toute fon admiration pour
les anciens, n’a pu , non plus que lu i , trouver
dans leurs traités de mufique , rien qui prouve
qu’ils connoiffoient le contre-point. E a verd , dit le
doéteur Wallis , quoe in hoditrnâ mufed confpicitur,
partium , ut Loquuntur, feu vocum, duarum , trium ,
quatuor, pluriurnve inter fe confenfo , ( concinenti-
bus inter fe , qui fimul audiuntur, fonts ) vetenbus
erat, quantum ego video , ignota. f Appead. ad
Ptolem. Harm. 1699. )
M. Marpurg , de Berlin , auteur d’un excellent
traité de la Fugue , & d’une hiftoire de la Mufique
ancienne & moderne , en allemand , imprimée en
1759, confidèredans ce dernier ouvrage la queftion
fous tous f e s àfpeéts , avec toute l’attention & la
Sagacité d’un muficien en qui le favoir égale l’expérience,
Il ne prend point un parti décifif ; mais
il penche plutôt pour accorder une forte de contrepoint
aux anciens , que pour les en priver abfolu-
joiént. Il dit que la nature 6c l ’art ne marchant
C O N 339
jamais-vers la perfeélion que par degrés infenfibles ,
la mufique ne fut fans doute d’abord qu’à une feule
partie , qu’enfuite on put en admettre deux -, puis
davantage ; & que dans cette harmonie naiffante
on dut ignorer long-temps les diffonances ; qu’on
fe borna même aux fimples canfonnances des
quartes , quintes & o&aves, dans toute l’antiquité,
oc depuis la renaiffance de l’ar t, jufqu’au temps de
Guy d’Arezzo. C ’eft plutôt refufer qu’accorder l’harmonie
aux anciens ; car il eft démontré qu’avec
cés feules confonnances on ne peut faire une
harmonie fupportable.
Claude Perrault, l’architéâe, fit imprimer, en
1680 , une dijfertation fur la mufque des anciens ,
où , après avoir examiné favamment tous les pafi
fages qui femblent à * quelques perfonnes favorifer
lopinion du contre-point chez les anciens,, il
fe décide, par un enchaînement de faits & de
raifonnemens très-bien liés, pour l’opinion contraire.
Il avoit déjà publié librement, en 1673 > ^oa l*en£1“
ment fur cette matière, dans une note de fort
excellente traduction de Vitruve, où il déclare
qu’il n’y a rien dans Ariftoxène , ni dans aucun
autre auteur G re c , qui prouve que les anciens
aient eu la moindre idée de l’ufage des confonnances
dans la mufique à plufièurs parties.
On trouve dans le quatrième volume des Mémoires
de l’Académie des Inferiptions , 172.3 , une
differtatiqn de M. Burette fur la fymphoiiie des
anciens, dans laquelle il leur refufe toute harmonie,
excepté celle des tierces. Plufièurs années après ,
les deux jéfuites Bougeant & du Cerceau l’attaquèrent
, non pour avoir été trop rigoureux
envers les anciens , mais pour leur avoir trop
accordé. Il avoit foutenu que les Grecs , dans
leurs choeurs & dans leurs concerts , chantoient &
jouoient feulement ou à l’uniffon, qu’ils appelloient
homophonie , ou à l’oétave , qu’ils nommoient
antiphonie, conformément à ce mot des problèmes
d’Ariftote : C antiphonie eft la confonnance des octaves
(1). Jufques là les deux Révérends Pères font
de fon avis ; mais quand il ajoute qu’on peut
conjeélurer qu’ils chantoieiît & jouoient auffi par
tierces , alors ils commencent leurs attaques ; ils
n’ont pas de peine à prouver que fi dans l’harmonie
moderne , la fucceffion alternative des
tierces majeures & mineures eft d’un effet agréable
, il n’y auroit rien de plus infupportable à l’oreille
qu’une fuite non interrompue de tierces , foie majeures
, foit mineures. M. Burette foutint fon dire ;■
mais on v o it , dans la fuite de cette difpute , qu’il
combattoit moins par conviction que pour ne pas
fe retraiter de ce qu’il avoit une fois avancé. Il ne
fe borne pas, dans ce mémoire, à nier que les
anciens aient connu l’harmonie proprement d ite ,
(D T0 KITltytt'IM .9
3 9 , /t s . 19.
j,eÇavsy ts j cict7rxs-;ii.
V v ij -
Prob..