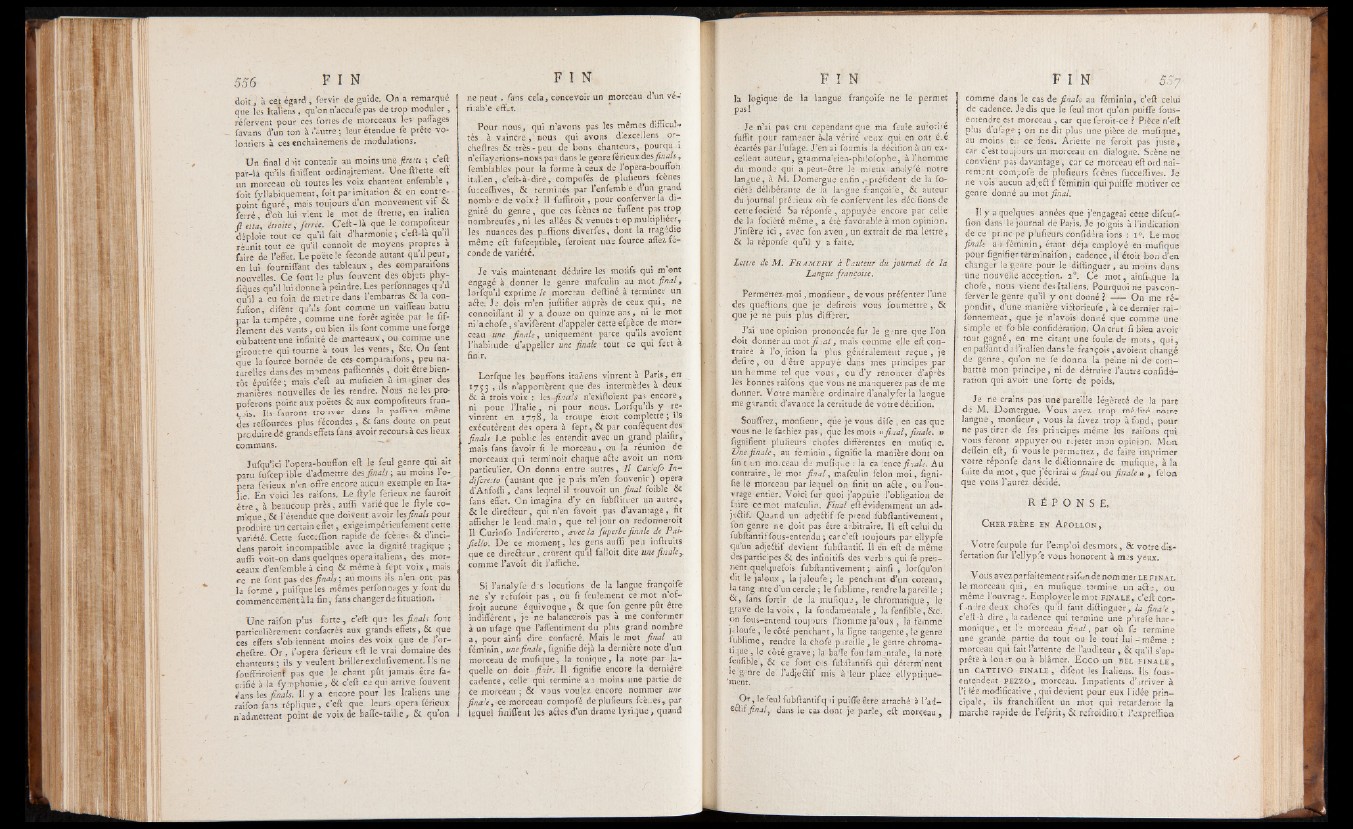
556 FIN
doit 1 à cet égard , fervir de guide. On a remarqué
que les Italiens, qu’on n’accufe pas de trop moduler ,
réfervent pour ces fortes de morceaux les paffages
favans d’un ton a i’iutre ; leur étendue fe prête volontiers
à ces enchaînemens de modulations.
Un final doit contenir au moins une firettc ; c’eft
par-là qu’ils Unifient ordinairement. Une-ftVette-eft
un morceau où toutes les voix chantent enfemble ,
foit fyllabiquement.foit par imitation & en contrepoint
figuré, mais toujours d’un mouvement vif &
ferré, d’où lui vient le mot de ftrette, en italien
fl eau, étroite , ferrée. C ’e ft-là que le compofiteur
déploie tout ce qu’il fait d’harmonie ; c’eft-là qu’il
réunit tout ce qu'il connoît de moyens propres a
faire de l’effet. Le poète le fécondé autant qu’il peut,
en lui fourniffant des tableaux, des comparaifons
nouvelles. Ce font 1 plus Couvent des objets phy-
fiques qu’il lui donne à peindre. Les petfonnages q u’il
qu’il a eu foin de mét ré dans l’embarras & la con-
fufion, difënt qu’ils font comme un vaiffeau battu
par la tempête, comme une forêt agitée par le fif-
flcment des vents, ou bien ils font comme une forge
où battent une infinité de marteaux, ou comme une
girouete qui tourne à tous les vents, &c. On fent
. que la fource bornée de ces-comparaifons | peu naturelles
dans des momens paffionnés , doit être bientôt
épuifée ; mais c’eft. au muficien à im iginer des
manières nouvelles de les rendre. Nousr ne les pro-
poferons point aux poètes & aux compofiteurs français.
Ils fauront trouver dans la paffion même
des reffources plus fécondes , & fans doute on peut
produire dé grands effets fans avoir recours à ces lieux
communs.
Jufqu’ici l’opera-bouffon eft le feul genre qui ait
paru fufcep-ible d’admettre des finals; au moins l’o-
pera férieux n’en offre encore aucun exemple en Italie.
En voici les raifons. Le ftyle férieux ne fauroit
être , à beaucoup près., suffi varié que le ftyle comique
, & l’étendue que doivent avoir les finals pour
produire un certain effet, exige impérieufement cette
variété. Cette fucceffion rapide de fcènes, & d’inci-
dens paraît incompatible avec la dignité tragique ;
auffi voit-on dans quelques opéra italiens, des morceaux
d’enfemble à cinq & même à fept v oix , mais
ce ne font pas des finals/, au moins ils n’en ont pas
la forme , puifqueles mêmes perfonnages y font du
commencement à la fin, fans changer de fituation.
Une raîfon pris forte., c’eft que les finals font
particulièrement confacrés aux grands effets, & que
ces effets s’ob iennent moins des voix que de ,1’or-
cheftre. Or , l’opéra férieux eft le vrai domaine des
chanteurs; ils y veulent briller exclufivement. Ils ne
fouffriroienf pas que le chant pût jamais être fa-
crifié à la fymphonie, & c’eft ce qui arrive fouvent
dans les finals. Il y a encore pour les Italiens une
raifon fans réplique, c’eft que leurs opéra férieux
n’admettent point de voix de baffe-taille , & qu’on
F I N
ne peut . fans cela, concevoir un morceau d’un vé-
riiab'e effet.
Pour nous, qui n’avons pas les mêmes difficut*
tés à vaincre.,'nous qui avons diexcellens or-
cheftres & très-peu de bons chanteurs, pourqu i
n’effayerions-rioHS pas dans le genre férieux des finals ,
femblables pour la forme à ceux de Topera-bouffoh
italien, c’eft-à-dire, compofés de plusieurs fcènes
fucceffives, & terminés par Tenfemb e dun grand
nombr e de voix ? 11 fuffiroit, pour conferver la dignité
du genre, que ces fcènes ne fuffent pas trop
nombreufes, ni les allées & venues trop multipliée?,
les nuances des puffions diverfes, dont la tragédie
même eft fufceptible, feroient une fource affez fécondé
de variété.
Je vais maintenant déduire les motifs qui m ont
engagé à donner le genre mafeulin au mot final,
lorfqu’il exprime le morc?.au deftirré à terminer un
aéfe; Je dois m’en juftifier auprès de ceux qui, ne-
connoiffant il y a douze ou quinze ans, ni le mot
ni !a chofe, s’aviferent d’appeler cette efpèce de morceau
une finale, uniquement pa'ce qu’ils avoient
l’habiiude d’appeller une finale tout ce qui fert à
finir.
Lorfque les bouffons itaZens vinrent à Paris, en
I753 » ils n’apportçrent que des intermèdes a deux
& à trois voix : les-finals n’exifloient pas encore,
ni pour l’Italie, ni pour nous. Lorfqu’ils y revinrent
en 1778, la troupe écoit çomplette; ils
exécutèrent des opéra à fept , & par conféquent des
finals Le public les entendit avec un grand plaifir,
mais fans favoir fi le morceau, ou la réunion de
morceaux qui terminoit chaque a£te avoir un nom
particulier. On donna entre autres, Il Curro/b In-
diferetto (aurant que je pris m’eri fouvenir) opéra-
d’Anfoffi, dans leqnel il trouvoit un final foible &
fans effet.'.'Cri imagina d’y en fubftituer un autre,
& le direâeur, qui n’en favoit pas d’avanràge, fit
afficher le lendemain, que tel jour on redonnerait
Il Curiofo Indifcretto, avec la fuperbe finale de Pai-
fiello. De ce moment, les gens auffi peu inftruits
que ce direâeur , crûrent qu’il fallçit. dire une finaley
comme l’avoit dit l’affiche.
Si l’analyfe d:s locutions de la langue françoife
ne s’y refufoit pas , ou fi feulement ce mot n’of-
froit aucune équivoque , & que fon genre pût être
indifférent, je ne balancerais pas à me conformer
à un ufaoe que l’affentiment du plus grand nombre
a , pour ainfi dire confaçré. Mais le mot final au
féminin, une finale, fignifie déjà la dèrnière note d’un
morceau de mufique, la tonique, la note par laquelle
on doit fi-iir. Il fignifie encore la dernière
cadence, celle qui termine au moins une partie de
ce morceau ; & vous voulez encore nommer une
f in a le , c e morceau compofé deplufieurs fcè-.es,, par
lequel finiffeat les a&esd’un drame lyrique, quand
F ï N
la logique de la langue françoife ne le permet
pas!
Je n’ai pas cru cependant que ma feule autorité
fuffît pour ramener à-la vérité ceux qui en ont é.e
écartés pari’ufage. J’en ai fournis la décifion à un excellent
auteur, grammairien-philofophe, à l’homme
du monde qui a peut-être le mieux analyfé notre
langue, à M. Domergue enfin ,-président- de la fociété
délibérante de la langue françoife, & auteur
du journal précieux où fe confervent les décrions de
cette fociété Sa réponfe , appuyée encore par celle
de la fociété même , a été favorable à mon opinion.
J’infère ic i, avec fon aveu, un extrait de ma lettre,
& la réponfe qu’il y a faite.
Lettre de M. F r a m e r y à l'auteur du journal de la
Langue françoise.
Permettez-moi, monfieur, de vous préfenter l’une
des queftions que je defirois vous foumettre , &
que je ne puis plus différer.
J’ai une opinion prononcée fur le gfnre que l’on
doit donner au mot f i tal, mais comme elle eft contraire
à l’opinion la plus généralement reçue , je
defire, ou d‘être appuyé dans mes principes par
un homme tel que vous, ou d’y renoncer d’après
les bonnes raifons que vous ne manquerez pas de me
donner. Votre manière ordinaire d’analyfer la langue
me girantic d’avance la certitude de votre décifion.
Souffrez, monfieur, que je vous dife , en cas que
vous ne le fâchiez pas , que les mots « final, finale. »
fïgnifient plufieurs choies différentes en mufiq :e.
Une,finale, au féminin, fignifie la manière dont on
fin t tn mo.ceau di mufique : la ca ience finale. Au
contraire, le mor final, mafeulin félon moi, fignifie
le morceau par lequel on finit un a<fte, ou l’ou-.
vrage entier. Voici fur quoi j’appuie l’obligation de
faire ce mot mafeulin. Final eft évidemment un ad-
j^éfif. Quand un adjeéfif fe prend fubftantivement,
fon genre ne doit pas être arbitraire. Tl eft celui du
fubftàntif fous-entendu ; car c’eft toujours par ellypfe
qu’un adje&if devient fubftàntif. Il en eft de même
des participes & des infinitifs des verbes qui fe prennent
quelquefois fubftantivement; ainfi , lorfqu’on
dit le jaloux, la jaloufe; le penchmt d’un coteau,
la tang nte d’un cercle ; le fublime-, rendre la pareille ;
& , fans fortir de la mufique, le chromatique, le
grave de la voix , la fondamentale , la fenfiblé, &c.
on fous-entend toujours l’homme ja'oux , la femme
jaloufe, le côté penchant, la ligne tangente, le genre
f ublime, rendre la chofe p .irefile , le genre chromatique
, le côté grave; la baffe fondamentale, la noté
fenfible, & ce font ces fubftantifs qui déterm'nent
le genre de l’adje&if mis à leur place êllyptique-
‘rnent.
O r , le feul fubftàntif qii puiffe être attaché à l ’ad-
e«i i final j dans le cas dcfht je parle, eft morceau ,
FIN 557
comme dans le cas de finale au féminin, c’eft celui
de cadence. Je dis que le feul mot qu'on puiffe fous-
entendre est morceau, car que feroit-ce ? Pièce n’eft
plus d’ufage ; on ne dit plus une pièce de mufique,
au moins ëi: ce fens. Ariette ne feroit pas juste,
car c’eSt toujours un morceau en dialogue. Scène ne
convient pas davantage 3 car ce morceau eft ord nai-
>■ rem.nt compofé de plufieurs fcènes fucceffives. Je
ne vois aucun ad;e£ff féminin qui puiffe motiver ce
genre donné au mot final.
Il y a quelques années que j’engageai cette difeuf-
fion dans le journal de Paris. Je joignis à l'indication
de ce ‘ prme pe plufieurs confidéra ions : i° . Le mot
finale au féminin, étant déjà employé en mufique
pour fignifier terminaifon, cadence, il étoit bon d’en
changer le genre pour le diftinguer, au moins dans
-une nouvelle acception. 20. Ce mot, ainf^que la
chofe, nous vient des Italiens. Pourquoi ne pas conferver
le genre qu’il y ont donné? ---- On me répondit,
d’une manière viftorieufe , à ce dernier rai-
; fonnement, que je n’avbis donné que comme une
simple et fo ble confidération. On crut fi bien avoir
1 tout gagné, en me citant une foule,de mots, qui,
; en paffant ds l’italien dans le françois, avoient changé
de genre, qu’on ne fe donna la peine ni de combattre
mon principe, ni de détruire l’autre confidération
qui avoit une forte de poids.
Je ne crains pas une pareille légèreté de la part
de M. Domergue. Vous avez trop médité notre
langue, monfieur, vous la favez trop à fond, pour
ne pas tirer de fas principes même les raifons qui
vous'feront appuyer ou rejeter mon opinion. Mon
deffein eft, fi vousie permettez, de faire imprimer
votre réponfe dans le dl&ionnaire de mufique, à la
fuite du mot, que j’écrirai « final ou finale » , félon
que vous l’aurez décidé.
R É P O N S E .
C her frère en A pollon,
Votre fcupule fur l’emploi des mots, & votre dissertation
fur l’ellÿp'e vous honorent à mes yeux.
V oùs avez parfaitement raifon de nom mer le f inal
le morceau qui, en mufique termine un a6te, ou
même l’ouvrage. Employer le mot finale, c’eft cor»
f <n jre deux chofes qu’il faut diftinguer, la finale
c’eft-à dire , la cadence qui termine une p'ira Te harmonique,
et Te morceau final, par où fe termine
une grande partie du tout ou le tout lui - même :
morceau qui fait l’attente de l’au d iteu r& qu’il s’apprête
à louir ou à blâmer. E c c o un bel f in a l e ,
un ca ttivo finale , difent les Italiens. Ils fous-
entendent pe z zo , morceau. Impatients d’arriver à
Ti lée modificative , qui devient pour eux l'idée principale,
ils franchiffent un mot qui retarderait la
marche rapide de l’efjirit, & refroidirait l’expreffion