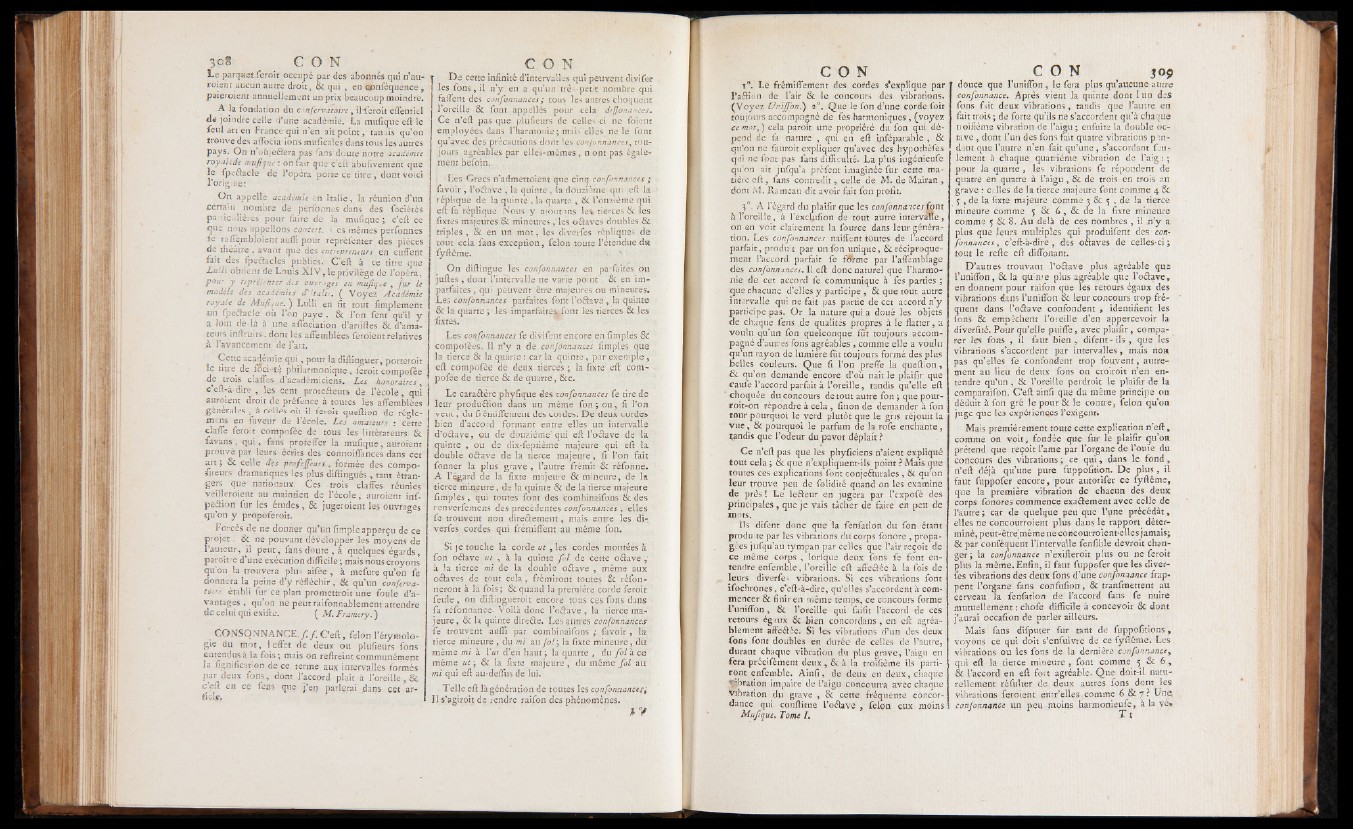
3 o S € O N
L e parquet feroit occupé par des abonnés qui n’au-
roient aucun autre droit, 8c qui , en oonféquènce,
paieroient annuellement un prix beaucoup moindre.
A la fondation du c mfervatoire, ilferoit effentiel
de joindre celle d’une académie. La mufique eft le
leul art en France qui n’en ait point, tandis qu’on
trouve des affocia ions muficales dans tous les autres
pays. On n’objeélerapas fans doute notreacadémie
royaUde mufique : on lait que c’eft abufivement que
le fpeélacle de l ’opéra porte ce titre , dont voici
l ’origne:
On appelle académie en Italie, la réunion d’un
certain nombre de perfonnes dans des fociétés
pa iiculieres pour faire de la mufique ; c’eft ce
.que nous appelions concert. \ es mêmes perfonnes
fe raflembloient auffi pour repréfenter des pièces
de théâtre, avant que des entrepreneurs en euffent
fait des fpectacles publics. C ’eft à ce titre que
Lullï obtient de Louis X IV , le privilège de l’opéra,
pour^ y représenter des ouvrages en mufique , fur le
modèle des académies d'hall:, ( Voyez Académie
royale de Mufique. ) Lulli en fit tout fimplement
un fpe&acle ou l’on paye , & l ’on fent qu’il y
a loin de-là à une afiociation d’artiftes 8c d’amateurs
inftiüits, dont lés affemblées feroient relatives
à l’avancement de l’art.
Cette académie qui, pour la diftinguer, porteroit
le titre de fociete philarmonique , feroit compofée
de trois claffes d académiciens. Les honoraires, «
c ’eft-à-dire , les cent protecteurs de l’école, qui I
auroient droit de préfence à toutes lès affemblées I
generales , à celles où il feroit queftion de régle-
insns en faveur de 1 ecole. Les amateurs ; cette
claffe feroit compofée de tous les littérateurs 8c
favans , q u i, fans profeffer la mufique, auroient
prouvé par leurs écrits des connoiffances dans cet
art ; 8c celle dès profiefieurs , formée des composteurs
dramatiques les plus diftingués , tant étrangers
que nationaux. Ces trois cia fies réunies
veilleroient au maintien de l ’école , auroient inf-
pèétion fur les études , 8c jugeroient les ouvrages
qu’on y propoferoit.
Forcés de ne donner qu’un fimple apperçu de ce
projet. 8ç ne pouvant développer les moyens de
l ’auteur, il peut, fans doute , à quelques égards,
paroître d’une exécution difficile ; mais nous croyons
qu’on la trouvera plus aifée , à mefure qu’on fe
donnera la peine d’y réfléchir, 8c qu’un conferva-
toire établi fur ce plan promettroit une foule d’avantages
, qu’on ne peut raifonnablement attendre
.de celui qui exifte. ( M. Framery. )
CONSONNANCE. fi. f i C ’e ft, félon l ’étymologie
du mot, 1 effet de deux ou plufieurs fons
entendus a la fois ; mais on reftreint communément
Ja lignification de ce terme aux intervalles formés
par deux fons, dont l ’accord plaît à l ’oreille, 8c
c.eft eij cç feus que j’en parlerai flans cet article.
C O N
De cette infinité d’intervalles qui peuvent divifee
les fons, il n’y en a qu’un trè--petit nombre qui
faffent des confionnances; tous les autres choquent
l’oreille 8c font appelles pour cela dtjjonances.
Ce n’eft pas que plufieurs de celles-ci ne foient
employées dans l’harmonie; mais elles ne le font
qu’avec des précautions dont les confionnances, toujours
agréables par elles-mêmes , n ont pas également
befojn.
Les Grecs n’admettoient que cinq confionnances ;
favoir , l’oétave , la quinte , la douzième qui eft la
réplique de la quinte, la quarte , 8c l’onzième qui
eft fa réplique Nous y ajoutons le% tierces 8c les
fixtes majeures 8c mineures ,'les oélaves doubles 8c
triples , 8c en un mot, les divérfes répliques de
tout cela fans exception, félon toute l’étendue du
fyftême. •. 1
On diftingue les confionnances en parfaites ou
juftes, dont l’intervalle ne varie point , 8c en imparfaites
, qui peuvent être majeures ou mineures.
Les confionnances parfaites font l’o&ave , la quinte
8c la quarte les imparfaitesjfont les tierces 8c les
fixtes.
Les confionnances fe divifent encore en fimples 8c
compofées. Il n’y a de confionnances fimples que
la tierce 8c la quarte : car la quinte , par exemple,
eft compofée de deux tierces ; la fixte eft compofée
de tierce 8c de quarte, 8cc.
Le caraâère phyfique des -confionnances fe tire de
leur produélion dans un même fon ; o u , fi l’on
v e u t, du frémiffement des cordes. De deux cordes
bien d’accord formant entre elles un intervalle
d’oélave, ou de douzième’ qui eft l’oélave de la
quinte , ou de dix-feptième majeure qui eft la
double oâave de la tierce majeure, fi l’on fait
fonner la plus g ra ve , l’autre frémit 8c réfonne.
A l’égard de la fixte majeure 8c mineure, de la
tierce mineure, de la quinte 8c de la tierce majeure
fimples, qui toutes font des combinaifons & des
renverfemens des précédentes confionnances,,belles
fe trouvent non directement, mais entre les di-,
verfes .cordes qui frémiffent au même fon.
Si je touche la corde ut , les cordes montées à
fon oélave ut , à la quinte fiol de cette oétave ,-
à la tierce mi de la double oéïave , même aux
oâaves de tout ce la , frémiront toutes 8c réfon-
neront à la fois; 8c quand la première corde feroit
feule , on diftingueroit encore tous ces fons dans
fa réfonnance- Voilà donc l’oéfave , la tierce majeure
, 8c la quinte directe. Lés autres confionnances
fe trouvent auffi par combinaifons ; favoir , la
tierce mineure , du mi au /o/; la fixte mineure, du
même mi à Yut d’en haut ; la quarte , du fiol à ce
même ut ; 8c la fixte majeure, du même fiol au
mi qui eft au-deffus de lui.
Telle eft là génération de toutes les confionnances;
Il s’agiroit de rendre raifon des phénomènes.
§ |
C O N
t°. Le frémiffement des cordes s*explique par
l’a&ion de l ’air 8c le concours des vibrations.
(Voyez UniJJon.') a0. Que le fon d’une corde foit
toujours accompagné dé fes harmoniques , (voyez
ce mot fi) cela paroît une propriété du fon qui dépend
de fa nature , qui en eft ipféparable , 8c
qu’on ne fauroit expliquer qu’avec des hypoïhèfes
qui ne font pas fans difficulté. La plus ingénieufe
qu’on ait jufqu’à jaréfent imaginée fur cette matière
eft , fans contredit, celle de M. de Mairan ,
dont M. Rameau dit avoir fait fon profit.
3°. A l'égard du plaifir que les confionnances io nt
à l’oreille, à l’excliffion debout autre intervafie,
on en voit clairement la fource dans leur génération.
Les confionnances naiflent foutes de l ’accord
parfait, produit par un fon unique, 8c réciproquement
l’accord parfait fe forme par l’affemblage
des confionnances. Il eft donc naturel que l’harmonie
de cet accord fe communique à fes parties ;
que chacune d’elles y participe , 8c que tout autre
intervalle qui ne fait pas partie de cet accord n’y
participe pas. Or la nature qui a doué les objets
de chaque fens .de qualités propres à le flatter, a
voulu qu’un fon quelconque fut toujours accompagné
d’autres fons agréables, comme elle a voulu
qu’un rayon de lumière fût toujours formé des plus
belles couleurs. Que fi l’on preffe la queftion,
8c qu’on demande encore d’où naît le plaifir que
caufe l’accord parfait à l’oreille, tandis qu’elle eft
choquée du concours de tout autre fon ; que pour-
roit-on répondre à cela , finon de demander à fon
tour pourquoi le verd plutôt que le gris réjouit la
v u e , 8c pourquoi le parfum de la rofe enchante,
tandis que l ’odeur du pavot déplaît ?
C e n’eft pas que les phyficiens n’aient expliqué
tout cela ; 8c que n’expliquent-ils point ? Mais que
toutes ces explications font conjeâurales , 8c qu’on
leur trouve peu de folidité quand on les examine
de près ! Le leéteur en jugera par l’expofé des
principales, que je vais tâcher de faire en peu de
mots.
Ils difent donc que la fenfation du fon étant
produite par les vibrations du corps fonore , propagées
jufqu’au tympan par celles que l’air reçoit de
ce même corps , lorlque deux fons fe font entendre
enfemble, l’oreille eft affeétee à la fois de
leurs diyerfes vibrations. Si ces vibrations font
ifochrones, c’ eft-à-dire, qu’elles s’accordent à commencer
8c finir en même temps, ce concours forme
l ’uniffon, 8c l’oreille qui faifit l’accord de ces
retours égaux 8c bien concordans , en eft agréablement
aftè&éè. Si les vibrations d’ un des deux
fons font doubles en durée de celles de l’autre,
durant chaque vibration du plus grave, l’aigu en
fera précifément deux, 8c à la troifième ils partiront
enfemble. Ainfi , de deux en deux, chaque
’fàbration impaire de l’aigu concourra, avec chaque
vibration du grave , 8c cette fréquente concordance
qui conftitue l’oétave , félon eux moins
Mufique. Tome l%
C O N 3 0 9
’ douce que l ’iiniffon, le fera plus qu’aucune autre
conformance. Après vient la quinte dont 1 un des
fons fait deux vibrations, tandis que l’autre en
fait trois; de forte qu’ils ne s’accordent qu’à chaque
troifième vibration de l’aigu ; enfuite la double octave
, dont l’un des fons fait quatre vibrations pendant
que l’aiitre n’en fait qu’une , s’accordant feu *
lement à chaque quatrième vibration de l’aiga ;
peur la quarte , les vibrations fe répondent de
quatre en quatre à l’aigu , 8c de trois en trois ali
grave r Celles de la tierce majeure font comme 4 8c
5 , de la fixte majeure comme 3 8c 5 , de la tierce
mineure comme 5 8c 6 , 8c de la fixte mineure
comme 5 8c 8. Au delà de ces nombres , il n’y a
plus que ,leurs multiples qui produifent des confionnances
, c’eft-à-dire , des oétaves de celles-ci ;
tout le refte eft diffonant.
D ’autres trouvant l’oâave plus agréable que
l’uniffon, 8c la qtfme plus agréable que l’oélave,
en donnent pour raifon que les retours égaux des
vibrations dans l’uniffon 8c leur concours trop fréquent
dans l’oâavë confondent , identifient les
Ions 8c empêchent l ’oreille d’en appercevoir la
diverfité. Pour qu’elle puiffe, avec plaifir, comparer
lés fons , il faut bien , difent-ils , que les
vibrations s’accordent par intervalles, mais non
pas qu’elles fe confondent trop fouyent, autrement
au lieu de deux fons on croiroit n’en entendre
qu’u n , 8c l’oreille perdroit le plaifir de la
compàraifon. C ’eft ainfi que du même principe on
déduit à fon gré le pour 8c le contre, félon qu’on
juge que les expériençes l’exigent.
Mais premièrement toute cette explication n’e ft,
comme on voit9 fondée que fur le plaifir qu’on
prétend que reçoit l’ame par l’organe de l’ouïe du
concours des vibrations ; ce qui, dans le fond,
n’eft déjà qu’une pure fuppofition. De p lu s , il
faut fuppofer encore , pour autorifer ce lyftême,
que la première vibration de chacun des deux
corps fonores commence exa&ement avec celle de
l’autre ; car de quelque peu que l’une précédât,
elles ne concourroient plus dans le rapport déterminé,
peut-être’même ne coucourroient-elles jamais;
8c par conféquent l’intervalle fenfible devroit changer;
la confionnance n’exifteroit plus ou ne feroit
plus la même. Enfin, il faut fuppsfer que les diverses
vibrations des deux fons d’une confionnance frappent
l’organe fans confufion, 8c tranfmettent au
cerveau la fenfation de l ’accord fans fe nuire
mutuellement : chofe difficile à concevoir 8c dont
j’aurai occafion de parler ailleurs.
Mais fans difputer fur tant de fuppofifions,
voyons ce qui doit s’enfuivre de ce fyftême. Les
vibrations ou les fons de la dernière confionnance,
qui eft la tierce mineure , font comme 5 Sc 6 ,
& l’accord en eft fort agréable. Que doit-il naturellement
réfulter de deux autres fons dont les
vibrations feroient entr’elles,comme 6 8c 7 ? Une;
conj-onnance un peu moins harmonieufe, à la vé»