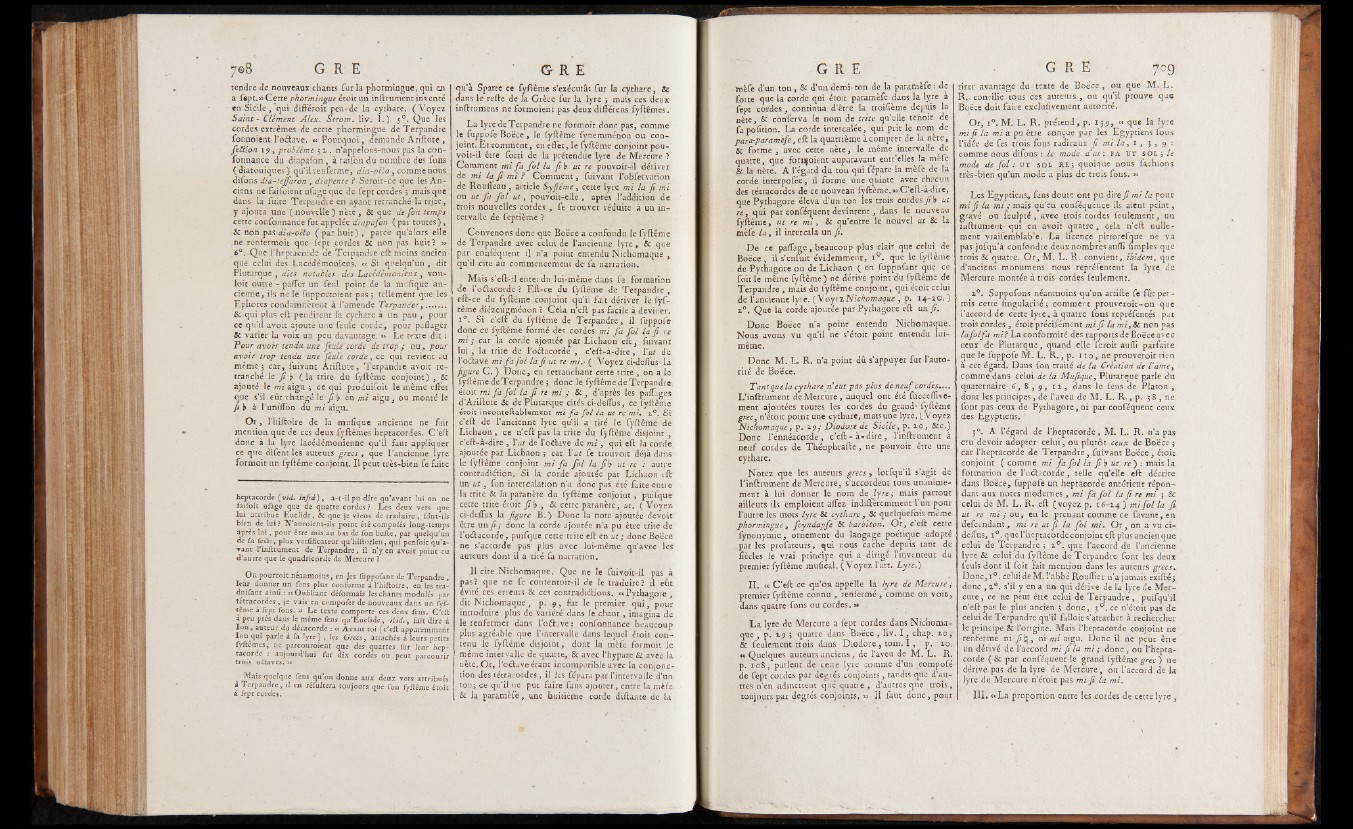
tendre de nouveaux chants fur la phorminguè, qui en
a fept.M Cette phorminguè étoit un inftrument inventé
en S ic ile , qui différoit peu-de la cythare. (V o y e z
Saint- Clément' Alex. Strom. liv. I . ) j ° , Que les
cordes extrêmes de cette phorminguè de Terpandre
fonnoient l’o&ave. «« Pourquoi, demande Ariftote ,
feélion 19 y problème 5 1 , n’appelons-nous pas la con-
fonnance du diapafon, à raifon du nombre des fous
( d iatoniques) qu’il renferme, dia-oüo , comme nous
difons dia-tejfaron , diapente ? Seroit-ce que les A n ciens
ne Faifoient ufagc que de fept cordes ; mais que
dans la fuite Terpandre en ayant retranché la trite, '
y ajouta une ( nouvelle ) nète , & que de fon temps
cette confonnance fut appelée diapafon ( par toutes),
& non pas dia^cbto (p a r huit) ,1 parce qu’alors elle
ne reofermoit que fept .cordes & non pas huit ? »
.6°. Que l’hcptacorde de Terpandre eft moins ancien-
que celui des Lacédémoniens, ce Si quelqu’un , dit
Plutarque, dits notables des Lacédémoniens , vou-
loit outre - palier un feul point de la mufique ancienne
, ils ne le lupportoient pas ; tellement que les
Ephores condamnèrent à l’amende Terpander, ..........
& qui plus eft pendirent fa cythare à un pau , pour
ce qu’il avoit ajouté une feule corde, pour paffager
& varier la voix un peu davantage. » Le texte dit :
Pour avoir tendu une feulé'corde de trop j o u , pour
avoir trop tendu une feule corde, ce qui revient au
mêm e; ca r, fuivant Ariftote, Terpandre avoit retranché
le f i b ( la trite- du fyftême conjoint) , &
ajouté le mi aigu ; ce qui produifoit- le même effet
que s’il eût changé le fi\> en mi a igu , ou monté le
ƒ/ b à l’ uniffon du mi aigu.
O r , l’hiftoire de la mufique ancienne ne fait
mention que de ces deux fyftêmes heptacordes. C ’eft
donc à la lyre lacédémonienne qu’il faut appliquer
ce que difent lès auteurs grecs, que l ’ancienne lyre
formoit un fyftême conjoint. Il peut très-bien fe faire
heptacorde (vid. infra') , a-t-il pu dire qu’avant lui on ne
fâifoit ufage que de quatre cordes? Les deux vers que
lui attribue Euçlide, & que je viens de traduire, font-ils
bien de lui ? N ’auroient-ils point été compofés long-temps
après lu i , pour être mis au bas de fon bulle, par quelqu’ un
de fa fe&e, plus verlîficateur qu’h illorien, qui penfoit qu’avant
l’inftrument de Terpandre, i l 'n ’y en avoit point eu
d’alicre que le quadricorde de Mercure ?
On pourroit néanmoins, en Jes fuppofant de Terpandre,
leiff donner un fens plus conforme à l’hiftoirc, en les tra-
duifant ainfî : ce Oubliant déformais les chants modulés par
tétracordes, je vais en compofer de nouveaux dans un fyf-
teme a fept fons. » L e texte comporte ces deux lèns. C ’eft
à peu près dans le même fens qu’Euclide, ibïd. , fait dire à
Io n , auteur du décacorde : « A v a n t toi ( c ’eft apparemment
Ion qui parle a fa lyre ) , les Grecs, attachés à leurs petits
fyftêmes, ne parcouraient que des quartes fur leur heptacorde
: aujourd’hui fur dix cordes on peut parcourir
trois oiftaves.'»
Mais quelque lèns qu’on donne aux deux vers attribués
i Terpandre, il en réfultera toujours que fon fyftême étoit
à fept cordes.
qu’à Sparte ce fyftême s’exécutât fur la cythare, &
dans le refte de la Grèce fur la lyre ; mais ces deux
inftrumens ne formoient pas deux différens fyftêmes.
La lyre de Terpandre rie formoit donc pas, comme
le fuppofe Bo’é c e , le fyftême lÿnemménon ou conjoint.
E t comment, en effet, le fyftême conjoint pou-
voit-il être forti de la prétendue lyre de Mercure ?
Comment mi fa fo l la fi b ut re pouvoit-il dériver
de mi la fi mi ? Comment, fuivant robfervàtion
de Rouffeau, article SyfiêmCy cette lyre mi la f i mi
ou ut fa fo l ut, pouvoit-clle , après l’addition de
trois nouvelles cordes , fe trouver réduite à un intervalle
de feptième J
Convenons donc que Boëce a confondu le fyftême
de Terpandre avec celui de l’ancienne ly r e , & que
par conféquent il n’a point entendu Nichomaque ,
qu’il cite au commencement de' fa narration.
Mais s’eft-il enter: du lui-même dans fa formation
de l’o&acorde ? Eft-ce du fyftême de Terpandre ,
eft-ce du fyftême conjoint qu’i! fait dériver le fÿf-
tême diézeugménon ? C e la n’eft pas facile à deviner.
i ° . Si c’eft du fyftême de Terpandre, il fbppofe
donc ce fyftême formé des cordes mi fa fo l la f i re
mi ÿ car la corde ajoutée par Lichaon e f t , fuiyant
lu i , la trite de l’o&acorde , c’eft-à-dire, Y ut de
l’o&ave mi fa fo l la f i ut re mis ( V o y e z ci-deffus la
figure C . ) D o n c , en retranchant cette trite , on a le
; fyftême de Terpandre; donc le fyftême de Terpandre
étoit mi fa fo l la f i re mi j & , d’après les paffages
d’Ariftote & de Plutarque cités ci-deffus, ce fyftême
étoit inconteftablement mi fa fo l la ut rémi. i ° . Si
c’eft de l’ancienne lyre qu’il a tiré Je fyftême de
Lichaon , ce n’ eft pas la trite du fyftême disjoint ,
c ’eft-à-dire , l'ut de l’oélave de mi , qui eft la corde
ajoutée par Lichaon ; Car l'ut fe trouvoit déjà dans
le fyftême conjoint mi fa fo l la fi\> ut re : autre
contradiéUon. Si la corde ajoutée par Lichaon eft
un ut} fon intercalation n’a donc pas été faite entre
la trite & la paranète du fyftême conjoint, puifque
cette trite écoit f i b , & cette paranète, ut. (V o y e z
ci-deffus la figure B .) Donc la note ajoutée devoit
être un f i y donc la corde ajoutée n’a pu être trite de
l’oftacorde, puifque cette trite eft en ut ; donc Boëce
ne s’accorde pas plus avec lui-même qu’avec les
auteurs dont il a tiré fa narration.
Il cire Nichomaque. Que ne le fuivoit-il pas à
pas? que ne fe contentoit-il de le traduire? il eût
évité ces erreurs & ces contradictions. «Pythagore ,
■ dit Nichomaque, p. 9 , fut le premier q u i, pour
introduire plus de variété dans le ch ant, imagina de
le renfermer dans l’o é h v e ; confonnance beaucoup
plus agréable que l’intervalle dans lequel étoit contenu
le.fyftême disjoint, dont la mèfe formoit le
même intervalle de quarte, & avec Phypate & avec la
nète. Or, roda ve étan t incompatible avec la conjonction
des tétracordes, il les fépara par l’intervalle d’un
ton; ce qu’il ne put faire fans ajouter, entre la,mèfe
& la paramèfe, une huitième corde diftante de la
mjfe d’un to n , & d'un demi- ton de la paramèfe : de
forte que la corde qui étoit paramèfe dans la lyre a
fept cordes , continua d’être la troifième depuis la
nète, & conferva le nom de trite qu’elle tenoit de
fapofition. La corde intercalée, qui prit le nom de
para-paraméfe, eft la quatrième à compter de la nète,
& forme , avec cette nète, le même intervalle de
quarte, que fornfoient auparavant entr’elles la mèfe
& la nète. A l’égard du ton qui fépare la mèfe de la
corde interpofée, il forme une quinte avec chacun
des tétracordes de ce nouveau fyftême. »3 C ’cft-à-dire,
que Pythagore éleva d’un ton les trois cordes b ut
re y qui par conféquent devinrent, dans le nouveau
fyftême, ut re mi, Si qu’entre le nouvel ut & la
mèfe la\ il intercala un fi.
De ce paffage, beaucoup plus clair que celui de
Boëce , il s’enfoit évidemment, i ° . que le fyftême
de Pythagore ou de Lichaon ( en fuppofant que ce
foit le même fyftême) ne dérive poinc du fyftême de
Terpandre, mais du fyftême conjoint, qui étoit celui
de l’ancienne lyre. ( V o y e z Nichomaque , p. 14-10. )
i ° . Que la corde ajoutée par Pythagore eft un fi.
Donc .Boëce n’a point entendu Nichomaque.
Nous avons vu qu’il ne s’étoit point entendu lui-
même.
Donc M . L. R . n’a point dû s’appuyer fur l’autorité
de Boëce.
Tant que la cytharen eut pas plus de neuf cordes....
L ’inftrument de Mercure » auquel ont été fucceffive-
ment ajoutées toutes les cordes du grand- fyftême
grec y n’étoit point une cythare, mais une lyre. (V o y e z
Nichomaque y p. 19/ Diodore de Sicile, p; i o , & c .)
Donc l’ennéacorde , c’c f t - à - d i r e , rinftrument à
neuf cordes de Théophrafte, 11e pouvoit être une
cythare.
N otez que les auteurs grecs, lorfqu’il s’agit dé
l’ inftrument de Mercure, s’accordent tous unanimement
à lui donner le nom de lyre; mais partout
ailleurs ils emploient affez indifféremment l’un pour
l ’autre les mots lyre Si cythare, Si quelquefois même-
phorminguè y fcyndapfe Si barbiton. O r , c eft cette
fynonymie, ornement du langage poétique adopté
pa rles profateuts, qui nous ca ch ejdepuis tant de
fiècles le vrai principe qui a dirigé l’inventeur du
premier fyftême raufical. (V o y e z l’art. Lyre.)
II. ce C ’eft: ce qu’on appelle là lyre de Mercure y
premier fyftême connu , renfermé , comme on voiû,
dans quatre fons ou cordes. »
L a lyre de Mercure a fept cordes dans Nichomaque
, p. 19 ; quatre dans Boëce , liv. I , chap. 10 ,
& feulement trois dans Diodore , tom. I , p. lo t
«c Quelques auteurs anciens, de l’aveu de M . L . R.
p. 168, parlent de cette lyre comme d’un (compofé
de fept cordes par degrés conjoints, tandis que d’autres
n’en admettent que quatre , d’autres que tro is,
toujours par degrés conjoints, » Il faut donc, pour
tirer avantage du texte de B o e c e , ou que M . L .
Ré concilie tous ces au teurs, ou qu’il prouve qua
Boëce doit faire exclufiveinent autorité.
O r , i ° . M. L . R . prétend, p. 13 9 , « que la lyre
mi f i la mi a pu être conçue par les Egyptiens fous
l’idée de fes trois fons radicaux f i mi la, 1 , 3 , 9 :
comme nous difons- : le mode d!ut : fa u t so l ; U
mode de fol.:.u t so l r e ; quoique nous fâchions
très-bien qu’un mode a plus de trois fous. «
Les Egyptiens* fans doute ont pu dire f i mi la pour
mi f i la mi ; mais qu’en conféqucnce ils aient peint,
gravé ou fculpté, avec trois cordes feulement, un
inftrument qui en avoit quatre, cela n’eft nullement
vraifemblab'e. La licence pittorefque ne va
pas jufqu’ à confondre deux nombres aufli fimples que
trois & quatre. O r , M . L . R. convient, ibidem, que
d’anciens monumens nous repréfentent la lyre de
Mercure montée à trois cordes feulement.
i ° . Suppofons néanmoins qu’un artifte fe fût permis
cette fingularité ; comment prouveroit-on que
i’àccord de cette lyre, à quatre fons repréfentés par
trois cordes, étoit précifément mi f i la mi t Sa non pas
lafolfa mil La conformité des rapports de Boëce avec
ceux de Plutarque, quand elle feroit aufli parfaite
que le fuppofe M . L . R . , p. 1 1 0 , ne prouveroit rien
à cet égard. Dans fon traité de la Création de Came y
comme dans celui de la Mufique, Plutarque parle du
quaternaire 6 , 8 , 9 , 1 1 , dans le fens de Platon ,
dont les principes, de l’aveu de M . L . R . , p. 3 8 , ne
font pas ceux de P y th ago re,n i par conféquent ceux
des Egyptiens. '
3°. A l’égard de l ’heptacorde, M. L . R . n’a pas
cru devoir adopter- celu i, ou plutôt ceux de Boëce ;
car l’heptacorde de Terpandre, fuivant B o ë c e , étoic
conjoint ( comme mi fa fo l la f i b ut re) : mais la
formation de l’cftacord e, telle qu’elle eft: décrite
dans Boëce, fuppofe un heptacorde antérieur répondant
aux notes modernes , mi fa fo l la f i re mi ; &
celui de M. L . R. eft (vo y e z p. 16 -14 ) mi fo l la f i
ut re mi ; o u , en le prenant comme ce favant, en
defeendant, mi re ut fi la fo l mi. O r , on a vu ci-
deffus, i ° . que l’heptacorde conjoint eft: plus ancien que
celui de Terpandre ; i ° . que l’accord de l’ancienne
lyre & celui du fyftême de Terpandre font les deux
feuls dont il foit fait mention dans les auteurs grecs.
D o n c ,i ° . celui de M. l’abbé Rouffier n’a jamais exifté;
donc, 1®. s’il y en a un qui dérive de la lyre de Mercure,
ce ne peut être celui de Terpandre, puifqu-il
n’eft: pas le plus ancien ; donc, 30. ce n’éroit pas de
celui de Terpandre qu’il falloit s’attacher à rechercher
le principe & l’origine. Mais i’heptacorde conjoint ne
renferme n i -fi fcj, ni mi aigu. Donc il ne peut être
un dérivé de l ’accord mi f i la mi ; donc , ouThepta-
corde ( & par conféquent le grand fyftême grec ) ne
dérive pas de la lyre de Mercure, ou l’accord de la
lyre de Mercure n’étoit pas mi f i la mi.
III, ««La proportion entre les ,cordes de cette lyre ,
il