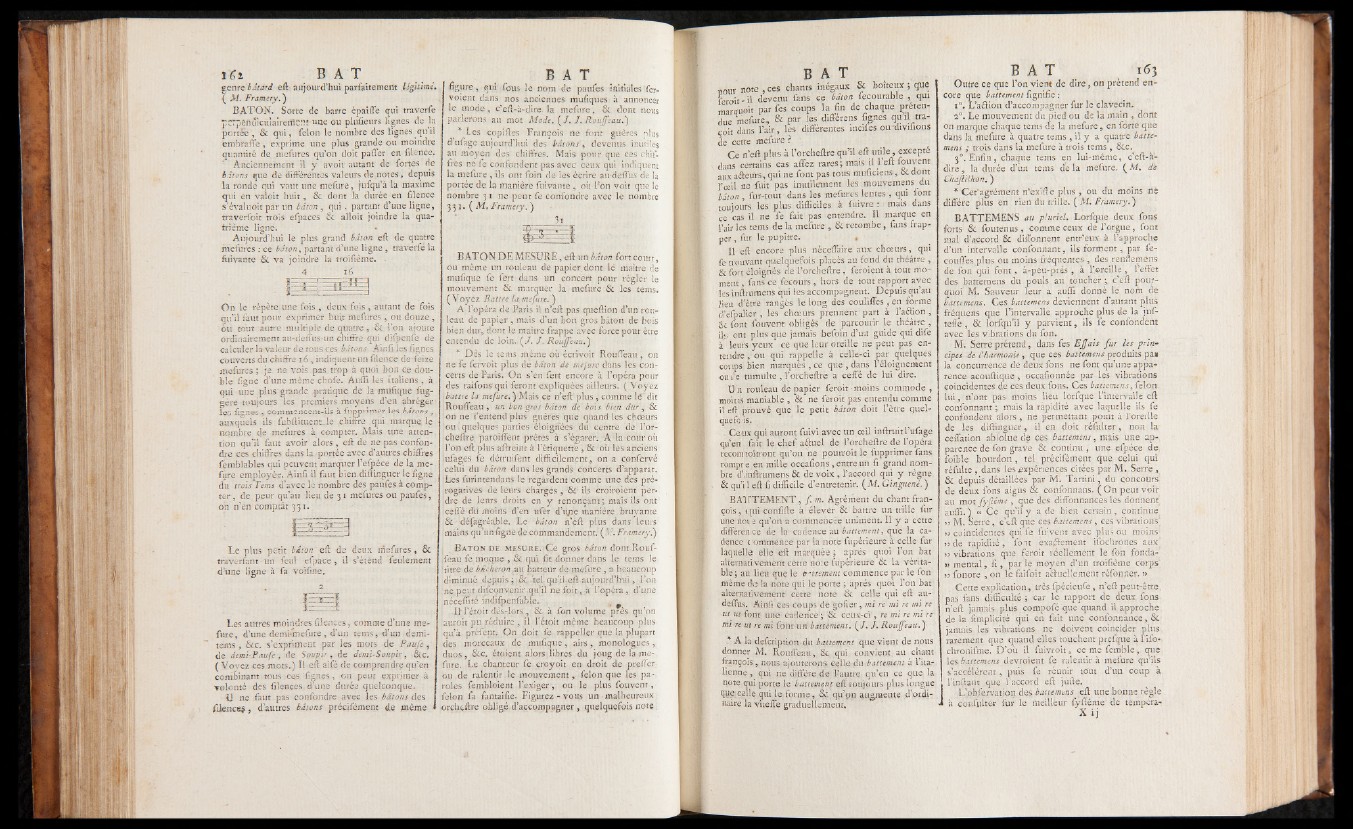
î C î B A T
genre bâtard eft aujourd’hui parfaitement .légitimé,
( M. Framery.)
B A TO N . Sorte de barre épàiffe qui traverfe
pCTpë i l a i c û i a i r £ une ou plufieurs lignes de la
portée , & qui, félon le nombre des lignes qu’il
embraffe , exprime une plus grande ou moindre
quantité de mefures qu’on doit pafler en fdence.
! Anciennement il y avoir autant de fortes de
bâtons que dé différentes valeurs de .notes, depuis
la ronde qui vaut une mefure, jufqu’à la maxime
qui en valoit huit, & dont la durée en fdence
s’évaluoit par un bâton , quiJ partant d’une ligne,
traverfoit trois efpaces & alloit joindre la quatrième
ligné.
Aujourd’hui le plus grand t>âton eft de quatre
mefures : ce bâton, partant d’une ligne , traverfe la
fiiivante & va joindre la troifième.
4 ___ 16 .
-
On le répète une fois , deux fois , autant de fois
qu’il faut pour exprimer huit mefures , ou douze ,
ou tout autre multiple de quatre, 8c. l’on ajoute
ordinairement au-deffus-un chiffre qui difpenfe de
calculer la-valeur de tous ces bâtons Ainfi les fignes.
couverts du chiffre 16 , indiquent un fdence de feize
mefures ; je ne vois pas trop à quoi bon ce double
figue d’une même chofe. A um les italiens, à
qui une plus grande .pratique de la mufique fug-
gère toujours les premiers moyens d’en abréger
les (ignés , commencent-ils à fupprimer les bâtons,
auxquels ils fubftituent_le chiffre qui marque, le -
nombre de mefures à compter. Mais une attention
qu’il faut avoir alors , eft de ne pas confondre
ces chiffres dans la -portée avec d’autres chiffres
femblables qui peuvent marquer l’efpèce de la mefure
employée. Ainfi il faut bien.diftinguer le figne ;
du trois Tems d’avec le nombre des paufes à comp- '
te r , de peur qu’au lieu de 31 mefures ou paufes, ;
oh n’en comptât 331.
Le plus petit bâton eft de deux mefures, &
traverfant - un feuh efpace , il s’étend feulement
d ’une ligne à fa voifine.
2
Les autres moindres fiiences, comme d’une mefure,
d’une demi*mefure , d’un tems, d’un demi-
tems , &c. s’expriment par les mots do Paufe,
de demi-Paufe, de Soupir,, de dèmi-Soupir, & c.
( Voyez ces mots.) Il eft aifé de comprendre qu’en
combinant tous ces lignes , on peut exprimer à
volonté des fdences. d’une durée quelconque.
il ne faut pas confondre avec les bâtons des
fdences , d’autres bâtons préçifément de même
B A T
figure, qui; fous le nom de paufes initiales Ter-
voient dans nos anciennes mufiques à annoncer
le mode, c’eft-à-dire. la mefure, & dont nous
parlerons ail mot Mode. ( / . J. Rouffeau.)
* Les copiftes François ne font guères plus
d’ufage aujourd’hui des bâtons', devenus inutiles
au moyen des chiffres. Mais pour que ces chiffres
ne fe confondent pas avec ceux qui indiquent
la mefure , ils ont foin de les écrire au-deffus de la
portée de la manière fuivante , où lJon voit que le
nombre 31 ne peut fe confondre avec le nombre
331. ( M. Framery. )
■. m m : - -
B A TO N DE M ESURE, eft un bâton fort court,
ou même un rouleau de papier dont lè maître de
mufique fe fert dans un concert pour régler le
mouvement & marquer la mefure & les tems.
(V o y e z Battre la-mefure.')
A l’opéra de Paris il n’eft pas queftion d’un rou-
• leau de papier , mais d’un bon gros bâton de bois
bien dur, dont le maître frappe avec force pour être
. entendu de loin. (/ . J. Rouffeau.)
* Dès le tems même où écrivoit Rouffeau, on
ne fe fervoit plus de bâton de mefure dans lès concerts
de Paris. On s’en fert encore à l ’opéra pour
des raifons1 qui feront expliquées ailleurs. ( Voyez
• battre là mefure. ) Mais ce n’eft plus , comme lé' dit
Rouffeau , un bon gros bâton de bois bien dur , &
on ne l’entend plus guères que quand les choeurs
ou ^quelques parties éloignées .du centre de l’or-
cheftre. paroi fient prêtes à s ‘égarer. A la cour où
l’on eft. plus âftreint à l’étiquette, & où les anciens
fufages fe détruifent difficilement, on a çpnferyé
celui du bâton dans les grands concerts d’apparat.
•Les furintendans le regardent comme une des prérogatives
de leurs charges , Se ils éroiroient per*
;dre de leurs droits en y renonçant; mais ils ont
cefle du moins d’en ufer d’iyie manière bruyante
& désagréable. Le bâton n’èft plus dans leurs
■ mains qu’un figne de commandement. (iU. Framery.')
Bâto n de mesure. Ce gros bâton dont Rouf-
jfeau fe moque , & qui. fit donner dans le tems le
‘titre de bûcheron,.au batteur de mefure , a beaucoup
diminué depuis -tel qu’il,eft aujourd’h u i, l’on
ne peut difeonyenir,-qu’il ne fo it, ;à l’opçra, d’une
•nèceffité indifpenfable.. - .
IlTétoit dès4ors à fon volume près qu’on
iauroit pu réduire , il l’etoit même beaucoup -plus
qu’à, préfent. On doit fe rappeller que la plupart
des morceaux de mufique, airs, monologues,
duos , &c. étoient alors , libres du joug de la mefure.
Le chanteur fe croyoit en droit de preffer.
ou.de ralentir le mouvement, félon que les paroles
fembloient l’exiger , ou le plus fouvent,
félon fa fantaifie. Figurez-vous un malheureux
orcheftre obligé, d’accompagner, quelquefois note.
B A T
notir note , ces chants inégaux & boiteux ; que
ieroit - il devenu fans ce bâton fecourable , qui
marquoit par fes coups la fin de chaque prétendue
mefure, & par les différens fignes qu.il tra-
çoit dans l’air., les différentes incites ouxiiviiions
de cette mefure ?.. -
Ce n’eft plus à l’orcheftre qu’il eft utile, excepte
dans certains cas affez rares ; mais il l ’eft fouvent
aux a&euVs, qui ne font pas tous muficiens, & dont
l’oeil 11e fuit pas inutilement les mouvemens du
bâton , fur-tout dans les mefures lentes , qui font
toujours les plus difficiles à fuivre : mais dans
ce cas il ne fe fait pas entendre. Il marque en
l’air les tems de la mefure , & retombe, fans frapper
, fur le pupitre.
Il eft encore plus néceffaire aux choeurs, qui
fe trouvant quelquefois placés au fond du théâtre ,
& fort éloignés de l’orcheftre, feroient à tout moment
, fans ce fecours , hors de tout rapport avec
les inftrumens qui les accompagnent. Depuis qu’au
Heu d’être rangés le long des couliffes ,- en forme
Gl’ëfpalier , les choeurs prennent part à l’aâion ,
(k font fouvent obligés de parcourir le théâtre ,
il«-, ont plus que jamais befoin d’un guide qui dife
à leurs yeux ce que leur oreille ne peut pas entendre
, ou qui rappelle à celle-ci par quelques
coups bien marqués , ce que , dans l’éloignement
ou if.e tumulte, l’orcheftre a ceffé de lui dire.
U n rouleau de papier feroit-moins commode ,
moins maniable , & ne feroit pas entendu comme
il eft prouvé que le petit bâton doit l’être quel-
^ Ce,ux qui auront fuivi avec un oeil inftruitl’ufage
qu’en fait le chef aéluel de l’orcheftre de l’opéra
recomhoîtront qu’on ne pourroit le fupprimer fans
romprje en mille ocçafipns, entre uïi fi grand nombre
d’ànftrumens & de voix , l’accord qui y règne
& qu’i l eft fi difficile d’entretenir. (M . Ginguené. )
BA1TTEMENT, f . m. Agrément du chant fran-
çois, qui confifte à élever & battre un trille fur
une not e qu’on a commencée uniment. Il y a cette
différence de la cadence au battement, que la cadence
c ommence par la note füpérieure à celle fur
laquelle elle eft marquée ; après quoi l’on bat
alternativement cette note fupérieure & la véritable;
au lieu que le battement commence par le fon
même de la note qui le porte ; après quoi l’on bat'
alternativement cette note & celle qui eft au--
deffus. Ainfi ces coups de go fier, mi re mi re mi re
ut ut font une cadencé-; '& ceux-ci, re mi re rni re
mi re ut re mi font un;battement. ( / . J. Rouffeau.)
* A la defcription du batterrtent que vient de nous
donner M. Rouffeau, & qui convient au chant
françois, nous ajouterons celle ,du.battement à l’italienne
, qui ne diffère de l’autre qu’en ce que la
note qui porte le' battement eft toujours plus longue
qyç. celle qui le forme , & qu’pn augmente d’ordinaire
la vîteffe graduellement.
B A T 1 6 3
Outre ce que l’on vient de dire, on prétend encore
que battement fignifie :
i°. L’a&ion d’accompagner fur le clavecin»
2°. Le mouvement du pied'ou de la main , dont
on marque chaque tems de la mefure, en forte que
dans la mefure à quatre tems , il y a quatre batte-
mens ; trois dans la mefure à trois tems , &c.
30. Enfin, chaque tems en lui-même, c’eft-à-
dire, la durée d’un tems de la mefure. ( M. d'e
Chaflilhon. )
* Cefagrément n’exifté plus , ou du moins né
diffère plus en rien du trille. ( M. Framery.)
BATTEMENS au pluriel. Lorfque deux fon s
forts & foutenus , comme ceux de l’orgue, font
mal d’accord & diffonnent entr’eux à l’approche
d’un intervalle confonnant, ils forment, par fe-
couffes plus ou moins fréquentes , des, renfle mens-
de fon qui fon t, à-peu-près , à l’oreille, l’eftet
des battemens du pouls au toucher c’eft pourquoi
M. Sauveur leur a auffi donné le nom de
battemens. Ces bjittemens deviennent d’autant plus
fréquens que l ’intervalle approche plus de la juf-
teffe, & lorfqu’il y parvient, ils fe confondent
avec les vibrations du fon.
M. Serre prétend, dans fes EJJais fur les principes
de C harmonie , que ces battemens produits pan
la concurrence dé deux fions ne font qu’une apparence
acouftique , occafionnée par les vibrations
coïncidentes de ces deux fions. Ces battemens, félon
lu i, n’ont pas moins lieu lorfque l’intervalle eft
confonnant ; mais la rapidité avec laquelle ils fe
confondent alors , ne permettant point à l’oreille
de les diftinguer, il en doit réftilter, non la
ceffation abfolue de ces battemens, mais une apparence
de fon grave & continu , une efpèce de,
foible bourdon, tel préçifément que celui qui
réfulte , dans les expériences citées par M., Serre ,
& depuis détaillées par M. Tartini, du concours
de deux fons aigus & confonnans. (O n peut voir
au mot fyfleme , que des diffonnances les donnent
auffi. ) « Ce qu’il y a de bien certain , continue
„ M. Serre, c’eft que ces battemens, ces vibrations’
» coïncidentes qui fe fifvent avec plus ou moins1
>j de rapidité, font exactement ifochrones aux_
jj vibrations que feroit réellement le. fon fonda-
>? mental, fi , par le moyen d’un troifième corps
jj fonore , on le faifoit a&uel'.ement réfonner. j>
Cette explication, trê$ fpécieufe, n’eft peut-être,
pas fans difficulté ; car le rapport de deux fons
n’eft jamais plus compofé que quand il approche
de la fimplicité qui en fait une confonnance, &
jamais les vibrations ne doivent coïncider plus,
rarement que quand elles touchent prefque à Lifo--
chronifme. D ’ou il fuivroit, ce me femble, que
les battemens devroient fe ralentir à mefure qu’ils
s’accélèrent, puis fe réunir tout d’un coup à
1’inftant que l’accord eft jufte.
L’obfervatlon des battemens eft une bonne règle
à -confuiter fur le meilleur fyffême de tempèra-
X i j