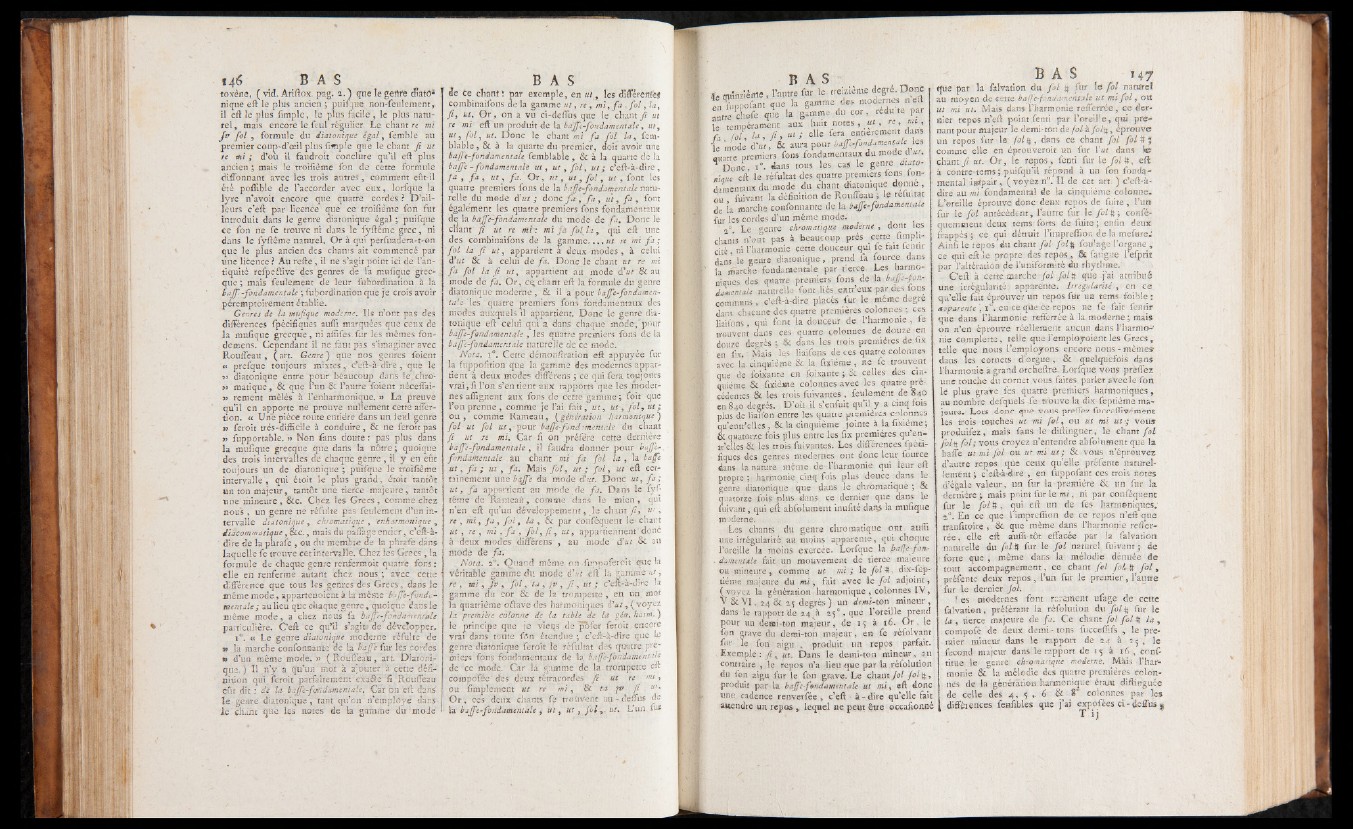
toxène, ( vîd. Ariftox. pag. 2. ) qtie le gefifé dïatô*
nique eft le plus ancien ; puifque non-feulement,,
il eft le plus fimple, le plus facile, le plus nature
l, mais encore le, feul régulier. Le chant re mi
Jv fo l , formule du diatonique égal, femble au
premier coup-d’oeil plus fimple que le chant f i ut
re mi ; d’ou il faudroit conclure qu’il eft plus
ancien ; mais le troifième fon de cette formule
diffonnant avec les trois autres, comment eût-il
été poflible de l’accorder avec eux, lorfque la
lyre n’avoit encore que quatre cordes ? D ’ailleurs
c’eft par licence que ce troifième fon fut
introduit dans le genre diatonique égal ; puifque
ce fon ne fe trouve ni dans le fyftême grec, ni
dans le fyftême naturel. Or à qui perfuadera-t-on
que le plus ancien des chants ait commencé par
une licence ? Au refte, il ne s’agit point ici de l’antiquité
refpeélive des genres de la mufique grec-,
que ; mais feulement de leur fubordination à la
baff>-fondamentale', fubordination que je crois avoir
péremptoirement établie.
Genres de la mufique moderne. Ils n’ont pas des
différences fpécifiques aufiï marquées que ceux de
la mufique grecque, ni affifes.fur les mêmes fon-
deoeens. Cependant il ne faut pas s’imaginer avec
Rouffeau , ( art. Genre ) que nos genres foient
« prefque toujours mixtes, c’eft-à-dire , que le
a diatonique entre pour béaucoup dans le,chro-
93 matique, & que l’un & l’autre foient néceffai-
m rement mêlés à l’enharmonique. » La preuve
qu’il en apporte ne prouve nullement cette affer-
tion. « Une pièce toute entière dans un féal genre
» feroit très-difficile à conduire, & ne feroit pas
93 fupportable. » Non fans doute : pas plus dans,
la mufique grecque que dans la nôtre ; quoique
des trois intervalles de chaque genre , il y en eût
toujours un de diatonique; puifque le troifième
intervalle , qqi étoit le plus grand, étoit tantôt
un ton majeur, tantôt une tierce majeure, tantôt
une mineure , &c. Chez les Grecs, comme chez
nous , un genre ne réfulte pas feulement d’un intervalle
diatonique , chromatique , enharmonique ,
diàcommatique, & c ., mais du paflàge entier, c’eft-à-
dire de la phrafe , ou du membre de la phrafte dans
laquelle fe trouve cet intervalle. Chez les Grecs , la
formule de chaque genre re'nfermoir quatre fous :
elle en renferme autant chez nous; avec cette
différence que tous les genres des Grecs, dans le
même mode, appartenoient à là même b a jfe-fondement
ale ; au lieu que chaque genre, quoique dans le
même mode, a chez nous fa baffe-fondanienj ah
particulière. C’eft ce qu’il s’agit? de développer,
i°. « Le genre diatonique moderne réfulte de
» la marche confondante de la Haffe'(ux les ,cordes
» d’un même mode. » (Rduffeau, art. Diatonique.)
Il n’y a qu’un moi à ajouter a çètte définition
qui feroit parfaitement eiè'a&e fi Rouffeau
eût dit : de la baffe-fondamentale. Car on eft dans
le genre diatonique, tant qu’on n’etnplôye clans
le châht 'qne les notes de la gamme du 1 mode
B A S
ne te chant l par exemple, en u t , les différente
cpmbinaifons de la gamme ut, re , mi, f a , f o l , la,
f i ) ut* O r , on a vu ci-deffus que le chant f i ut
re mi eft un produit de la baffe-fondamentale, ut,
ut, f o l , ut. Donc le chant mi fa fol la, fem-
blable , & à la quarte du premier, doit avoir une
baffe-fondamentale femblable , & à la quarte de la
bajfe -fondamentale u t, u t , f o l , ut ; c’eft-à-dire ,
f a » f * » u t , fa. O r , ut., u t , f o l , u t , font les
quatre premiers fons de la baffe-fondamentale naturelle
du mode d'ut ; donc f a , fa , ut, fa , font
également les quatre premiers fons fondamentaux
de la bajfe-fondamentale du mode de fa . Donc le
chant' fi ut re mv: mi fà fo f la , qui eft line
des combinaifons de la gamme....«/ re mi fa ;
fo l la f i ut, appartient a deux modes, à celui
d’«/ & à celui de fa. Donc le chant ut re mi
fa fol la f i ut, appartient au mode Sut & au
mode de fa. O r , cachant eft la formule du genre
diatonique moderne , & il a.pour baffe-fondamen-
/<z.'js'les quatre premiers fons fondamentaux des
modes auxquels il appartient. Donc le genre diatonique
eft: celui qui 3. dans chaque mode,'pour
bàffe-fondamentale , les quatre premiers fons de la
baffe-fondamentale naturelle de ce mode.
Nota. i°. Cette démonftration eft appuyée fur
la fuppofition que la gamme des modernes appartient
à deux modes différens ; ce qui fera toujours
vrai, fi l’on s’en tient aux rapports que les modernes
alfignent aux fons de cette gamme; foit que
l’on prenne , comme je l’ai fait, ut, u t, fo l, ut ;
ou , comme Rameau, (génération harmonique}
fo l ut fo l u t, pour 'baffe-fond imentale du chant
f i ut re mi. Car fi on préfère cette .dernière
baffe-fondamentale , il faudra donner pour baffe-,
fondamentale au chant mi fa fol la , la baffe
u t , fa ; ut , fa. Mais f o l , ut ; f o l , ut eft certainement
une baffe du mode d’«/. Donc ut, fa ;
ut, fa appartient au mode de fà. Dans le fyf-
têtne de Rameau, comme daés le mien, qui
n’en eft qu’un développement, Je chant fi y u ; ,
re , mi, fa , fo l „ la , & par conféquerit le* chant
u t , re , m i, fa , fo l, f i , ut, appartiennent'donc
à deux modes- différens , au mode Sut Sc au
mode de fa.
Nota.. 20, Quand même on fitppofercit que la
véritable gamme du mode S u t éft la gamme ut,
re , mi , Jv , f o l , ta , }v , f i , ut ; c’eft-àudire la
gamme du cor & de la trompette, en un, mot
la quatrième oâave dés harmoniques S u t , { voyez
la \première colonne de la table de la gén„ hartn. )
le principe que je viens de'pÔfer feroit encore
vrai dans toute fon étendue ; c’eft-à-dire que lé
genre diatonique feroit le réfultat des quatre premiers
fons fônda mentaux de la. baffe-fondamentale
de ce mode. Car la gamme de la trompette eft
compofée des deux tétracordès f i ut re un,
ou fimplement ut re mi, & ta jv f i ut.
O r , ces deux chants, fè troùvent au - deffus de
la bsJfe-fvrtdiWteniale ; u t , u t , f o l u t . L’un lu*
U miinzième , l’autre fur le treizième degré. Donc
en uippofant que la gamme de» modernes n eft
antre e L fe que la gamme du cor, rédute par
le tempérament aux huit notes , , u t , gM '&M
ƒ (0i la f i , u t ; elle fera entièrement dans
le mode d’« t, & aura pour iajfe-findumentule les
«uatre premiers fons fondamentaux du mode d ut.
1 Donc, 1°. dans tous les cas le genre diato-
niaue eft le réfultat des quatre premiers fons fondamentaux
du mode du chant diatonique donne , •
OU fuivant la définition de Roufleau ; le relultat
de la marche conformante de la bajfc-foniamcntulc
fur les cordes d’un même mode.' • -,
z°. Le genre chromatique moderne , dont les
chants n’ont pas à beaucoup près cette fimpli-
cité ni l’harmonie cette douceur qui le lait ientir
dans le genre diatoniqueprend fa fource.dans
la marche fondamentale par tierce. Les harmoniques
des quatre premiers fons de Itl-, baffe-fondamentale
naturelle font liés entr’eux par des ions
communs, c’eft-à-dire placés fur le même degre
dans chacune des quatre premières colonnes ; ces
liaifons, qui font la douceur de l’harmonie , fe
trouvent dans ces quatre colonnes de douze-en
douze degrés ; 6c dans les trois premières de.fix
en fix. ' Mais 'les liaifons dé,ces quatre colonnes
avec la. cinquième 8c la fixième , ne fe trouvent
que de foixante en foixante ;.8c celles des cinquième
8c .fixièjsne colonnes avec les quatre précédentes
8c les trois fuivan.tes , feulement de 840
en 840 degrés. D ’où il s’enfuit qu’il y a cinq fois
plus de liaifon entre les quatre premières colonnes
qii’entr’elles, 8c la cinquième jointe à.la fixième;
& quatorze fois plus entre les ,fix premières qu’en-
tr’elles 8c les trois fui vantes. Les différences fpécifiques
des genres modernes ont donc leur fource
que par la falvation du fo l # fur le fo l naturel
au moyen de cette baffe-fondamentale ut mi f o l , ou
ut mi ut. Mais dans l’harmonie reflerrée, ce dernier
dans la nature même de l’harmonie qui leur eft
propre ; harmonie cinq fois plus douce dans l e , ;
genre diatonique que dans le chromatique ; 8c
quatorze fois plus dans ce dernier que dans le
fuivant, qui eft abfolument inufité dans lu mufique
moderne. . ; !
Les chants du genre chromatique ont aufli
une irrégularité au moins apparente, qui choque
l’oreille la moins exercée. Lorfque la .baffe-fon- ,
. damentale fait un mouvement de tierce majeure
ou mineure, comme ut mi ; le fo l$ , dix-fep-
tième majeure du mi, fait avec le fol adjoint*, |
( voyez la génération harmonique , colonnes IV ,
v 8c V I , 24 8c 25 degrés ) un demi-ton mineur ,
dans le rapport de 24 à 25e , que l’oreille prend
pour un demi-ton majeur, de 1 $• à 16. Or . le
fon grave du demi-ton majeur, en fe réfolvant
fur le fori aigu , produit un repos parfait.
Exemple : f i x ut. Dans le demi-ton mineur, ;au
contraire , 1 e repos n’a lieu que par la réfolution
du fon aigu fur le fon grave. Le chant fol fol ,
produit par la baffe-fondamentale ut mi, eft donc
une. cadence renverfée , c’çft à - dire qu’elle fait
attendre un repos , lequel ne peut être oçeafionaé
repos n’eft point fend par l’oreille, qui prenant
pour majeur le demi-ton de fol à/ô%, éprouvé
un repos fur le fo l# , dans ce chant fo l f o l#5
comme elle en éprouveroit un fur l'ut dans ie
chant f i ut. O r , le repos , fend, fur le /o/#, eft
à contre-tems ; puifqu’il répond à un fon fondamental
impair , (v o y e z n°. II de cet art. ) c’eft-à-
dirè au ml fondamental de la cinquième colonne.
L’oreille éprouve donc deux repos de fuite, l ’un
fur le fo l antécédent, l’autre fur le f o l ; confé-
quemment deux tems forts de fuite ; enfin deux
frappés ce qui détruit l’impreffion de la mefure.'
Àinfi le repos du chant fo i fol% foulage l’organe ,
ce qui eft le propre des repos , & fatigue l’efprit
par l’altéradon de l'uniformité du rhythme.
C ’eft à cette marche fo l fol# que j’ai attribué
une irrégularité apparente. Irrégularité , en ce
qu’elle fait éprouver un repos fur un tems foible :
apparente , i° . en ce que.ee repos ne fe fait fentir
que dans l’harmonie refierrée à la moderne; mais
on n’en éprouve réellement aucun dans l’harmo-’
, nie complerte, telle que hem ployaient les Grecs ,
telle que nous l’employons encore nous - mêmes-
dans les cornets d’orgue, 6c quelquefois dans
l’harmonie à grand orcheftre. Lorfque vous preftez
une touche du cornet..vous faites parler /vec le fon
le plus grave fes quatre premiers harmoniques,
au nombre defquels fe trouve la dix-feptième majeure.
Lors donc que vous preffez fucceflivèment
les trois touches ut mi f o l , ou ut mi ut\; vous
produifez, mais fans le diftinguêr,, le chant fo l
fo l§ fol; vous croyez n’entendre abfolument que la
baffe ut mi fo l ou ut mi ut ; & vous n’éprouvez
d’autre repos que ceux qu’elle préfente naturellement
; c’eft-à-dire , en fuppofant ces trois notes
d’égale valeur, un fur la première & un ftir la
dernière ; mais point fur le mi, ni par confisquent
fur le fo l # , qui eft un de fes harmoniques.
: 2.0. En ce . que l’impreffion de ce repos n’eft que
i tranfitoire , & que même dans l’harmonie refi'er-
| rée , elle eft aruffi-tôt effacée par la falvation
naturelle du fol# fur le fo l naturel fuivant ;• de
; forte que , même dans la mélodie dénuée de
tout accompagnement, ce chant fe l fo i # f o l ,
préfente deux repos, l’un fur le premier, l’autre
fur le dernier fol.
I es modernes font rarement ufage de cette
falvation, préférant la réfolution du fol# fur le
la , tierce majeure de fa. C-e chant fol fo l # la ,
compofé de deux demi-tons iùcceffifs , le premier
mineur dans le rapport de 24 à 2 , le
fécond majeur dans: le rapport de 15 à 16 , conf-
titue le genre chromatique moderne. Mais l’harmonie
& la mélodie des quatre premières colon-
nés de la génération harmonique étant diftinguée
de celle des 4 , 5 ,. 6 & 8e colonnes par le»
différ ences feafibles que j’ ai expofées ci - deffus ^
t ; i