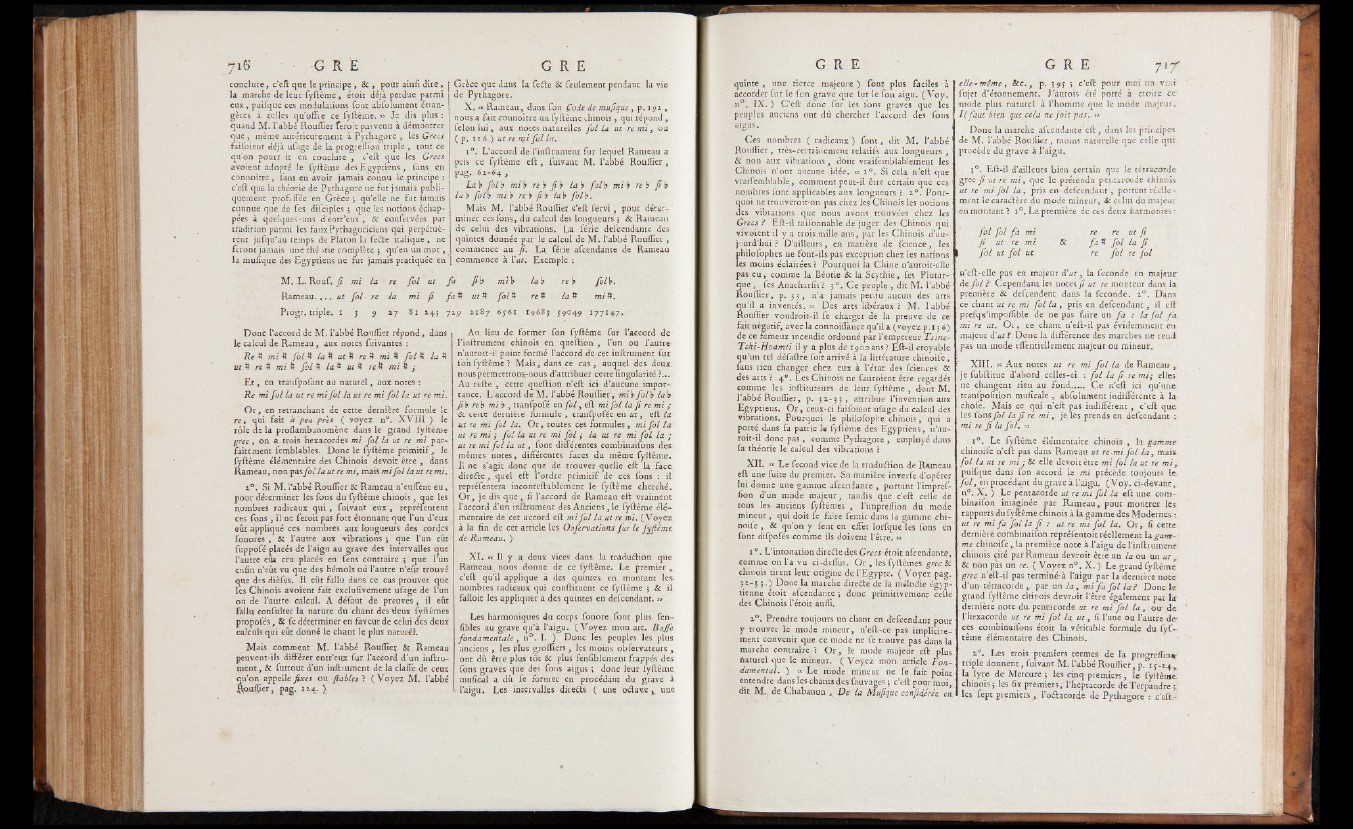
conclure, c’eft que le principe , & , pour ainfi dire, J
la marche de leur fyftême, étoit déjà perdue parmi
eux , puifque ces modulations font abfolument étrangères
à celles qu’offie cç fyftême. » Je dis plus :
quand M. l’abbé Roufiler feroit parvenu à démontrer
q u e , même antérieurement à Pythagore , les Grecs
faifoient déjà ufage de la progreffion triple , tout ce
qu'on pourrait en conclure , c’eft que les Grecs
avoient adopté le fyftême des Egyptiens, fans en
connoître , fans en avoir jamais connu le principe :
c’eft que la théorie de Pythagore ne fut jamais publiquement
prof.ffée en Grèce 5 qu’elle ne fut jamais
connue que de fes difciples ; que les notions échappées
à quelques-uns d’entr’eux , & confervées par
tradition parmi les faux Pythagoriciens qui perpétuèrent
jufqu'au temps de Platon la feéte italique , ne
feront jamais une théorie complète 3 qu’en un m o t ,
la mufique des Egyptiens ne fut jamais pratiquée en | Grèce que dans la fe<fte & feulement pendant la vie
de Pythagore.
X . « Rameau, dans fon Code de mufique, p. 1 9 1 ,
nous a fait connoître un fyftême chinois, qui répond ,
félon lu i, aux notes naturelles fo l Lu ut re mi, ou
( p. 1 t6 ) ut re mi fo l la.
10.' L ’accord de i’inftrument fur lequel Rameau a
pris ce fyftême eft , fuivant M. l’abbé Rouflier ,
pag. 6z-6+ ,
La]} fol]} mi b re b fi]} la]} folk mi]} re b fi]}
la]} fol]} mi]} re]} fi]} la]} fol]}.
Mais M . l'abbé Rouflier s’eft f e r v i, pour déterminer
cesfons , du calcul des longueurs 5 & Rameau
de celui des vibrations. La férié defeendanre des
quintes donnée par le calcul de M . l’abbé Rouflier,
commence au fi. L a férié afeendante de Rameau
]
commence à Y ut» Exemple :
M , L . Rouf, f i mi la ' re f o l ' ut f a fik mi V la b re 1» fil\>.
Rameau. . . . ut fo l - re la mi ß fa $ ut tt f o l# re# la # mi #.
Pfogr. triple, 1 3 9 %7 81 1 4 î . 7 *9 1187 6$61 19683 J»° 4 » 177147.
Donc l'accord de M . l’abbé Rouflier répond, dans
le calcul de Rameau, aux notes fuivantes :
Re # mi # Jol # la # ut re tt mi # fo l # la #
ut # re # mi # fo l tt la # ut # re 8 mi # ,•
E t , en tranfpofant au naturel, aux notes :
Re mi fo l la ut re mi fo l la ut re mi fo l la ut re mi.
O r , en retranchant de cette dernière formule le
re, qui fait à peu près ( voyez n°. X V I I I ) le
rôle de la proflambanomène dans le grand fyftême
grec y on a trois hexacordes mi fo l la ut re mi parfaitement
femblables. Donc le fyftême primitif, le
fyftême élémentaire des Chinois devoit être , dans
Rameau, non pas fo l la ut re mi, mais mifol la ut re mi.
i®. Si M . l'abbé Rouflier & Rameau n’euflent e u ,
pour déterminer les fons du fyftême chinois., que les
nombres radicaux qui , fuivant eux , représentent
ces fans , il ne feroit pas fort étonnant que l’un d’eux
eût appliqué ces nombres aux longueurs des cordes
fonores , & l’autre aux vibrations ; que l’un eût
fuppofé placés de l’aigu au grave des intervalles que
l'autre eus cru placés en fêns contraire .5 que l’un
enfin n'eut vu que des bémols où l’autre n’eut trouvé
que des dièfçs. Il eût fallu dans ce cas prouver que
les Chinois avoient fait exclufivement ufage de l’un
ou de l’autre calcul. A défaut de preuves, il eût
fàllu confulter la nature du chant des deux fyftêmes
propofés , & fe déterminer en faveur de celui dés deux
calculs qui eût donné le chant le plus naturel.
Mais comment M . l’abbé Rouflier & Rameau
peuvent-d!s différer entr’eux fur l’accord d’un inftru-
ment, & furtout d’un inftrument de la claflè de ceux
qu’on appelle fixes ou fiables ?. ( V o y e ? M. l’abbé
Routier, pag. 114. );
Au lieu de former fon fyftême fur l’accord de
l’inftrument chinois en queftion , l’un ou l ’autre
n’auroit-il point formé l’accord cet inftrument fur
fon fyftême ? M a is , dans ce c a s , auquel des deux
nous permcttron%-nous d’attribuer cette Angularité ?...
Au refte , cette queftion n’eft ici d’aucune importance.
L accord de M . l’abbé Rouflier, mi]} fol]} la V
fi]} re ]} mi b , tranfpofé en fo ls eft mi fo l la f i re mi y
& cette dernière formule , tranfpofée en u t, eft la
ut re mi fo l la. O r , toutes ces formules , mi fo l la
ut re mi ,* fo l la ut re mi fo l ; la ut re mi fo l la ;
ut re mi fo l la ut, font différentes combinaisons des
mêmes notes , differentes faces du même fyftême.
Il ne s’agit donc que de trouver quelle eft la face
directe, quel eft l ’ ordre primitif de ces fons : il
repréfentera inconteftablement le fyftême cherché.
O r , je dis q u e , fi l’accord de Rameau eft vraiment
l’accord d’un inftrument des Anciens, le fyftême élémentaire
de cet accord eft mi fo l la ut re mi. (V o y e z
à la fin de cet article les Obfervations fur le fyfiême
de Rameau. )•
X I . c*. Il y a deux vices dans, la traduction que
Rameau nous donne de ce fyftême. Le premier *
c’eft qu’il applique à des quintes en montant les
nombres radicaux qui conftituent ce fyftême ; & il
falloir les appliquer à des quintes en defeendant. »1
Les harmoniques du cotps fonore font plus fen-
fibles au grave qu’à l’aigu. (V o y e z mon art. Baffe
fondamentale y n . I. ) Donc les peuples les plus
anciens , les plus groffiers, les moins obfervateurs
ont dû être plus tot & plus fenfiblement frappés des
fons graves que des fons aigus ; donc leur fyftême
mufical a dû fe former en procédant du grave à,
I l’aigu. Les intervalles directs ( une oétave x une
quinte , une tierce majeure ) font plus faciles à
accorder fur le fon grave que fur le fon aigu. ( V o y .
n ° . IX . ) C ’eft donc fur les fons graves que les
peuples anciens ont dû chercher l’accord des fons :
aigus. x | |
Ces nombres ( radicaux ) fo n t , dit M . l’ abbé 1
Rouflier, très-certainement relatifs aux longueurs ,
& non aux vibrations, dont vraifemblablement les
Chinois n’ont aucune idée, «è i ° . Si cela n’ett que
vraifcmblable, comment peut-il être certain que ces ‘
nombres font applicables aux longueurs ? i ° . Pourquoi
ne trouveroit-on pas chez les Chinois les notions ’
des vibrations que nous avons trouvées chez les
Grecs ? Eft-il raifonnable dé juger des Chinois qui
vivoient il y a trois mille ans, par les Chinois d’aujourd’hui
? D ’ailleurs, en matière de fcience, les;
philofophes ne font-ils pas exception chez les nations
les moins éclairées ? Pourquoi la Chine n’auroit-elle
pas e u , comme la Béotie & la Scythie, fes Plutar- ’
que , fes Anacharfis? 30. C e peuple , dit M . l’abbé
Rouflier, p. 33, n’a jamais perdu aucun des arts
q u ’il a inventés. 33 Des arts libéraux ? M . l abbe
Rouflier voudroit-il fe charger de la preuve de ce
fait négatif, avec la connoiflance qu’il a (voyez p. 13 6)
de ce fameux incendie ordonné par l’empereur Tsine-
Tchi-Hoamti il y a plus de 1900ans? Eft-il croyable
qu’un tel défaftre foie arrivé à la littérature ebinoife,
lans rien changer chez eux à l’état des fciences &
des arts ? 4 ° . Les Chinois ne fauroient être regardés
comme les inftituteurs de leur fy ftêm e , dont M.
l ’abbé Rouflier, p. 3 1 -3 3 , attribue l’invention aux
Egyptiens. O r , ceux-ci faifoient ufage du calcul des
vibrations. Pourquoi le philofopbe chinois, qui a
porté dans fa patrie 1« fyftême des Egyptiens, n’au-
roit-il donc pas , comme Pythagore , employé dans
fa théorie le calcul des vibrations ?
XII. « L e fécond vice de la tradudion de Rameau
eft une fuite du. premier. Sa-manière inverfe d’opérer
lui donne une gamme afeendante , portant l’impref-
fion d’un mode majeur, tandis que c’eft celle de
tous les- anciens, fyftêmes , l’impreflion du mode
mineur , qui doit fe faire fentir dans la gamme chi-
noife , & qu’on y fent en effet lorfque les fons en
font difpofés comme ils doivent l’être. 33
i p. L ’intonation direde des Grecsétoit afeendante,
comme on l'a vu ci-deflus. O r , les fyftêmes grec &
chinois tirent leur origine de l’Egypte. ( V o y e z pag.
3-1-33.) Donc la marche direde de la mélodie égyptienne
étoit afeendante 3 donc primitivement celle
des Chinois l’étoit auili.
i ° . Prendre toujours un chant en defeendant pour
y trouver le mode mineur, n’eft-ce pas implicitement
convenir que ce mode ne fe trouve pas dans la
marche contraire ? O r , le mode majeur eft plus
Naturel que le mineur. ( V o y e z mon article Fondamental.
) ce L e mode mineur ne fe fait point
entendre dans les chants des fauvages 3 c’eft pour moi,
dit M .; de Chabanon , De la Mufique confidérée. en.
elle-même y Sec. 3 p. 395 3 c ’eft pour moi un vrai
fin jet d’étonnement. J ’aurois été porté à croire ce
mode plus naturel à l’homme que le mode majeur.
Il faut bien que cela ne foit pas. 33
Donc la marche afeendante e f t , dans les principes
de M . l’abbé Rouflier, moins naturelle que celle qui'
procède du grave à l’aigu.
3°. Eft-il d’ailleurs bien certain que le tétracorde
grec f i ut re mi y que le prétendu pcntarcode chinois
ut re mi fo l la , pris en defeendant, portent réellement
le caractère du mode mineur, & celui du majeur
en montant ? i ° . L a première de ces deux harmonies:
fo l fo l fa mi re re lit f i
f i ut re mi 5c fa% fo l la fi
I fo l ut fo l ut re fo l re fol
n’eft-elle pas en majeur d'ut 3 la fécondé en majeur
de fo l ? Cependant, les notes fi ut re montent dans la
première & defeendent dans la fécondé. z ° . Dans
ce chant ut re mi fo l la , pris en defeendant, il eft
prcfqis’impofllble de ne pas faire un fa : la fo l fa.
mi re ut. O r , ce chant n’eft-il pas évidemment eu
majeur d'ut ? Donc la différence des marches ne rend
pas un mode effentiellement majeur ou mineur.
X I I I , ce Au x notes ut re mi fo l la de Rameau-,,
je fubftitue d’abord celles-ci : fo l la f i re mi,• elles
ne changent rien au fond...... C e n’eft ici qu’une
tranfpofition muficale x abfolument indifférente à la.
chofe. Mais ce qui n’eft pas indifférent, c’eft que
les Cons fo l la f i re m i je les prends en defeendant ;
mi re f i la fo l. 33
i ° . Le fyftême élémentaire chinois , la- gamme
chinoife n’ eft pas dans Rameau ut re-mi fo l la } mais
fo l la ut re mi ; & elle devoit être mi fo l la ut re mir
puifque dans fon accord le mi précède toujours le.
! fo la en procédant du grave à- l’aigu. (V o y . ci-devant,.
ii°. X . ) Le pentacorde ut re mi fo l la eft une com-
binaifôn imaginée par Rameau, pour montrer les
rapports du fyftême chinois à la gamme des Modernes :
ut re mi fa fo l la f i : ut re mi fo l la. O r ,. fi cette
dernière combinailon repréfentoit-réellement la-^awr-
me chinoife,.la première note à l’aigu del'inflrument
chinois pité par Rameau ùevroit être un la ou un ut y,
& non pas un re. ( V o y e z n°. X . ) Le grand fyftême
grec n’eft-il pas terminé-à l’aigu par la dernière note
d’ un tétracorde par un la y mi fa fo l la■ ? Donc le
grand fyftême chinois devroit l’être également par hr
dernière note du pentacorde ut re mi fo l la ,. o ir de:
l’hexacorde ut re mi fo l la ut, fï l’une ou l’autre de-
ces combinaifons étoit la véritable formule du f y f -
tême élémentaire des Chinois.
z ° . Les trois premiers termes de la proen-effio*
triple donnent, fuivant M . l’abbé Rouflier, p. iy - r i_ .
la Jyre de Mercure 3 les cinq premiers, le fyftême.
chinois3. les fîx premiers, l’héptacorde deTerpandre 3.
les fept premiers , l’oftacorde de Pythagore :: c’eft.-