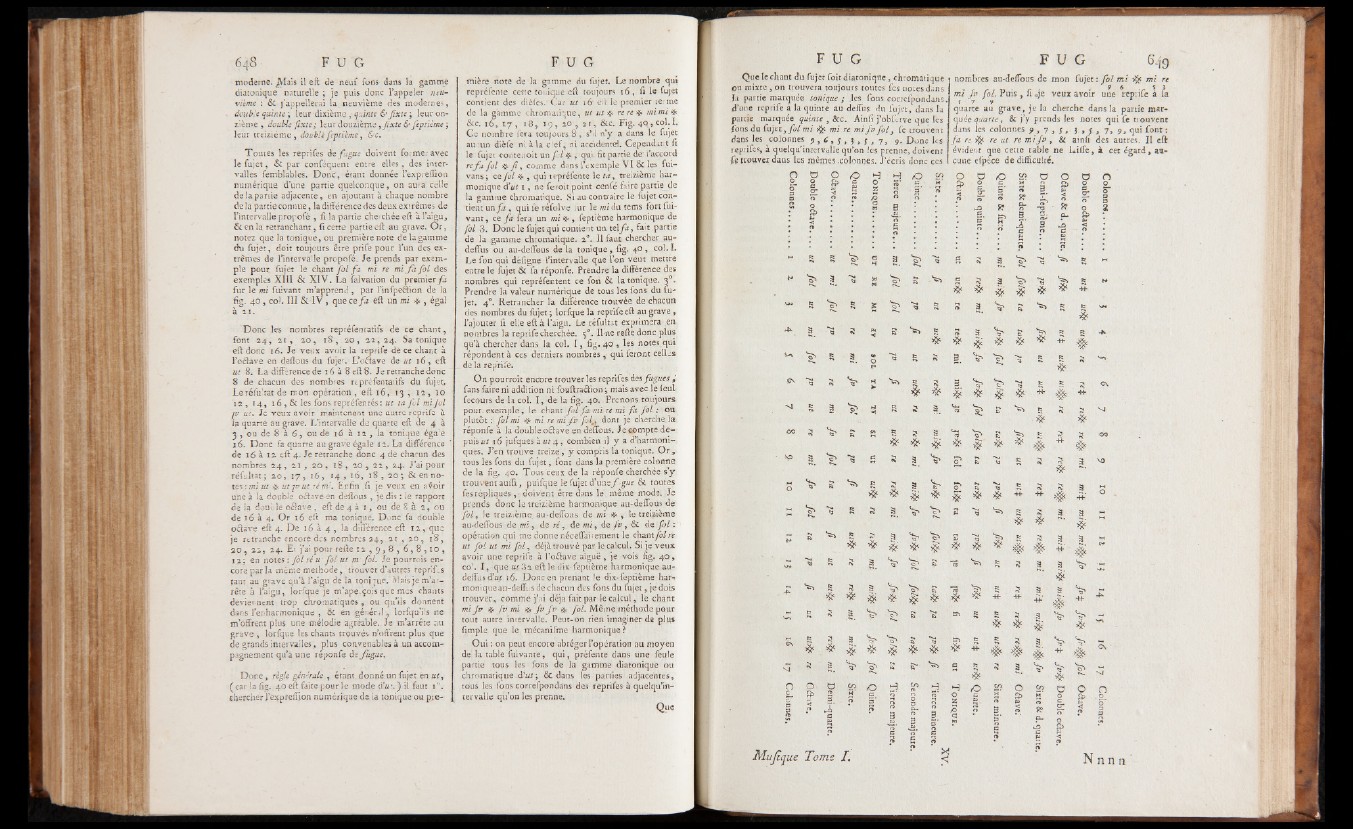
648 F U G
moderne. JVIais il eft de neuf fons dans la gamme
diatonique naturelle ; je puis donc l’appeler neuvième
: & j'appellerai la neuvième des modernes,
double quinte ; leur dixième , quinte & fixte ; leur onzième
, double fixte; leur douzième r fixte & feptième ;
leur treizième , doublé feptième, &c.
Toutes les reprifes de fugue doivent former avec
le fujet, & par conféquent entre elles , des intervalles
femblables. Donc", étant donnée l’expreffion
numérique d’une partie quelconque, on aura celle
de la partie adjacente, en ajoutant à chaque nombre
de la partie connue, la différence des deux extrêmes de
l’intervalle propofé , fi la partie cherchée eft à l’aigu,
& en la retranchant, fi cette partie eft au grave. O r ,
notez que la tonique, ou première note de la gamme
du fujet, doit toujours être prife pour l’un des extrêmes
de l'intervalle propofé. Je prends par exemple
pour fujet le chant fol fa mi re mi fa fo l des
exemples XIII & XIV. La falvation du premier^
fur le mi fuivant m’apprend , par i’infpeôion de la
fig. 40 , col. III & IV , que ce fa eft un mi # , égal
à 2-1.
Donc les nombres repréfentatifs de ce chant,
font 24 , z i , 20, 18 ,-2 0 , 2 2 ,2 4 . Sa tonique
eft donc 16. Je veux avoir la reprife de ce chant à
l’c&ave en deflous du fujer. L’céîave de ut 16 , eft
ut 8. La différence de 16 à 8 eft 8. Je retranche donc
8 de chacun des nombres repréfentatifs du fujet.
Le réfultat de mon opération , eft 16 , 13 , 1 2 , 10
12 , 14 , 1 6 , & les fons repréfentés: ut ta fol mi fol
jv ut. Je veux avoir maintenant une autre reprife à
ia quarte au grave. L’intervalle de quarte eft de 4 à
3 , ou de 8 à 6 , ou de 16 à 12 , la tonique éga’e
j 6. Donc fa quarre au grave égale 12. La différence
de 16 à 12 eft 4. Je retranche donc 4 de chacun des
nombres 24 , 2 1 , 20 , 18 , 20, 22 , 24. J’ai pour
réfultat; 20, 1 7 , 16, 1 4 , 1 6 , 1 8 ,2 0 ; & en notes:
mi ut 3$ u t jv u t rémi. Enfin fi je veux en avoir
une à la double o&ave en deflous je dis : le rapport
de la double oclave , eft de 4 à 1 , ou de 8 à 2, ou
de 16 à 4. Or 16 éft ma tonique. Donc fa double
oélave eft 4. De 16 à 4 , la différence eft 12 , que
je retranche encore des nombres 24, 21 , 20, 18,
20 , 22, 24. Et j’ai pour refte 1 2 , 9 , 8 , 6 , 8 , 1 0 ,
12; en notes : fo lrèu fô l ut m fol. Je pourrois encore
par la même méthode, trouver d’autres reprifis
tant au grave qu’à l’aigu de la tçnique. Mais je m’arrête
à l’aigu, lorfque je m’ape.çoisque mes chants
deviennent trop chromatiques , ou qu’ils donnent
dans l’en harmonique , & en général, lorfqu’ils ne
m’offrent plus une mélodie agréable. Je m’arrête au
grave , lorfque les chants trouvés n’offrent plus que
de grands intervalles, plus convenables à un accompagnement
qu’à une réponfe de fugue.
Dor.c, règle générale , étant donné un fujet ën ar,
(car la fig..40 eft faite pour le mode d’//?.) il faut i° .
chercher l’e^preffion numérique de la tonique ou pie-
F U G
mière note de la gamme du fujet. Le nombre qui
repréfente cette tonique eft toujours 16 , fi le fujet
contient des dièfes. Car ut eft le premier terme
de la gamme chromatique, ut ut # re re & rnirni &
&c. 16, 1 7 , 18, 19 , 20 , 21 , &c. Fig. 49.î co^L
Ce nombre fera toujours 8 , sM n’y a dans le fujet
aucun dièfe ni à la c!ef, ni accidentel. Cependant fi
le fujet contenait un fol # , qui fit partie de- i’accord
refa fol # fi^ comme dans l’exemple VI & les fui-
vans; ceJol , qui tepréfente le ta, treizième harmonique
d’ut 1 , ne feroit point cenfé faire partiejle
la gamme chromatique. Si au contraire le fujet contient
un f a , qui le réfolve fur le mi du teins fort fui-
vanr, ce fa fera un mi# , feptième harmonique de
fol 3. Donc le fujet qui contient un telfa, fait partie
de la gamme chromatique, 20. Il faut chercher au-
deffus ou au-deffous de la tonique , fig. 401 col. I.
Le fon qui défigne l’intervalle que l’on'veut mettre
entre le fujet & fa réponfe. Prendre la différence des
nombres qui repréfer. tent ce fon & la tonique. 30.
Prendre la valeur numérique de tous les fons du fujet.
40. Retrancher la différence trouvée de chacun
des nombres du fujet ; lorfque la reprife eft au grave,
l’ajouter fi elle eft à l’aigu. Le réfultat exprimera en
nombres la reprife cherchée. 5°. Il-ne refte donc plus
qu’à chercher dans la col. I , fig. 40 , les notes qui
répondent à ces derniers nombres , qui feront celles
de la reprife.
On pourroit encore trouver les reprifes. des fugues
fans faire ni addition ni fouftra&ion ; mais avec le feul
fecours de la col. I , de la fig. 40. Prenons toujours
pour-exemple, le chant fol fa m ir e mi fa f o l ; ou
plutôt : fo l mi & mi re mi Jv. foL, dont je cherche la
réponfe à la double.oâave en deffous. Je compte depuis
«r 16 jufques a ut 4 , combien il y a d’harmoniques.
J’en trouve treize , y compris la tonique. O r ,
tous les fons du fujet, font dans la première colonne
de la fig. 40. Tous ceux de la réponfe cherchée s’y
trouvent auffi, puifque lé fujet d’unef g u e & toutes
fes répliques doivent être dans lé même mode. Je
prends donc le treizième harmonique au-deffous de
f o l , !e treizième au-deffous de mi & > le treizième
au-deffous de mi, de ré, de mi, de f v , & de fo l :
opération qui me donne néceffai rement le chant foire
ut fol ut mi f o l , déjà trouvé par le calcul. Si je veux
avoir une reprife à l’oéfave aiguë , je vois fig, 40,
co\ I , que ut 32 eft le dix-feptième harmonique au-
deffusd'ut 16. Donc en prenant !e dix-feptième har-»
moniqueau-deffus de chacun des fons du fujet, je dois
trouver, comme j’ai déjà fait par le calcul, le chant
mi Jv # fv mi Jv Jv & fol. Même méthode pour
tout autre intervalle. Peut-on rien imaginer de plus
fimple que le méçanifme harmonique?
Oui : on peut encore abréger l’opération au moyen
de la table fui vante, qui, préfente dans une feule
partie tous les fons de la gamme diatonique ou
chromatique d'ut ; & dans les parties adjacentes,
tous les fons correfpondans des reprifes à quelqu’in-
tervalle qu’on les prenne.
Q u e
F U G
Q u e le ch ant du fujer fo it d ia to n iq u e , ch romatique
OU m ix t e , on trou v era toujours tontes fes notes dans
Ja partie marquée tonique ; .les fon s correfpondans
d ’une reprife a la quinte au deffus du fu je t , dans la
partie marquée quinte , & c . A in fi j ’o b fc rv e q y e les
fon s du fu je t , fol mi ffe mi re mijv fo l, Ce trouvent
dans les co lon n e s 9 , C, 5 , 3 , y , 7 , 9. D o n c les
reprifes, à que lqu ’intervalle q u ’on les prenne, d o iven t
fc trou v er dans les mêmes .colonnes. J ’écris donc ces
F U G 64g
nombres au-deffous de mon fujet : f o l mi Jfe mi re
mi Jv fol. Puis , fi «je v e u x a v o ir une reprife à la
ï 7 9 4
quarte au g r a v e , je la ch e rch e dans la pa rtie m a rquée
quarte y & j’y prends les notes q u i fe tro u v en t
dans les co lon n es 9 , 7 , S » ) > S > 7 > 9» f ° n t •
fa re re ut. re mi Jv , & ainfi des autres. I l e ft
év id ent q ue cette table n e lu if fe , à ce t é g a r d , aucune
efpèc e d e difficulté.
9 0 O 0 H d <0 en O O tO en O O O O
ôa~ D
0c
CT*
n 0 jj
0•
a
yO
î?
uinte
1 ? S5 <n
O
cr 9?
S. p<
0e
r
5o_S“ B
M O M 3 43 9? G- • 9? 0 55
P•n<
w
'75' S5." PH» 5
JbG
fis
3n
Çu
43
G
p8>
- «
a St
n O
S R 'sü esH
3 I I G >
S. V R R -
H. R W m R 'a. G
❖ ❖
3
❖ #
R
-Ht
»
K g g R s 3 g > R R R
❖
*
4». St S R R
3
VS R ❖
88 4+- 3 ❖
88 1 V» R O R R rï V 'S R R R
❖
ÇN R pî V H►
R
« *
3
❖ ❖ ❖ ❖
R4+ -HCN
SI *5 | S►J R •> 3 Rh
s: R g R jj \I
& 88
00 J* R S R I? 3 n» g R >, OO
❖ ❖ * ❖ 88 88 #
-Hè
\p g 'g R G «3 3 V £ S R R JJ i? vo 88
0 R R ;3 3 V O* R R JJ jj 3
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ -K- +F # 4+ 0
£ ■ *^5 R 3 V 'g; w R R JJ
§. 3 88 ❖ n
£ S R 3 1 S R JJ R 3
❖ ❖ ❖ ❖ 88 88 ❖ # # -H- #
St R g V s! R "rt V» R «5 H. 3 -
88 R 3 V > R R > I 3 ❖ ❖ ❖ § 88 88 88 -H- -H- 4+ #
-H-
|g R V s R Ch R R 3 V V «
* « ❖ * m
G\ R
❖
3
❖
V
❖ §
R
❖ ❖ ❖
R
+h
# # #
V
+F
#
Ov '
Éj n V s R > G R 3_ V V
❖
'S -v|
P 0 . 0 CO O ri CO ri H O en O en a O n
DP
5
R3 2.
wû
a
S
c 5"
S
r>
g
0
s
a
g
OZ /O C i.
5’
PR> < S
9?
Cl.
O
SrT
O
§>
«
. 0
0*
s
m '7?’ w. S c 43 fb
î* c 0’ G C
n 5 n »