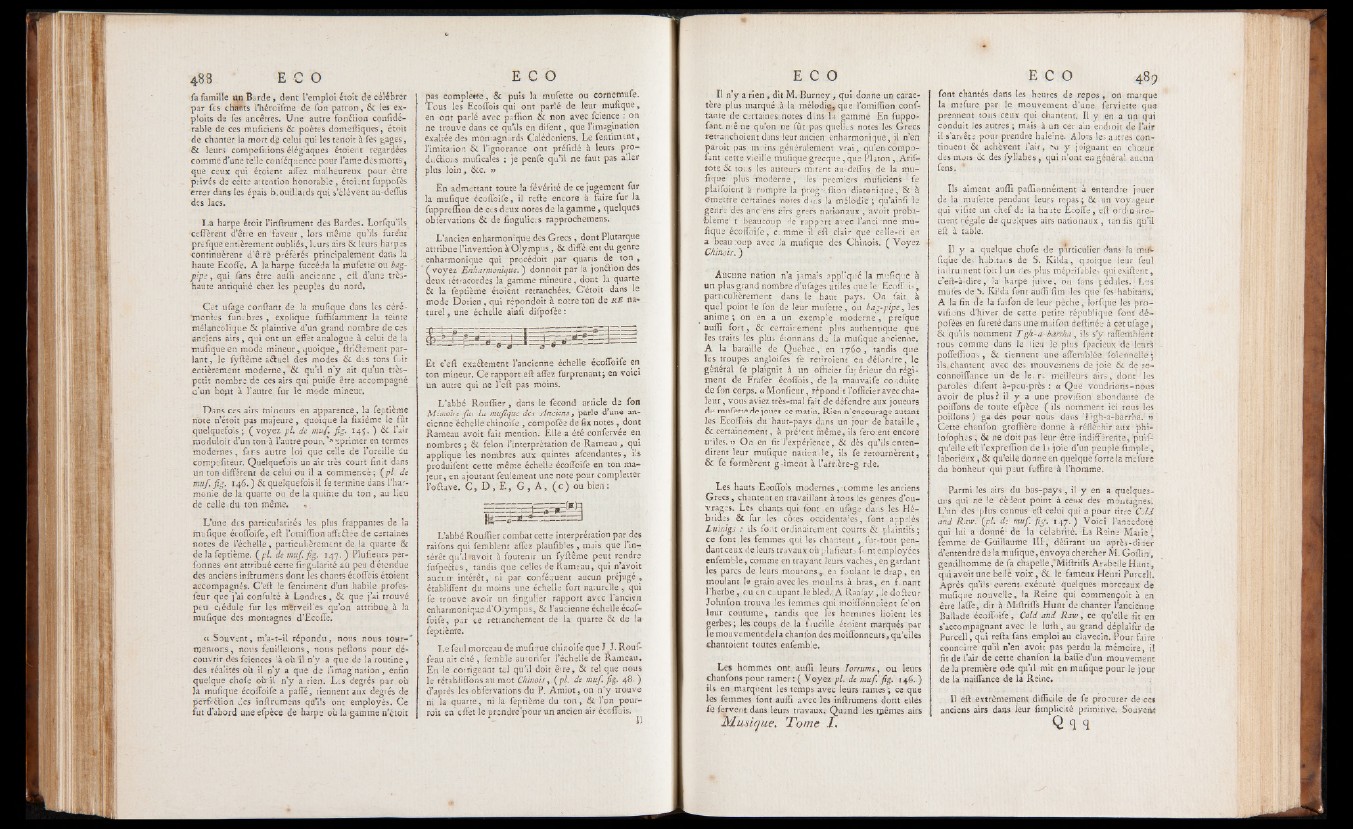
488 E C O
fa famille un Barde, dont l’emploi étoit de célébrer
par fes cHUfs Fhércïfme de fon patron, & les exploits
de fes ancêtres. Une' autre fonélion confidé-
rable de ces muficiens & poètes domeftiques, étoit
de chanter la mort dg celui qui les tenoit à fes gages,
& leurs compofuions élég-aques étoient regardées
comme d’une telle conféqnence pour l’ame des morts,
que ceux qui étaient allez malheureux pour être
privés de cette attention honorable , étoient fuppofés
errer dans les épais b.ouillatds qui s’élèvent au-deflùs
des lacs.
ï,a harpe étoit Finftrument des Bardes. Lorfqu’ils
ceffèrent d’être en faveur, lors même qu’ils fure'nt
prefque entièrement oubliés, leurs airs & leurs hârpes
•continuèrent d’ê.rè préférés principalement dans la J
haute Eeoffe. A la harpe fuccéda la mufette ou bag-
pipe, qui fans être aulli ancienne , eft d’uns très-
haute antiquité chez les peuples du nord.
Çet ufage confiant de la mufique dans les cérémonies
funèbres , explique fuffifamment la teinte
mélancolique & plaintive d’un grand nombre de ces i
antdéns airs, qui ont un effet analogue à celui de la
ïmifique en mode mineur, quoique, fidèlement parlant,
le fÿflême aâuel des modes & des tons foit
entièrement moderne, & qu’il n'y ait qu’un très-
petit nombre de ces airs qui puiffe être accompagné
û’un bopt à l’autre fur le mode mineur.
Dans ces airs mineurs en apparence, la feptième
note n’étoit pas majeure, quoique la fixième le fût
quelquefois; (v o y e z pl. de muf. fig. 145. ) & l’air
moduloit d’un ton à l’autre poun,Exprimer en termes
modernes, fans autre loi que celle de l’oreille du
compofiteur. Quelquefois un air très court finit dans
un ton différent de celui ou il a commencé ; (pl. de
muf. fig. 146. ) & quelquefois il fe termine dans l’harmonie
de la quarte ou de la quinte du ton, au lieu
de celle du ton même» ,
L’une des particularités les plus frappantes de la
mufique écoffoife, eft l’omiflion affeéfée de certaines
notes de l’échelle, particulièrement de la quarte &
de la feptième. (pl. de muf. fig. 147. ) Plufieurs personnes
ont attribué cette fingularité au peu d étendue
des anciens inftrumens dont les chants écoffcis étoient
accompagnés. C ’eft le fentiment d’un habile profes-
feur que j’ai confuite à Londres, & que j’ai trouvé
peu Ciédule fur les mêrveiFes qu’on attribue à la
mufique dés montagnes d’Ecoffe.
« Souvent, m’a-t-il répondu, nous nous tour-*
mentons, nous feuilletons, nous peftons pour découvrir
des fciences là ou il n’y a que de la routine ,
des réalités où il n’y a que de l’imag nation , enfin
quelque chofe où"il n’y a rien. Les degrés par où
la mufique écoffoife a paffé, tiennent aux degrés de
perfeélion ces inftrumens qu’ils ont employés. Ce
fut d’abord uneefpèce de harpe où la-gamme n’étoit
E C O
pas complexe, & puis la mufette ou comemufe.
Tous les Ecoffois qui ont parlé de leur mufique,
en ont parlé avec psflion & non avec fcience : on
ne trouve dans ce qu’ils en difent, que l’imagination
exaltée des montagnards Calédoniens. Le fentiment,
l’imitation & l’ignorance ont préfidé à leurs productions
muficales : je penfe qu’il ne faut pas aller
plus loin, &c. »
En admettant toute la févérité de ce jugement fur
la mufique écoffoife, il refte encore à faire fur la
fuppreflion de ces deux notes de la gamme, quelques
obfervations & de finguliets rapprochemens.
L ’ancien enharmonique des Grecs, dont Plutarque
attribue l’invention à Olympus, & diffé; ent du genre
enharmonique qui procédoit par quarts de ton ,
(voy ez Enharmonique.') donnoit par la jonéfion des
deux tétracordes la gamme mineure, dont la quarte
& la feptième étoient retranchées. C ’étoit dans le
mode Dorien, qui répondoit à notre ton de RE naturel
, une échelle ainfi difpofée :
Et c’eft exa&ement l’ancienne échelle écoffoife en
ton mineur. Ce rapport-eft affez furprenant; en voici
un autre qui ne l ’eft pas moins.
L ’abbé Rouflier, dans le fécond article de fon
Mémoire fur la mufique des Anciens, parle d’üne ancienne
échelle chinoife , compofée de fix notes , dont
Rameau avoit fait mention; Elle a été confervée en
nombres • & félon l’interprétation de Rameau , qui
applique les nombres aux quintes afeendantes, ils
produifent cette même échelle écoffoife en ton majeur,
en ajoutant feulement une note pour completter
l’oClave. C , D , E , G , A , ( c ) ou bien:
L’abbé Roufiïer combat cette interprétation par des
raifons qui femblent affez plaufibles, mais que l’intérêt
quM 'avoit à foutenir un fyftême peut rendre
fufpeéles, tandis que celles de Rameau, qui n’avoit
aucun- intérêt, ni par conféquent aucun préjugé ,
établiffent du moins une échelle fort naturelle, qui
fe trouve avoir un fingulier rapport avec l’ancien
enharmonique d’Oîympus, & l’ancienne échelle écoffoife
, par ce retranchement de la quarte & de la-
feptième.
Le feul morceau de mufique chinoife que J t J. Rouf
feau ait cité , femble aurorifer l’échelle de Rameau.
En le corrigeant tel qu’il doit être, & tel que nous
le rétabliffons au mot Chinois, (pl. de muf. fig. 48.)
d’après les obfervations du P. Amiot, on n’y trouve
ni la quarte, ni la feptième du ton, &. l’on pourrait
en effet le prendre pour un ancien air éceffois.
E C O
Il n’y a rien, dit M. Burney, qui donne un caractère
plus marqué .à la mélodiq^ que l’omiffion conf-
tante de certaines.notes d ms la gammé En fuppo-
fant. mè ne qu’on ne fût pas quelles notes les Grecs
retranchoient dans leur ancien enharmonique, il n’en
paroît pas moins généralement vrai, qu’en composant
cette vieille mufique grecque , que Platon, Arif-
totç.& tous les auteurs mirent au-deflùs de la mufique
plus modërne, les prèmiers muficiens fe
plaifoient à rompre la prog-eflion diatonique, &. à
Omettre certaines notes dans la mélodie ; qu’ainfi le
genre des anciens airs grecs nationaux , 'avoit proba-
bleme t beaucoup rie rapport avec l’anci .nne mufique
écoffoife, c. mme il eft clair que celle-ci en
a beaucoup avec la mufique des Chinois. (V o y e z
Chinois. )
Aucune nation n’a jamais nppl’qné la mufique à
un plus grand nombre d’ufages utiles que le- Ecoffoi>,
particulièrement dans le haut pays. On fait à
quel point le fon de leur mufette, ou bag-pipe, les
anime ; on en a un exemple moderne, prefque
suffi fort, & certairement plus authentique que
les traits les plus étonnans de la mufique ancienne.
A la bataille de Quebec, en 1760, tandis que
les troupes angloifes fe retiraient en défordre, le
général fe plaignit à un officier fur érieur du régiment
de Frafer écoffois, de la mauvaife conduite
de fon corps. « Monfieur, répondit l’officier avec chaleur
, vous aviez très-mal fait de défendre aux joueurs
de mufette de jouer ce matin. Rien n'encourage autant
les Ecoffois du haut-pays dans un jour de bataille,
& certainement, à pré'ent même, ils feraient encore
ufiles. » On en fit l’expérience, & dès qu’ils ,entendirent
leur mufique nation-le, ils fe retournèrent,
& fe formèrent griment à l’afrière-g- rde.
Les hauts EoofTois modernes, comme les anciens
Grecs, chantent en travaillant à tous les genres d’ouvrages.
Les chants qui font en ufage dans les Hébrides
& fur les côtes occidentales , font appelés
Luinigs : ils font ordinairement courts & plaintifs;
ce font les femmes qui les chantent, fur-tout pendant
ceux de leurs travaux où plufieurs font employées
enfemble, comme en trayant leurs vaches, en gardant
les parcs de leurs moutons * en foulant le drap, en
moulant le grain avec les moulins à bras, en fi.nant
l’herbe, ou en coupant le bled.-; A Raafay, le dofteur
Johnfon trouva les femmes qui moiffonnoiênt fe’ori
leur coutume, tandis que les hommes lioient les
gerbes; les coups de. la,faucille étoient marqués par
Te mouvement delà chanfon des moiffonneurs, qu’elles
chantoient toutes enfemble.
Les hommes ont. aufli leurs Iorrums, ou leurs
chanfons pour ramer: ( Voyez pl. de muf fig. 146.)
ils en marquent les temps avec leurs rames ; ce que
les femmes font aufli avec les inftrumens dont elles
fe fervent dans leurs trayaux. Quand les thèmes airs
Musique, 'Tome J.
E C O 489
font chantés dans les heures de repos, on marque
la mefure par le mouvement d’une ferviette que
prennent tous ceux qui chantent. Il y en a un qui
conduit les autres ; mais à un cer a in endioit de l’air
il s'arrête pour prendre haleine. Alors les autres continuent
& achèvent l’air, eu y joignant en choeur
des mots & des fyllabes, qui n’ont en général aucun
fens, *
Ils aiment aufli paflionnément à entendre jouer
de la mufette pendant leurs repas ; &, un voyageur
qui vifite un chef de la haute Êcoffe, eft ordinuirement
régalé de quelques airs nationaux , tandis qu’il
eft à table.
Il y a quelque chofe de particulier dans fa rriif-
fiqùe des habitais de S. Kilda, quoique leur feul
infiniment foit 1 un des plus méprifabies qui exiftent,
c’eft-à-dire, la harpe juive, ou fans pédiles. Les
mufes de S. Kilda font aufli fi mules que fes habitans.
A la fin de la faifon de leur pêche, loffque les pro-
vifions d’hiver de cette petite république font' dé-
poféès en fureté dans une muifon deftinée à cet ufage*
& qu’ils nomment Tgh-a-barrha, ils s y raffemblent
tous comme dans le lieu le plus fpacieux de leurs
poffeffions , & tiennent une aflemblée folennelléj
ils. chantent avec des mouvemens de joie & de re-
connoiffance un de leur; meilleurs airs, dont les
paroles difent à-peu-près : « Que voudrions-nous
avoir de plus? il y a une provifion abondante de
poilfons de toute efpèce ( ils nomment ici tous les
poiflons) ga.dés pour nous dans Tigh-a-barrha. >?
Cette chanfon groffière donne à réfléchir aux phi-
lofophcs, & ne doit pas leur être indifférente, puif-
qu’elle eft l’expreffion de l j joie d’un peuple finiplè ,
laborieux, & qu’elle donne en quelquè fortela mefure
du bonheur qui peut fuffire à l’horame.
Parmi les airs du bas-pays, il y en a quelques-
uns qui ne le cèdent point à ceux des montagnes.
L’un des plus connus eft celui qui a pour titre CAd
and Raw. (pl. de muf fig. 147.) Voici Fanée dote
qui lui a donné de la célébrité. La Reine Marie
femme de Guillaume 111, délirant un après-dîner
d’entendre de la mufique, envoya chercher JVI. Goflin,
gentilhomme de fa chapelle ,‘Miftriffs ArabeileHunt,
qui avoit une belle voix , & le fameux Henri Purcell.
Après qu’ils - eurent, exécuté quelques morceaux de
mufique nouvelle, la Reine qui cômmençoit à en
être laffe, dit à Miftriffs Hunt dechanter l’ancienne
Ballade écoffoife, Cold and Raw, ce qu’elle fit en
s’accompagnant avec le luth, au grand déplaifir de
Purcell, qui refta fans emploi au clavecin. Pour faire
connaître qu’il n’en avoit pas perdu la mémoire, il
fit de l’air de cette chanfon la baffe d’un mouvement
de la première ode qu’il mit en mufique pour le jour
de la naiffance de la Reine.
Il eft extrêmement difficile de fe procurer de ces
anciens airs dans leur fimpUcité primitive, Souyeot
Q 9 q