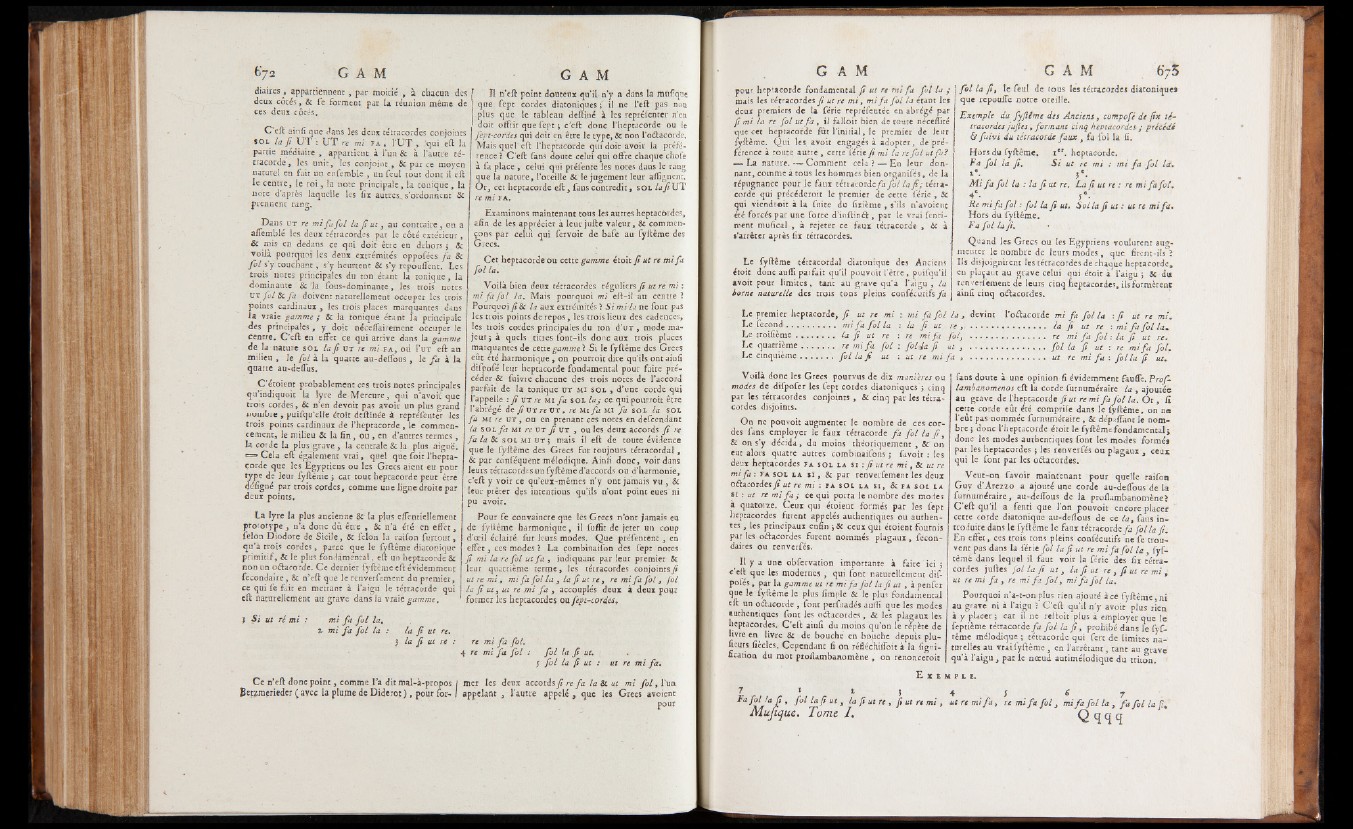
diaires, appartiennent , par moitié , à chacun des
deux cotés, & fe forment par la réunion même de
ces deux côtés.
C eft a in fi que dans les deux tétracordes conjoints
SOL l a f i U T : U T r e m i fa , l’U T , :qni eft la
partie médiaire , appartient à l’un & à l’autre té-
tracorde, les unit, les conjoint., & par ce moyen
naturel en fait un cnfemble , un feul tout dont il eft
le centre, le ro i, la note principale, la tonique , la
note d’après laquelle les fis autres.. s’ordonnent 8c
prennent rang.
Dans ut r e m i f a f o l l a f i u t 3 au contraire, on a
aflemblé les deux tétracordes par le côté extérieur,
& mis en dedans ce qui doit- être en dehors j 8c
voila pourquoi les deux extrémités oppofées f a 8c
f o l s ’y touchant, s’y heurtent & s’y repouflent. Les
trois notes principales du ton étant la tonique, la
dominante 3c la fous-dominante, les trois notes
ut /o/ 3c f a doivent naturellement occuper les trois
points cardinaux , les trois places marquantes dans
la vraie g a m m e y 8c la tonique étant la principale
des principales, y doit nécefTairement occuper le
centre. C ’eft en effet ce qui arrive dans la g a m m e
de la nature sol l a f i ut r e m h a , où Tut eft au
milieu , le f o l à. la quarte au-deffous , le f a à la
quarte au-deflus.
C ’étoient probablement ces trois notes principales
qu’indiquoit la lyre de Mercure, qui n’avôît que
trois cordes, 8c n’en devoir pas avoir lin plus grand
nombre , puifqu’elle étoit deftinée a repréfenter les
trois points cardinaux de l’heptacorde, le commencement,
le milieu 3c la fin, ou , en d’autres termes ,
la corde la plusjgrave , la centrale 8c la plus aiguë.
=» Cela eft également vrai, quel que foit l’hepta-
çorde que les Egyptiens ou les Grecs aient eu pour
type de leur fyftênie ; car tout heptacorde peut être
défigné par trois eprdes, comme une ligne droite par
deux points,
La lyre la plus ancienne 8c la plus cfTentiellement
prototype, n’a donc dû être , 8c n’a été en effet,
(elon Diodore de Sicile, 8c félon la raifon furtout,
qu’à trois cordes, parce que le fyftême diatonique
primitif, & le plus fondamental, eft un heptacorde 8c
non un o&acordc. Ce dernier fyftême eft évidemment
fécondai re, 8c n’eft que le renverfement du premier,
ce qui fe fait en mettant à l’aigu le tétraçorde qui
eft naturellement au grave dans la vjraiç g a m m e ,
J Si ut ré mi : mi fa fo l la.
7- m i f a f o l la : la f i u t re.
$ la f i u t re :
Ce n’eft donc point, comme l ’a dit mai-à-propos I
Bet^mcriedcr Çavcc la plume de Didero? ) , pour for- I
J II n’eft point douteux qu’il n’y a dans la mufique
J que fept cordes diatoniques ( il ne l’eft pas non
plus que le tableau deftiné à les repréfenter n’en
* doit offrir que fept ; c’cft donc l’heptacorde ou le
fept-cordes qui doit en être le type, 8c non l’oétacorde.
Mais quel eft l’heptacorde qui doit avoir la préférence
? C'eft fans doute celui qui offre chaque chofe
à fa place , celui qui préfentc les notes dans le rang
que la nature, l’oreille 8c le jugement leur affignent.
Or, cet heptacorde eft , fans contredit, so l la f i UT
re mi fa.
Examinons maintenant tous les autres heptacôrdes,
afin de les apprécier à leur jufte valeur, 8c commençons
par celui qui fervoit de bafe au fyftême des
Grecs.
Cet heptacorde ou cette gamme étoit f i ut re mi fa
fo l la.
Voilà bien deux tétracordes réguliers f i ut re mi ;
mi fa fo l la. Mais pourquoi mi eft—il au centre ?
Pourquoi f i 8c la aux extrémités? Simula ne font pas
les trois points de repos, les trois lieux des cadences,
les trois cordes principales du ton d’üT , mode majeur
j à quels titres font-ils donc aux trois places
marquantes de cetttgamme'i Si le fyftême des Grecs
eût été harmonique, on pourroic dire qu’ils ont ainfi
difpofé leur heptacorde fondamental pour faire précéder
8c fuivre chacune des trois notes de l’accord
parfait de la tonique ut mi sol , d’une corde qui
l’appelle : f i ut re mi f a so l la; ce quipourroit être
l’abrégé de fi U TreUT, re mi fa mi fa sol la SOL
fa mi re ut , ou en prenant ces notes en defeendant
la so l fa mi re ut f i u t , ou les deux accords f i re
fa la 8c so l mi u t 5 mais il eft de toute évidence
que le fyftême des Grecs fut toujours tétracordal ,
& par conféquent mélodique. Ainfi donc, voir dans
leurs tétracordfsunfyftêmed’accords ou d’harmonie,
c’eft y voir ce qu’eux-mêmes n’y ont jamais vu , 8e
leur prêter des intentions qu’ils n’ont point eues ni
pu avoir.
Pour fc convaincre que lès Grecs n’ont jamais eu
de fyffême harmonique, il fuffit de jeter un coup
d’oeil éclairé fur leurs modes. Que préfentent , en
effet, ces modes ? La çombinaifon des fept notes
f i mi la re fo l ut f a , indiquant par leur premier 8c
leur quatrième terme, les tétracordes conjoints^
ut re mi , mi fa fo l la , la f i ut re , re mi fa f o l , fo l
la f i u t, ut re mi f a , accouplés deux à deux pom:
former les heptacôrdes ou fept-cordes.
re mi fa fol.
4 re mi fa fo l : fo l la f i ut.
5 fo l la fi ut : ut re ml fa .
mer les deux accords ƒ re fa la 8c ut mi f o l , l’un
appelant , l’autre appelé , que les Grecs avoienc
pour
pour heptacorde fondamental f i ut re mi fa f o l la y
mais les tétracordes f i ut re m i , m i fa f o l la étant les
deux premiers de la férié rcpréfencéc en abrégé par
fi m i la re f o l ut fa , il falloir bien de toute néceffîté
que cet heptacorde fût l’initial, le premier de leur
lyftêmc. Qui les avoit engagés à adopter, de préférence
à toute autre , cette férié f i m i la re fo l ut fa?
—- La nature. —■ Comment cela ? — En leur donnant,
comme à tous les hommes bien organifés, de la
répugnance pour le faux tétraçordeƒ<* Jol la fi; tétra-
corde qui précédcroit le premier de cette férié , 8c
qui viendroit à la fuite du fixième , s’ils n’avoient
été forcés par une forte d’inftinéi, par le vrai fenti-
roent mufical , à rejeter ce faux tétraçorde , &c à
s’arrêter après fix tétracordes.
Le fyftême tétracordal diatonique des Anciens
étoit donc auffï paifait qu’il pouvoit l'être , puifqu’ii
avoit pour limites, tant au grave qu’à l’aigu , la
borne naturelle des trois tons pleins confécutifs fa
fo l la f i , le feul de tous les tétracordes diatonique»
que repouffe notre oreille.
Exemple du fyfiême des Anciens, compofé de fix tétracordes
jufies, formant cinq heptacôrdes y précédé
fuivi du tétraçorde fa u x , fa fol la fi.
Hors du fyftême, i*r. heptacorde.
Fa fo l la fi. S i ut re mi : mi fa fo l Id.
1 *r. I 3e-
A li fa fo l la : la f i ut re, La fi ut re : re mi fa fo l.
4e- I 5e-
Re mi fa fo l : fo l la f i ut. Sol la f i ut : ut re mi fa .
Hors du fyftême.
Fa fo l la fi.
Quand les Grecs ou les Egyptiens voulurent augmenter
le nombre de leurs modes , que firent-ils ?
Ils disjoignirent les tétracordes de chaque heptacorde,
eu plaçant au grave celui qui étoit à l’aigu 5 8c dut
ren /crfèment de leurs cinq heptacôrdes, ils formèrent
ainfi cinq o<ftacorde$.
Le premier heptacorde, f i ut re mi : mi fa fo l
Le fécond..................... mi fa fo l la 1 la f i ut
Le croifième................ la f i ut re : re mi fa
Le quatrième.............. re mi fa fo l : fol^a fi
Le cinquième . . . . . . . fo l la f i ut : ut re mi
Voilà donc les Grecs pourvus de dix maniérés ou
modes de difpofcr les fept cordes diatoniques 5 cinq
par les tétracordes conjoints , 8c cinq par les tétracordes
disjoints.
On ne pouvoit augmenter le nombre de ces cordes
fans employer le faux tétraçorde f a f o l l a f i ,
8c on s’y décida, du moins théoriquement , 8c on
eut alors quatre autres combinaifons ; favoir : les
deux heptacôrdes fa sol la si : f i u t re m i, 8c u t re
mi fa : fa sol la s i , 8c par renverfement les deux
oftacordes f i u t r e mi ; fa so l l a s i , 8c fa so l la
fi : u t re mi fa y ce qui porta le nombre des modes
à quatorze. Ceux qui étoient formés par les fept
heptacôrdes furent appelés authentiques ou authen-
tes , les principaux enfin j8c ceux qui étoient fournis
par les odfcacordes furent nommés plagaux, fecon-
daires ou renverfés.
Il y a une obfervation importante à faire ici 5
c eft que les modernes , qui font naturellement dif-
pofes, par la gamme u t re mi f a f o l la f i u t , à penfer
que le fyftême le plus fimple & le plus fondamental
eft un odacorde , font perfuadés auffï que les modes
authentiques font les o&acordcs, 8c les plagaux les
heptacôrdes. C ’eft ainfi du moins qu’on le répète de
livre en livre 8c de bouche en bouche depuis plusieurs
fiècles. Cependant fi on réfléchiffoit à la figni-
ficatiou du mot profiambanomène, on renonceroit
E x e
7 1 1 j
F a f o l la f i , f o l l a ß u t , la fi u t re , f i u t re m i ,
Mufique. Tome I .
la , devint l’oélacordc mi fa fo l la : f i ut re mi.
'e 3l . . . . . . . . . . . . . . . la f i ut re : mi fa fo l la»
~ol, .................................. re mi fa fo l : la f i ut re.
t 3 ................................fo l la f i ut : re mi fa fol.
1 » ................................ ut re mi fa : fo l la (i ut.
fans doute à une opinion fi évidemment faufic.Profa
lamhanomtnos eft la corde fur numéraire la , ajoutée
au grave de l’heptacorde f i ut re mi fa fo l la. O r , fi
cette corde eût été comprife dans le fyftême, on ne
l’eût pas nommée furnuméraire, 8c dépaflant le nombre
; donc l’heptacorde étoit le fyftême fondamental ;
donc les modes authentiques font les modes formé»
par les heptacôrdes j les renverfés ou plagaux , ceux
qui le font par les o&acordes.
Veut-on fa voir maintenant pour quelle raifon
Guy d’Arezzo a ajouté une corde au-deflous de la
furnuméraire, au-deffous de la proflambanomène?
C ’eft qu’il a fenti que l’on pouvoit encore placer
cette corde diatonique au-deffous de ce la, fans introduire
dans le fyftême le faux tétraçordeyâ folia f im
En effet, ces trois tons pleins confécutifs ne fe trouvent
pas dans la férié fo l la f i ut re mi fa fo l la , fyf-
têmè dans lequel il faut voir la férié des fix tétracordes
juftes fo l la f i ut , la f i ut re , f i ut re mi ,
ut re mi fa 3 re mi fa f o l , mi fa fo l la.
Pourquoi n’a-c-onplus rien ajouté à ce fyftême, ni
au grave ni à l’aigu ? C ’eft qu’il n’y avoit plus rien
à y placer ; car il ne reftoit plus à employer que le
fepeième tétraçorde fa fo l la f i , prohibé dans le fyftême
mélodique ; tétraçorde qui fert de limites naturelles
au vrai fyftême , en l’arrêtant , tant au grave
qu’à l’aigu , par le noeud antimélodiquc du triton. I
P L I .
4 4>, I . 6 7
ut re m ifa , re mifa f o l , mi fa fo l la , fa fo l la JiJ
Qqqq