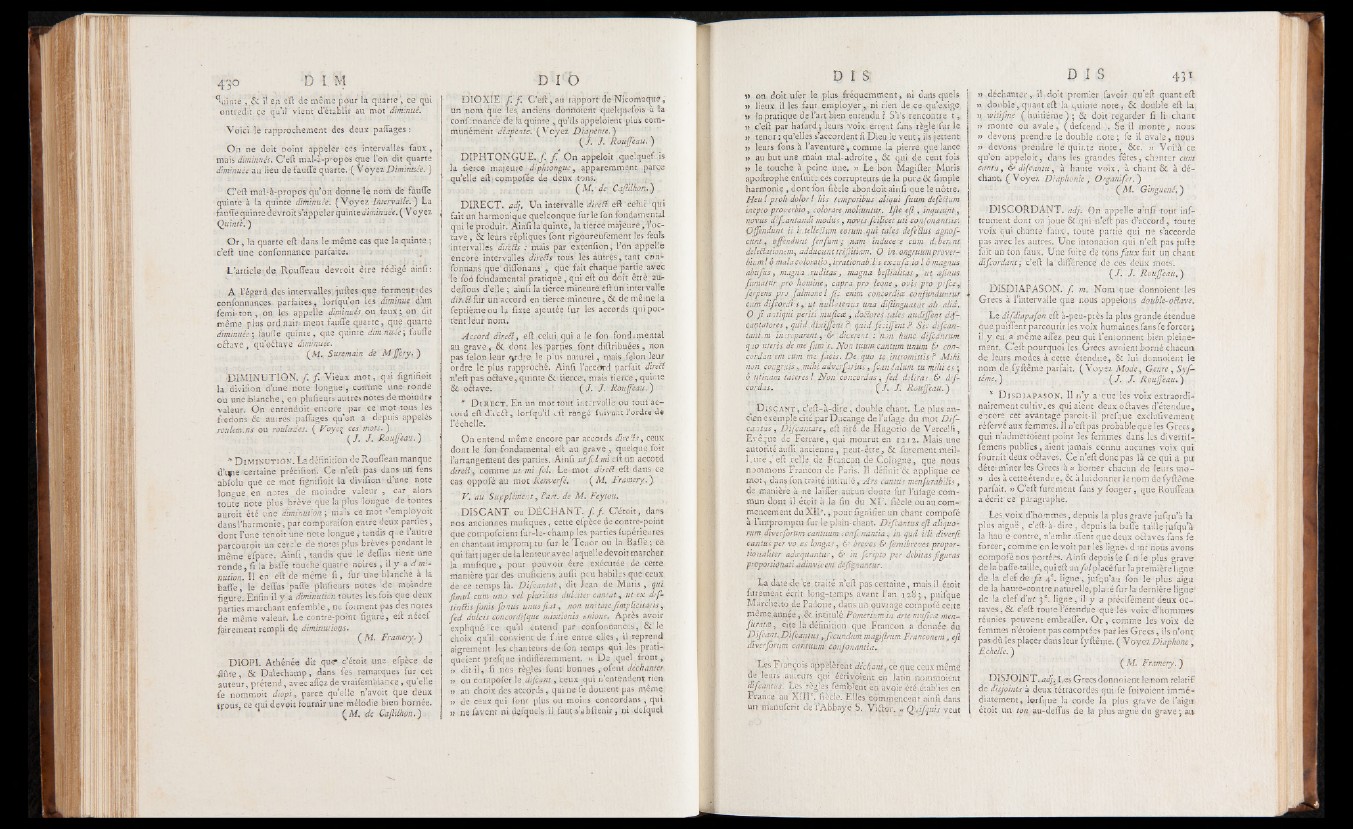
%intê , & I en e'ft de inertie pour là quarte , ce qui
ontredit ce qu’il vient d’établir au m o i diminué.
Voici le rapprochement des deux paffages:
On ne doit point appejer ces intervalles faux ,
mais diminués. C ’eft mal-a-p’ropôs que l’on dit quarte
diminuée au lieu de fauffé quarte..■ ( Voyez Diminuée. )
G’ eft maFà-propas; qu’on donné le nom de Fâufle
quinte: à la quinte diminuée. (V o y e z Intervalle.') La
fauffé quinte devroit s’appeler cfimiediminuée. ( Voyez
Quinte.')
O r , la quarte eft dans le même cas que la quinte ;
.c’eft. une confonnanee parfaite.: • : j aa :
L ’article\de Rpuffeau devroit être rédige ainfi:
A l’égard- des interY.a}l,es, 'juftes que forment’ des
confonnances- parfaites-, ‘ lorlqu’on les diminue d-un
femi-ton , on les appelle diminués r ou .faux ; on dit
même plus ord.nairîment fauffe quarte, qus quarte
diminuée• ; fauffe quinte, que quinte dim.mue; fauffe
oâaye /q u ’oélave diminuée.
(M, Suremuin de Mffçry. )
DIMINU TION./. / Vieux mot, qui fignifioit
la. divifion drune note longue , comme une ronde
ou urieiilanche, en pluffeqrs autres notes de moindre
valeur. On entendoit encore par ce mot tous les
fredons & autres paffages qu’on a depuis appelés
roulem.ns ou roulades. ( Voyez ces mots. ), |
. ( / . J. -Rouffeau. )
* D im in u t io n . La définition de Rouffeau manque
d’tfie certaine précifioxi. Ce n’eft pas dans un fens
abfolu que ce mot fignifioit la diviffon- d’une note
longue, en notes.de moindre valeur , car alors
toute note plus brève que la plus longue de toutes
auroit été une diminution ; niais ce mot ‘•’employoit
dans l’harmonie, par comparaifon entre deux parties,
dont l’une ténoit une note longue , tandis w e l’autre
parco-uroit un cercle de notes plus brèves pendant le
même; efpace. Ainff , tandis que le deffus tient une
ronde, ff la baffe touchequatré noires , il y a d minutions
Il en eft de même f i, fur une blanche à k
baffe, le deffus paffe ptüffeuts notes 'de moindre
figure-Erifin il y a diminutic'n toutes les>fois que deux
parties marchant enfembîe, ne foiment pas des notes
de même valeur. Le contre-point figuré, eft nécef
fairement rempli dç diminutions.
( M. Frarnery. )
DIOPI. Athénée dit qu<? c’étoit une efpèce de
^ û te , & Dalechamp, dans fes remarques fur cet
auteur, prétend, avec allez de vraisemblance , qu elle
Ce nommoit diopi, parce qu’elle n’avoit que deux
trous ce qui devoir fournir une mélodie bien bornée.
1 (M . de Çafiilhom).
DIOXÏE. f f . C ’éft, au rapport de Nicomaque ;
un nom que'les. anciens donnoient quelquefois à la
confiennaiïce dé‘la quinte , qu’ils appeloierit plus communément
‘diapente. ( Voyez Ffiapènte. )
( / . J. Rouffeau. ')
DIPH TO N G U E .,/ f . On appeloit quelquefois
la tierce majeure diphtongue, apparemment ;parçe
qu’elle- eft;cpmpofée de deux tons.;
( M. de\ Cqffdhptu f) .
DIRECT, adj. Un intervalle dirééf. eft'celuiqui
fait un harmonique quelconque furie fon fondamental
qui le produit. Ainff la quinte, la tiéfcé màjeuré, l?oc-
tave, & letirs répliques font rigôureùfement les feuls
intervalles difçEls : mais par extenfion ; l’ôn appelle
"encore intervalles direéls'tous les autres, tant con-1
fiônnans que' diffonansi, que fait chaque partie avec
4è fort fondamental pratique, qui eft ou doit êtrè.aür
deffous d’elle; ainff la tierce mineure eft uri‘ intervalle
dih&{iir Un accord en tierce mineure, & de même !a
feptième ou la fiixte ajoutée fur les'accords qui portant
1 dur nom.
Accord direEii eft celui qui a le fon fondamental
.au grave, & dont les parties.„font diftribuées, non
pas félon leur y dre- le pris naturel, mais%f^lon leur
ordre lé plus rapproché. Ainff l’accdfd parfait direél
n’eft pas oftave, quinte &. tierce?; mais tierce, quinte
-& oàave. . : ! . (<ƒ. J. Rouffeau. ) '
* D ire ct. En un mot tout intervalle ou tout accord
eftdireét, lorfqu’il eft rangé fuivant l’ordre de
f échelle.
On entend même encore par accords dire il s , ceux
dont le fon:fondamental eft au gravequelque; foit
l’arrangement des parties.. Ainff ut [cl mi eltun accord
dïretf;, comme ut mi fol., Le? mot diretfeft dans ce
cas oppofé: au mot Renverfé: > l ( M. Frarnery.).
V. au Suppléaient, Vart. de M. Feytou,
DISCAN T ou DÉCHANT, ƒ ƒ. C ’étoit, dans
nos anciennes mufiques, cette efpèce de contre-point
que compofoient fur-la- champ les parties fu perleures
en chantant impromptu fur le Ténor ou la Baffe ; ce
qui fait juger de la lenteur.ayec.)aquelle devoit marcher
la muffque, pour pouvoir être exécutée de cette
manière par des muficiens aufli peu habilssque ceux
de ce temps là. Difcantat, dit Jean de Mûris, qui
fimul cum uno v.el plurïbus dulciter cantat, ut ex dif-
tinélis finis finus mus fiat, .non unitatefimplicitatis
fid dulcis concordi/que mixtionis unione. Après avoir
expliqué - ce qu’il entend’ par conformances , , &' le
choix .qu’il convient de faire entre ejjçs, il f reprend
aigrement les chanteurs déifon temps qui les pratiquèrent
prefique indifféremment. « Da jquel front,
j, dit-il, ff nos règles font- bonnes, ofent déchanter
v ou comppfer 1 édifiant, Ceux -qui n’entendent rien
n au choix .des accords , qui.ne fe doutent p^s meme
» de ceux qui font plus ou moins concorda ns, qui
n ne favent ni dôfquels il. faut s’abftenir, ni defquel
» on doit ufer le plus fréquemment, ni dans quels
» lieux, il les faut em p lo y e rn i rien de ce qu’exige.
» la pratique de fart bien entendu ? S’i's rencontre t ,
» c’eft par ha fard; leurs voix errent fans règle fur le
» ténor : qu’elles s’accordent ff Dieu le veut ; ils-jettent,
n leurs fions à l’aventure y comme la pierre que lance
» au but une main mal-adroite , & qui de cent fois
j> le touche à peine une. Le bon Magifter Mûris
apoftrophe enfiuit's.ces corrupteurs de la pure & fimple
harmonie , dont fion ffècle abondoit ainff que le nôtre.
Heu! proh dolorl his temporibus aliquï fuum defeMum
inepto proverbio ,. colorare, moltuntur.. Ifie efl , .inquiünt-,
novus dîfiantandi modu s , novis.fiilïçet uti conjonàntïis'.
Offendunt ït in telle ilurn eorum.qui taies de fe élus agnof-
cunt, ojfendunt fenfum ; nam induce'e cum dFer<.nt
deleélationemy adducunt trifiitiam. Q in:ongruumprov,erbium!
o mala Colorado, irrationab.ljs, excufa. io ! b magnus
abùfus, magna j.uditas, magna bsfiialitas , ut ajînus
fumât ùr pro homme, capra pro leqne , oyis pro pi fie
firpens pro Jalmone! fie, enim concordiez confunduntur
cum difcordVs ,• ut àullatenust una diflinguatur, ah aliâ.
O. f i antiqui periti niuficez , doBores taies audiffint dif-
çaqtatores, qitid fiixiffent? quid feeijjentP Sic difean-
tant.m in :rcparent, & dicerent : non hune difcanlum.
q.io uteris de me fini \s. Non tuumeantum unum & con-
-cordan'cm cum me façis. De qitp te intromïtiis ? Mihi
non tpngruis, mihi advèrfi.nus, fcan-Iàlum tu mihi es ;
0 utinam taceres /. Non 'concordas ; fed déliras & dif-
cor.dns. ( j : \ . , -- y . ( /. J. Rouffeau. ) ..
D isçant, c’eft-à-dir.e, double, chant. Le plus ancien
exemple cité .par Ducange de l’ufage du mot Dif-
cantus, Difcantare, eft tiré de Hugotro de Vercel li,
Evêque de Ferrare, qui'mourut en 1212. Mais une
autorité aufff ancienne, peut-être, & fiurement meil-
Lu’re , èft /elle de Francpn. de Cologne., que nous
nommons Francon de Paris. Il définit & applique ce
mot , dans fion traité intitulé ,r Ans camus menfurabilis,
de manière a, ne laiffer.aucun doute fur l’ufage commun
dont il étoit à la fin du XF. ffècle ou au commencement
du XIIe. , pour figniner un chant compofé
à l’impromptu fur le plain-chant. Difcantus efl ali quorum
dïvçrforUm cantuum confienanda, in quâ illï diverfi
cantus per vo.es longas, & brèves & femibreves propor-
tionaliter adecquantur, & in feripto per débitas figuras
proportiûnati adinviceni dèfignantur.
La date-de 'ce, traût.é n’eft pas certaine, mais il étoit
fiu rement écrit long-temps avant l’an 1283 , puifque
Marchectô de Padoue, dans un ouvrage compofié certe
meme..année ,\&.intitulé Pomérium in arte muficee men-
furatez| cite là définition que Francon a donnée du
pifirtfit. DtfcanLus ,fecundu!n magiflrum Franconem, efl
diverfirupi cantuum confonantia. ' .
Les François appëlèrènt déchantce .que ceux même.
allteurs, qui eçriyôient eh latin .nommoient
difcantus. Les /ègleisfém/lerit en avoir été'.établies en
France au X J Ie. fiècle. Elles commencent ainff dans
un manuferi t de l ’Abbay e S. VïéWr,’^ Qdfquis ye\it
» déchanter, il doit -premier fiavoir qu’eft quant eft
» double,quant eft la quinte note, & double eft la,
vs witifme ( huitième ).; & doit regarder ff li chant
n monte ou avale, (defeend ). Se il monte, nous
n devons prendre le double note ; fe il avale, nous
» devons prendre lé quir.te noie, &c. Voilà ce
qu’on appeloit, dans les grandes fêtes, chanter cum
caiitii, & difcantu, à haute voix, à chant & à déchant,
.( Voyez Diaphonie, Organifer. )
' ( M. Ginguené. )
DISCORDANT, adj. On appelle a'njï -tout inf-
trument dont on joué &.qui n’eft pas d’accord, toute
voïx oui chanté faux, toute partie qui ne s’accorde
pas avec les autres. Une intonation qui n’eft pas jufte
fait un ton,faux. Une fuite de tons faux fait un chant
difçordarit ; c’eft la différence de ces deux mots’.
( / . J. Rouffeau. )
DISDIAPASON. / m. Nom que donnoient les
Grecs à 1 intervalle que nous appelons double-oélave.
~Le difdiapafin eft à-peu-près la plus grande étendue
àue.puiffent parcourir, les voix humaines.fans fe forcer;
il y en a mêmeafî’ez peu qui l’entonnent bien pleinement.
C ’eft pourquoi, les Grecs a voient borné chacun
de leurs modes, à cette étendue, & lui donnoient le
nom.de, fyftême parfait. (V oyez Mode, Genre , Syf-
téme. ) . (J. J. Rouffeau. )
* D is d ia p a s o n . Il n’y a -que les voix extraordinairement
cultivées ,qui aient deuxoélaves d’étendue,
encore cet avantage paroît-il prefique exclufivement
réfervé aux femmes. Il n’eft pas probable que les Grecs,
qui n’admettoient point les femmes dans les divertif-
femens publics, aient jamais connu aucunes voix qui
fournît deux o&aves. Ce n’eft donc pas là ce qui a pu
déterminer les Grecs à « borner chacun de leurs tno-
5) des à cette,étendue, & à lui donner le nom de fy ftêm e
parfait. » C’eft fixement fans y fonger, que Rouffeau
a écrit ce paragraphe.
Les voix d’h om m e s , depuis la plus grave jufqu’à la
plus aiguë , c eft-à-dire, depuis la baffe taille jufiqifià
la hau e-contre, n’embr.iffent que deux oélaves fans fe
forcer; comme en le voit par les lignes dm mous avons
compofé nos portées. Ainff depuis te fi. n le plus grave
de la baffe-taille, quieft un//placé fur la première ligne
de la clef de fa 4e. ligne ,,jufqu’au fion le plus aigu
de la hauré-contre naturelle, pla:é fur la dernière ligne'
de la clef élut 3e. ligne, il y a pré cifément deux octaves
, & e’eft to u te l’étendue què les voix d’hommes
réunies peuvent embraffer. O r , comme les voix de
femmes ri’étoient pas comptées par. lès Grecs, ils n’ont
p ab â û les placer dans leur fyftême. ( Voyez Diaphane,
Echelle.)
( M. Frarnery. )
DISJOINT, 4 ^ 1 j es Grecs donnoient lenom relatif
de disjoints à deux tétracordes qui fe fuivoient immé--
diatement^ lorfque la corde la plus grave de l’aigu
étoit un ton au-deffus de la plus aiguë du grave ; au