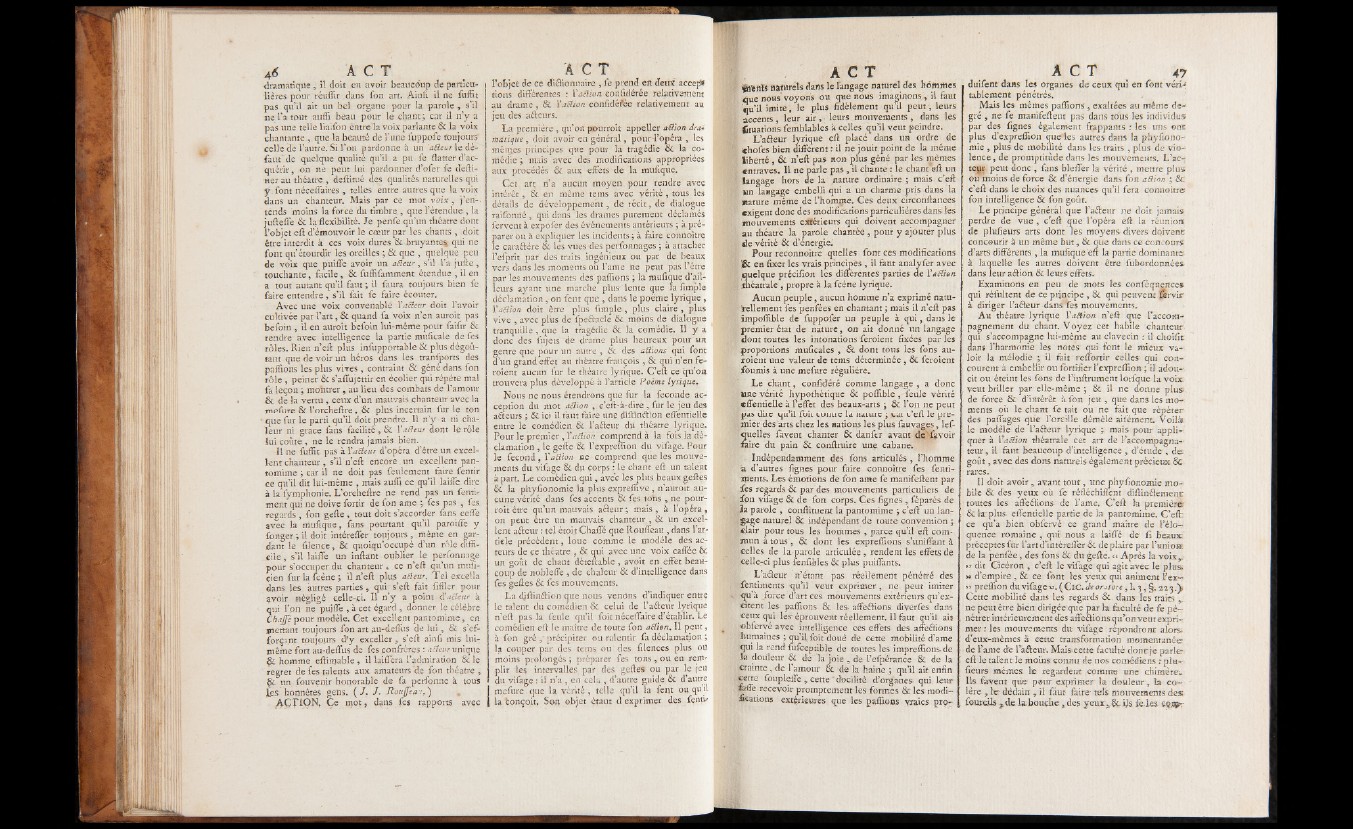
À C T
dramatique , il doit en avoir beaucoup de particulières
pour réuflir .dans fon art. Ainfi il ne fuffit
pas qu’il ait un bel organe pour la parole , s’il
11e l’a tout aufli beau pour le chant ; car il n’y a
pas une telle liaifon éntre’la voix parlante & la voix
chantante ., que la beauté de l’une fuppofe toujours'
celle de l’autre. Si l’op pardonne à un ’aEleur le défaut’de
quelque qualité qu’il a pu fe flatter d’acquérir
, on ne peut lui pardonner d’ofer fe dèfti-
•Her au théâtre , deftitué des qualités naturelles qui
Ÿ font néceffaires , telles entre autres que la voix
dans un chanteur. Mais par ce mot v o ix , j’en-,
tends moins la force du timbre , que l’étendue , la
juftefl'e .& la flexibilité. Je penfe qu’un théâtre dont
l’objet eft d’émouvoir le coeur par les chants , doit
être interdit à ces voix dures & bruyantes, qui ne
font qu’étourdir les oreilles ; & que , quelque peu
de voix que puiffe avoir un atteur, s’il l’a jufte,
touchante, facile, & fuffifamment étendue , il en
a tout autant qu’il faut ; il faura toujours bien fe
faire entendre, s’il fait fe faire écouter.
Avec une voix convenable l'acteur doit l’avoir
cultivée par l’art, & quand fa voix n’en auroit pas
befoin , il en auroit befoin lui-même pour faifir &
rendre avec intelligence la partie muficale de fes
rôles. Rien n’eft plus infupportable & plus dégoûtant
que de voir un héros dans les tranfports des
paflions les plus vives , contraint & gêné dans fon
rôle , peiner & s’affujettir en écolier qui répète mal
fa leçon ; montrer , au lieu des combats dé l’amour
& de la vertu , ceux d’un mauvais chanteur avec la
mefure & l’orcheftre, .& plus incertain fur le ton
que fur le parti qu’il doit prendre. Il n’y a ni chaleur
ni grâce fans facilité, & Ydfleur dont le rôle
lui coûté, ne le rendra jamais bien.
Il ne fuffit pas à Y.aEleur d’opéra, d’être un excellent
chanteur, s’il n’efl: encore un excellent pantomime
; car il ne doit pas feulement taire fentir
ce qu’il dit lui-même , mais aufli ce qu’il laiffe dire
à la fymphonie. L’orcheftre ne rend pas un fentir
ment qui ne doive fortir de fon ame- ; fes pas , fes.
regards, fon gcfte, tout doit s’accorder fans eeffe
avec la mufique, fans pourtant qu’il paroifle y
fonger ; il doit intérefler toujours , même en gar^
dant le filençe, & quoiqu’occupé d’un rôle difficile
, s’il laiffe un inftant oublier le perfonnage
pour s’occuper du chanteur , ce n’eft qu’un mufi-
çien fur la fcène ; il n’eft plus afteur, Tel excella
dans les autres parties, qui s’eft fait fiffler pour
avoir négligé celle-ci. U n’y a point d'afteur à
qui l’on ne puiffe , à cet égard , donner le célèbre
ChaJJe pour modèle. Cet excellent pantomime, en
mettant toujours fon art uu-defîùs de lu i, & s’efforçant
toujours d?y exceller, s’eft ainfi mis lui-
même fort au-deffus de fes confrères : aEleur unique
& homme eftimable , il laifîera l’admiration & le
regret de fes talents aux amateurs 'de fon théâtre ,
& un fouvenir honorable de fa perforine à tous
Jes honnêtes gens. ( / . J. RoufJ'eau.') .
AÇT1QN, Çc mot, d^ns fe$ rapports avec
à C T
l’objet de ce didionnaire , fe prend en deux acceptions
différentes : YaElion. confidérée relativement
au drame, & Y action confidéfée relativement au
jeu des adeurs.
La première , qu’on pourroit appeller aElion dra*
mdùifue , doit avoir en général, pourTopéra , les
mêmes principes que pour la tragédie 8c la comédie
; mais avec dés modifications appropriées
aux procédés & aux effets de la mufique.
Cet art n’a aucun moyen pour rendre avec
intérêt, & en même teins avec vérité, tous les
détails de développement, de récit, de dialogue
raifonné, qui dans les drames purement déclamés
fervent à expofer des événements antérieurs ; à préparer
ou à expliquer les incidents ; à faire connoître
le caradère oc les vues des perfonnages ; à attacher
l’efprit par des traits ingénieux ou par de beaux
vers dans les moments ou l’ame ne peut pas l’être
par les mouvements des paflions ; la mufique d’ailleurs
ayant une marche plus' lente que la fimple
déclamation, on fent que , dans le poëme lyrique ,
YaElion doit être plus fnnple, plus claire , plus
vive , avec plus de fpedacle & moins de dialogue
tranquille, que la tragédie 8c la comédie. 11 y a
donc des fujets de drame plus heureux pour un
genre que pour un autre , 8c des aElions qui font
d’un grand effet au théâtre françois , 8c qui n’en feraient
aucun fur le théâtre lyrique. C’eft ce qu’on
trouvera plus développé à l’article Poème lyrique.
Nous ne nous étendrons que fur la fécondé acception
du mot aElion , c’eft-à-dire , fur le jeu des
adeurs ; 8c ici il faut faire une diftindion effentielle
entre ie comédien 8c Fadeur du théâtre lyrique.
Pour le.premier , Y action comprend à la fois, la dé-
- çlamatipn , le gefte 8c l’expreffion du vifage. Pour
le fécond, Y action ne comprend que les mouvements
du vifage 8c du corps ; le chant eft un talent
à part. Le comédien qui, avec lesplus beaux geftes
8c la phyfionomie la plus expreflive, n’aurait aucune.
vérité dans fes accents 8cfçs tons , ne pourrait
être qu’un mauvais adeur ; mais, à l’opéra,
on peut être un mauvais chanteur,, 8c un excellent
adeur : tel étoit Chaffé que Rouffeau, dans l’article
précédent, loue comme le modèle des acteurs
de ce théâtre , 8c qui avec une voix caffée èC
un goût de chant déteftable, avoit en effet beaucoup
de nobleffe , de chaleur 8c d’intelligence dans
fes geftes 8c fes mouvements.
La diftindion que nous venons d’indiquer entre
le talent du comédien 8c celui de Fadeur lyrique
n’eft pas la feule qu’il foit néceffaire d’établir. Le
comédien eft le maître de toute fon aElion. Il peut,
à fon gré précipiter ou ralentir fa déclamation ;
13. couper par des tems ou des filences plus ou
moins prolongés ; préparer fes tons , ou en remplir
les intervalles par des geftes ou par le jeu
du vifage : il n’a , en cela , d’autre guide 8c d’autre
I mefure que la vérité, telle qu’il la fent ou qu’il
| la tonçoit. Son objet étant d exprimer dés fenti-
A C T
fctëiiïs «StHfels flans le langage naturel des hommes
6ue nous voyons ou que nous imaginons., il faut
qu’il imite, le plus fidèlement qu’il peut, leurs
accents , leur air, f leurs mouvements , dans les
Étuations femblables a celles qu’il veut peindre.
L’adeur lyrique eft placé dans un ordre de
\ chofes bien différent | il ne jouit point de la même
• liberté , 8c n’eft pas non plus gêné par les mêmes
entraves. Il ne parle pas , il chante : le chant eft un
î langage hors de la nature ordinaire ; mais c’eft
un langage embelli qui a un charme pris dans la
mature même de l’homine. Ces deux circonftanees
exigent donc des modifications particulières dans les
mouvements extérieurs qui doivent accompagner
au théâtre la parole chantée, pour y ajouter plus
lie vérité 8c d’énergie.
Pour reconnoître quelles font ces modifications
$c en fixer les vrais principes , il faut analyfer avec
quelque précifion les différentes parties de YaEîi&n
, .théâtrale , propre à la fcène lyrique.
Aucun peuple, aucun homme n’a exprimé naturellement
fes penfées en chantant ; mais il n’eft pas
impoffible de fuppofer un peuple à qui, dans le
premier état de nature, on ait donné un langage
dont toutes les intonations feraient fixées par les
proportions muficales , 8c dont tous les fons auraient
une valeur de tems déterminée, 8c feraient
fournis à une mefure régulière.
Le chant, confidêrê comme langage , a donc
tme vérité hypothétique 8c poffible ,Teule vérité
: effentielle à Reflet des beaux-arts ; 8c l’on ne peut
: pas dire qu’il foit contre la nature car c’eft le premier
des arts chez les nations les plus fauvages, lef-
quelles fâvent chanter 8c danfer avant deMavoir
faire du pain 8c conftruire une cabane.-^
'. Indépendamment des fons articulés , l’homme
a d’autres lignes pour faire connoître fes fenti-
ments. Les émotions de fon ame fe manifeftent par
fes regards 8c par des mouvements particuliers de
Ton vifage 8c de fon corps. Ces fignes , féparés de
;ia parole , conftituent la pantomime ; c’eft un langage
naturel 8c indépendant de toute convention ;
|«lair pour tous les hommes ,, parce qu’il eft commun
à tous , 8c dont les expreflions s’unifiant à
celles de la-parole articulée , rendent les effets de
jfcellerti plus fenfièles 8c plus puiflants.
L’aâeur n’étant pas réellement pénétré dès !
fèntiments -qù’il veut exprimer , ne peut imiter j
qu’à Joree d’art ces mouvements: extérieurs qu’excitent
les paflions 8c les. affedions divèrfes dans
ceux qui les éprouvent réellement. Il faut qu’il ait
obfervé avec intelligence ces effets des affedions
humaines ; qu’il foit doué de cette mobilité d’ame
qui la rend fufceptible de toutes les impreflions- de
la douleur 8c de la joie , de Fefpérance 8c de la
xrainte, de 1 amour 8c de la haine ; qu’il ait enfin
?cette foupleffe y cette ' docilité, d’organes-qui. leur
tefle recevoir promptement les formes & les modifications
extérieures que les paflions vraies prç-
A c T 47
duifent dans les organes de ceux qui en font vérir
tablement pénétrés.
Mais les mêmes paflions, exaltées au même degré
, ne fe manifeftent pas dans tous les individus
par des fignes également frappants r les uns ©ne
plus d’expreflion queies autres dans la phyfionomie
, plus de mobilité dans les traits , plus de vio-
| lence, de promptitude dans les mouvements. L’ac-
teyi* peut donc , fans blefler la vérité , mettre plus
oumoins de force 8c d’énergie dans fon aâtion ; 8c
c’eft dans le choix des nuances qu’il fera connoître:
fon intelligence 8c fon goût.
Le principe général que l’aâeur ne doit jamais
perdre de vue, c’eft que l’opéra eft la réunions
de plufieurs arts dont les moyens divers doivent
concourir à un même but, 8c que dans cêf concours
d’arts différents , la mufique eft la partie dominante
à laquelle les autres doivent être fubordonnées
dans leur aâion 8c leurs effets.
Examinons en peu de mots les conféqnences
qui réfultent de ce principe , 8c qui peuvent £ervir
à diriger l’aéleur dans^Tes mouvements.
Au théâtre lyrique Yaffio-n n’eft que Faccora-
pagnement du chant. Voyez cet habile chanteur
qui s’accompagne lui-même au clavecin : il choific
dans l’harmonie les notes qui font le mieux valoir
la mélodie ; il fait reffertir celles qui concourent
à embellir ou fortifier Fexpreffion ; il adou-.
cit ou éteint les fons de l’inftrument lorfque la voix
veut briller par elle-même ; 8c il ne donne plus
de force 8c d’intérêt à. fon jeu , que dans les moments
où le chant fe tait ou ne fait que répéter
des paffages que l’oreille démêle aifément. Voilà
le modèle de Faâeur lyrique j mais pour appliquer
à Yaiïion théâtrale cet art de Faccompagna-
teur, il faut beaucoup d’intelligence , d’étude-, de
goût, avec des dons naturels également précieux 8c
rares.
11 doit avoir, avant tout, une phyfionomie mobile
8c des yeux où fè réfléchifîent diftinâemenc
toutes les affeâions- de Famé. C’eft la première
8c la~ plus- effentielle partie de la pantomime. C’eflr.
ce qu’a bien obfervé ce grand maître de l’éloquence
romaine , qui nous a laiffe de fi. beaux
préceptes fur Fart d’intéreffer 8c de plaire par l’tmiorK
de la penfëe, des fons 8c du geftë. « Après la voix,.
dit Cicéron , c?eft le vifage qui agit avec le plus
» d’empire , 8c ce font les yeux qui animent Fex—
» preffion du vifage v. ( ClC. de oratore, L 3, §. 2 2 3 .)>
Cette mobilité' dans les regards 8c. dans les traits ,/
ne peut être bien dirigée que par la faculté de fe pénétrer
intérieurement des affeâions qu’on veut exprimer
: les mouvements du: vifage répondront alors
d-’eux-mêmes à- cette transformation momentanée
de Famé de Fadeur. Mais cette faculté donrje parle
eft le talent le moins connu de nos comédiens ; plufieurs
mêmes le regardent comme une chimère-
Us fiævent que pour exprimer la douleur, la colère
, le dédain , il faut faire- tels mouvements des
fourcils ^dala-boudiejdes yeux^8cUs fe-les.