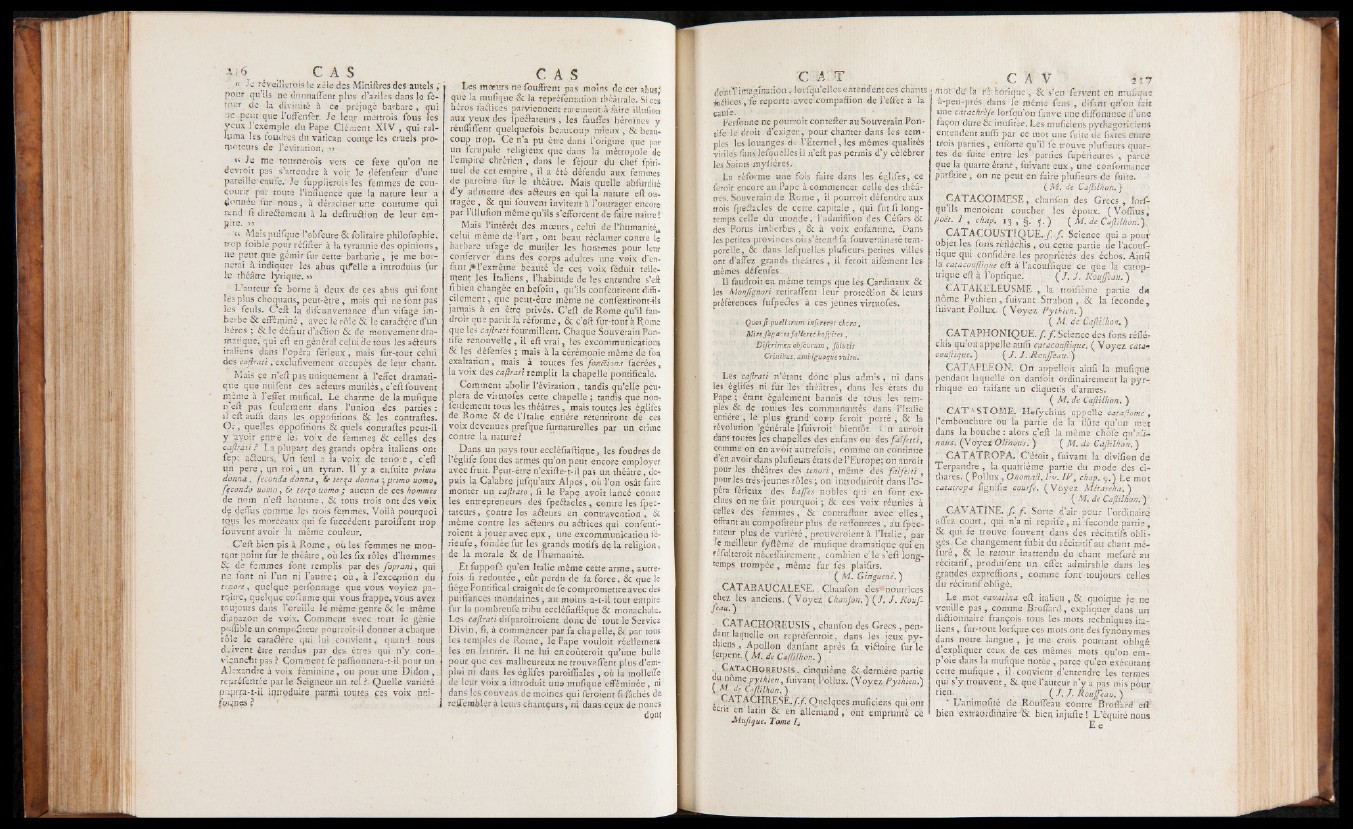
C A S
« Je réveillerais le zèle des Minières des autels
pour qu’ils ne donnaient plus d’aziles dans le fé-
jpnr de la divinité à ce préjugé barbare, qui
ne peut que l’ofFenfèj*. Je iei\r mettrois fous -les
yeux l ’exemple du Pape Clément X IV , qui- ralluma
les foudres du Vatican contçe les cruels pro-
ipoteurs de l’éviration.
“ Je me tournerais vers ce fexe qu’on ne
devrait pas s’attendre à voir le défepfeur d’une
pareille' caufe.- Je fûpplierais les femmes de . concourir
par toute l’influence que la nature leur a
donnée fur nous, à déraciner une coutume qui
rend fi direâement à la defiruéfion de leur ein-
pire. >j
et Mais puifque I’obfc-ure 8c folitaire philofophie,
trop foible pour réfifter à la tyrannie des opinions,
ne peut que gémir fur cette barbarie, je me bor-
nerai à indiquer les abus qifèlle a introduits fur
le théâtre lyrique. »
L’auteur fe borne à deux de ces abus qui font
Us plus choquans, peut-être , mais qui ne font pas
les feuls. C’eft la difeon venânee d’un vifage imberbe
& efféminé , avec le rôle & le caraâère d’un
héros ; & le défaut d’action 8c de mouvement dramatique,
qui eff en général celui de tous les aâeurs
italiens dans Topèrà férieux, mais fur-*out celui
des cajlrati , exclufivement occupés de leur chant.
Mais ce n’eft pas uniquement à l’effet dramatique
que nuifent ces aâeurs mutilés, c’efl; fouvent
meme à l’effet mufical. Le charme de la mufiqye
n’eff pas feulement dans l’union des parties :
il eff aufli dans les oppoffrions les cpntraftes.
Or , quelles oppofitions & quels contraftes peut-il
y "ayojr entre les voix de femmes & celles des .
caficaj i ? La plupart des grands opéra italiens ont
fepr aâeurs,. Un feul a la -voix de tenp-e, c'eff
im perê, qn r o i , un tyran. Il y a enfuite prima
donna, féconda donna, & ter^a donna ; primo uomo,
fecondo uomo, & terço uomo ; aucun de ces hommes
de nom n’eft homme, & tous trois ont des voix
de dçfîlis eomme lgs trois femmes, Voilà pourquoi
tous les morceaux qui fe fuccèdent paroiffent trop i
fouvent avoir la même couleur.
C ’eff bien pis à Rome, où les femmes ne montent
point fur le théâtre, où les fix rôles d’hommes
&. de femmes font remplis par des foprani, qui
ne font ni l’un ni l’autre; où, à l’exception du
ttç.ore, quelque perfqnnage que vous voyiez paraître,
quelque cofiume qui vous frappe, vous avez
toujours dans l’oreille le même genre & le même
diapazon de voix. Comment avec tout le génie
paffjble un compoffteur pourroit-il donner à chaque
rôle le caraâère qui lui convient, quand tous
doivent être rendus par des. êtres qui n’y con- .
vignnefit pas ? Comment fe pafîionnera-t-il pour un
Alexandre à voix féminine, ou pour une Didon ,
repréfentée par le Seigneur un tel ?.. Quelle variété
prqirra-t-il iqtrpduire parmi toutes ççs voix pni-
|pùpes f ' . ' j
C A S
Les moeurs ne fouffrent pas moins de cet abusj
que la mufique & la repréfentation théâtrale. Si ces
héros faâices parviennent rarement.à faire illufion
aux yeux des' fpeâateurs , les fauffes héroïnes y
réufîifîent quelquefois beaucoup mieux, & beaucoup
trop. Ce n’a pu être dans l’origine que par
un fcrupule religieux que dans la métropole de
l’empire chrétien , dans le féjour du chef Spirituel
de cet empire, il a été défendu aux femmes
de paraître fur le théâtre. Mais quelle abfurdité
d’y admettre des aâeurs en qui la nature eff outragée
, & qui fouvent invitent à l’outrager encore
par 1 illufion meme qu’ils s’efforcent de faire naître !'
Mais l’intérêt des moeurs, celui de l’humanité^
celui même de T açt, ont beau réclamer contre le
barbare ufâge dg mutiler les hommes pour leur
conferver dans des corps aduites une voix d’enfant
,• l’extrême beauté de ce§ voix féduit telle-
nienç Jes Italiens, l’habitude de les entendre s’eff
fi bien changée en bqfpin, qu’ils cqnfënriront difficilement
, que peut-être même.ne confentiront-ils
jamais à en êtrq privés. C ’eff de Rome qu’il dfa.ii-
droît que parfit la réforme, & c’eff fur-tout à Rome
que les cafl-rati fourmillent. Chaque Souverain Pontife
renouvelle , il eff vrai, les excommunications
8c lgs défenfes ; mais à la cérémonie même de ion
exaltation, mais à toutes fes fondions facrées,
la voix des caflrati remplit la chapelle pontificale.
Continent abolir l'éviration, tandis qu'elle peu»
plera de virtuofes cette chapelle ; tandis que non-,
feulement tous les théâtres, mais toutes les. çglifes
de Rome & de l’Italie entière retentiront de ces,
voix devenues prefque furnaturelles par uq crime
contre la nature?
Dans un pays tout eccléfiaffique, les foudres de.
l’églife font des armes qu’on peut encore employer
avec fruit. Peut-être n’exiffe-t-il pas un théâtre , de-,
puis la Calabre jufqu’aux Alpes, où Ton osât faire
monter un cajlratoy fi le Pape avoit lancé contre
les entrepreneurs des fpeâaçles , contre les fpec-
tateurs, contre les aâeurs en contravention , &
même contre les aâeurs pu aârices qui confenti-
roient à jouer avec epx , une excommunication fé-
rieufe, fondée fur les grands motifs de la religion,
fie la morale & de l’humanité.
Et fuppofé qu’en Italie même cette arme, autrefois
fi redoutée, eût perdu de fa force, & que le
fiege Pontifical craignît de fe compromettre avec des
puiflances mondaines , au moins a-t-ii tout empire
fur la nombreufe tribu eccléfiaffique & monachale.
Les cajlrati difparoîtroient donc dé tout le Service
Divin, fi, à commencer par fa chapélle, & par tous
les temples de Rome,, le Pape vouloit réellement
les en bannir. 11 ne lui encornerait qii’ùne bulle
pour que ces malheureux ne trouvaffent plus d’emploi
ni dans les églifes paroiffiales , où la molléffe
de leur voix a introduit une mufique efféminée , ni
dans-les couveras de moines qui feraient fi fâchés de
reffetublêr à leurs chanteurs, ni dans cçyx de nones
' dpnt
€ :A T
dorit’V imagination, lûi'fcju’elles entendent ces chants
délices,fe reporte avec compafîion de l’effet à la
■ caufe. • • J'- - ' • ■ ' ■ •
Perfonne ne pourroit conteffer au Souverain Pontife
le droit d’exiger, pour chanter dans les temples
les louanges de l’Eternel, les mêmes qualités
viriles fans,lefquelles il n’eft pas permis d’y célébrer
les Saints myffènes<
La réforme une fois faite dans les églifes, ce
feroit encore au Pape à commencer celle des théâtres.
Souverain de Rome , il pourrait défendre aux ]
trois fpeâaçles de cette, capitale , qui fut fi longtemps
celle du monde, l’admiffion des Céfars &
des Porus imberbes $ & à voix enfantine. Dans
les petites provinces où s’étend fa: fouveraineté temporelle,
& dans lefquelles plufieurs petites villes
ont d’affez grands théâtres , il feroit aifément les
mêmes défenfes.
Il faudrait en même temps que les Cardinaux &
les Monfignori retiraffent leur proteâion & leurs
préférences fufpeâes à ces jeunes virtuofes.
•' Quosji puellarum infererer chcrot
Mire fagacesfalitrethofpites , -
■ Difcrimen obfcurum, folutis
Crinibus., ambigùoque viiltu. '
Les cajlrati n’étant donc plus admis , ni dans
les églifes ni fur les ' théâtres, dans lés états du
Pape; étant également bannis de tous les temples
& de toutes les communautés dans l’Italie
entière , lé plus grand coup ferait porté, .& la
révolution ’générale ffuivroit' bientôf. C n auroit
dans toutes les chapelles des enfans ou des faifetti,
comme oh en avoir autrefois, comme on continue
d’en avoir dans plufieurs états de l’Europe; on auroit
pour lés théâtres des tenori , même dés fàlfclti ,
pour les très-jeunes rôles ; on introduirait dans l’opéra
férieux des baffes nobles qui eh font exclues
on ne fait pourquoi ; & ces voix réunies à
pelles des femmes, & contraffant avec elles,
offrant au compOfiteur plus de reflburces , au fpéc-
tateur plus de variété, prouveraient à l’Italie, par
le meilleur fyftême de mufique dramatique qui en
fefulteroit néceffairement, combien e’ie s’eff longtemps
trompée, même fur fes plaifirs.
( M. Giriguené. )
CATABAÜCALESE. . Chanfon des'v nourrices
ehez les anciens. ( Voyez Chanjon. ) (71 7. Rouf-
feau.) '
• CATACHOREUSIS , chanfon d es Grecs, pen-
fiant laquelle on repréfentoit, dans les jeux py-
tliiens,, Apollon danfant après fa viâoire furie
jerpént. ( M., de ÇaflXlfion.)
, Cataçhoreusis , cinquième & dernière partie
du nome.py/Aiew fuivant Pollux. (Voyez Py,thien?\
( M J fÇ t f i l h o n . ) , ' \ ^ ;
ÇATACKRESE.yi/1 Quelques muficiens qui ont
cm eti latin & en àllehiànd, dût emprunté ce
Mufique. Tome IA
. C l V i \ j
tnot'dé" la ré:hôrique , & s’en fervent en mufique
à-peu-près dans- le même fens , difant qn’on fait
une catachreje lorfqu’oh fauve une diffonance d’une
façon dure 6c inufitée. Les muficiens pythagoriciens
entendent auffi par ce mot une fuite de fixtes entre
tfois parties, enforte qu’il fe trouve plufieurs quartes
dé fuite entre les parties fupérieures , parcé
que la quarte étant, fuivant eux , une confonnance
parfaite , on ne peut en faire plufieurs de fuite.
( M. de C ajlilho n. )
C A TA CO IM E SE , chanfon des Grecs , lorf-
qu ils menoient coucher les époux. (Vof fms,
poet. 1 , chap. i | , g. 5. ) ( M. de CajlilAon. )
CA TA CO U S T IQ U E . ƒ. ƒ. Science qui a-pour
objet les fous réfléchis , ou cette partie de l’acoiif-
tique qui confidère les propriétés des échos. Ainfî
la catacoujlicjue eff à l’acouffique ce que la catop-
triquè eff à l’optique. ( 7. 7. Roujfeau. )
GATAKELEUSME , la troifième partie du
nome Pythien , fuivant Srrabon , ,6c la féconde,
fuivant Pollux. (V o y e z Pythien.)
( M. de Cajlilhon. )
CATAPHONIQUE. f . f . Science des fons réfléchis
qu’on appelle auflî c-atacoujlique. ( Voyez catam
çmfùque. ). •. ; {J . J. Rouffeau.)
- C A T APL E O N. On appelloit ainfi la mufique
pendant laquelle on danfoit ordinairement la pyr-
rhique en faifant un cliqüètis d’armes.
( M. de Cajlilhon. )
C A T a STOME. Hefychius appelle cataflotne,
• PembouehûYevoü''k partie dé la flûte qu’on’ met
dans la bouche : alors c’eff la même chofe qu’o/i-
hous. (Vdyez Olïno'Us. ) ( M. de Cajlilhon. )
C A TA TR O PA . C ’étoit, fuivant la divifion de
Terpandre , la quatrième partie du mode des cithares.
( Pollux , Onomafl. liv. IF\ chap. 9.) Le mot
catatropa fignifie courfi. (V o y e z Métareha.)
( M. de Cajlilhon. )
ÇAVATÎNÈ. f . f . Sorte d’air pour l'ordinaire;
affez court , qui n’a ni reprife , ni fécondé partie.,
8ç. qui fe trouve; fouvent dans des récitatifs obligés.
Ce changement fubit du récitatif au chant mé^
luré, & le retour inattendu du chant mefuré au
récitatif, produifent un effet admirable dans les
grandes expreffions, comme font toujours celles
du récitatif obligé.
Le mot cavaùna eff- italien , & quoique je ne
veuille pas, comme Broflard, expliquer dans un
diâionnaire françois tous les mots techniques italiens
,. fur-tout, lorfque ces mots ont/des fynonymes
dans notre langue , je me crois pourtant obligé
d’expliquer ceux de ces mêmes mots qu’on em-
p’oie dans la mufique notée, parce qu’en exécutant
cette mufique ,. il convient.d’entendre les termes
qui s’y trouvent, 8c. que l’auteur n’y a pas mis pour
rien. ( J-J. Rouffeau. )
* L’animofité de Rouffeau contre Éroflarcf eff’
bien extraordinaire bien injufte ! L ’équité nous
E e