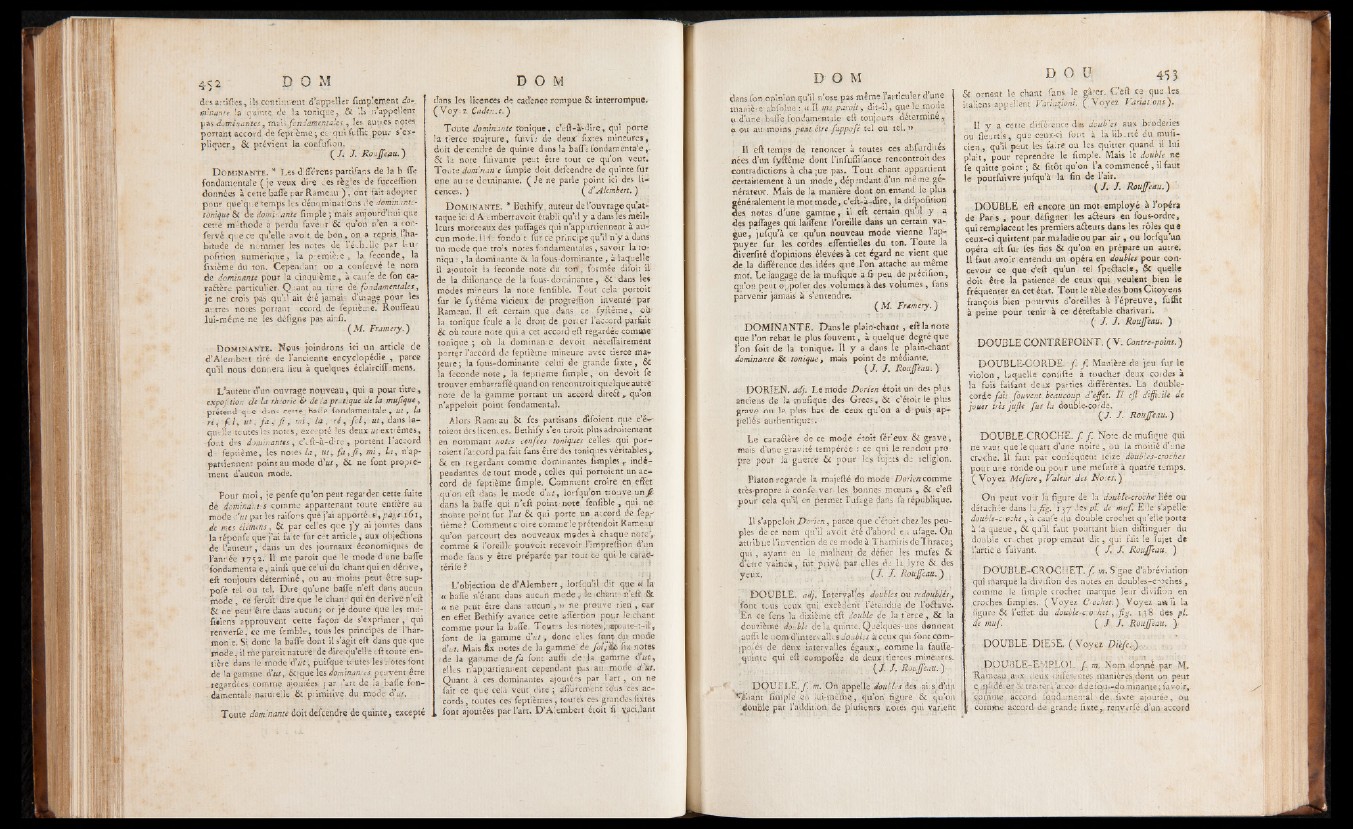
des a: tïftes, ils continuent d’appeler fimplertient dominante
!a quinte. de la tonique, & 'JL n’appellent
pas dominantes x tt\i\ï fondamentales , les autres pçtes
portant accord de feptième \ esquiftifit pou* s’expliquer,
& prévient la confufi on. . •
( 7. J. Rouffeau.)
D ominante. * Les dlfféreus partifar.s de la b ffe
fondamentale ( je veux dire ces règles de fttçceftion
données à cette baffe par Rameau ) , ont fait adopter
pour que’qne temps les dénominations de dominante-
tonique & de dominante fimpie ; mais aujourd’hui que
cette méthode à perdu favéür 6c qutori n’en a cor.-
fervé q> e ce qu’elle a voit de. bon, ona repris^ lha-
bitude de nommer les notes de. LécîiHlê par leur
pofition numérique, la première , la féconde., la
fixième du ton. Cependant on a c on fervé le nom
de dominante pour }a cinquième , à caufe.de fon ca-
raâère particulier. Quant au titre de fondamentales,
je ne crois pas qu’il ait été jamais d’usage, pour les
autres notes portant ccord de feptième. Rouffeau
lui-même ne les défigne pas ainfi. - (M. Framery.)
Dominante. Nous joindrons ici un article de
d’Àlembert tiré de l’ancienne encyclopédie ,. parce
qu’il nous donnera lieu, à quelques éclaircifT mens.
L ’autèür d’un ouvrage nouveau, qui a pour titre,
expojïùon de la théorie £» de la pratique de la mufique,
prétend que dans cette_ balle fondamentale, ut, la
ri:i f i l , ut. fa $f i i m i , la, r é , f c l , u t , .dans la-
- quelle Toutes les note s, excepté les deux ut extrêmes,
font des dominantes -,c’eft-à-^dlre, portent l ’accord
d feptième, les notes la, iu^fa,ji’, mi, la, n’a.p-
paf tiennent point au mode à 'u t , fit ne font proprement
d’aucun mode.
Pouf rrioi, je penfe qu’on peut regarder cette fuite
dé djeminantts cpmmo appartenant toute entière au
mode il’ut par les rai for s que j’ai apportées-, pàgei6 i,
de mes élément, fit par celles que j’y ai jointes dans
la réponfe que j’ai fa te fur cet article, aux objections
de fauteur, dans un des journaux économiques de
l’année 1752. H me paroît que le mode d une baffe
fdndamenta e, ainfi que cehii du chant qui en dérive,
eft toujours déterminé, ou au moins peut-être sup-
pofé tel ou tel. Dire qu’.une baffe .n’eft dans aucun
mode , Ce feroxt dire que le chant qui en dérive n’eft
& ne peut être dans aucun:- or je doute que les mii-
fitiens approuvent cette façon de s’exprimer , qui
rehverfe, ce me femble, tous les principes de l’harmonie.
Si donc la baffe dont il s’agit eft dans que que
mode, il me paroît natufe' de dire-qu?elle eft toute entière
dans le mode dé ut, puifque toutes les botes font
de la gamme à’ut, fit‘que les dominanj.es peuvent être
regardées comme ajoutées, j.ar fart de la;.baffe fondamentale
naturelle fit primitive, du mode; à’ut.
Toute dominante doit descendre de quinte, excepté
dans les licences de cadence rompue & interrompue.
( Voy. z Cadet:, e. )
Tonte dominante tonique, c’eft-à'-dire, qui porte
la tierce majeure, fuiviè de deux' fixtes mineures,
doit de1 cendre de quinte dans la baffe fondamentale
fit la note fui van te peut être tout ce qu’on veut.
Toutz dominnn e fimpie doit defeendre de quinte fur
une au-re dominante. ( Je ne parle point ici des licences.
) ( d ’Alembert. )
D ominante. * Bethify. auteur de l’ouvrage qu’attaque
ici d A embertavoit établi qu’il y a dansles meife
leurs morceaux des partages qui n’app iniennenr à aucun
mode. 11 f; fondot fur ce principe qu’il n’y a dans-
un mode que tro:s notes fondamentales, savoir la to-
niquï, la dominante fit la fous-dominante , adaquelfe
il ajoutoit la fécondé note du ton’ , formée difoit il
de la diflonance de la fous-dominante , & dans les
modes mineurs la noce fenfible. Tout cela - portoil
fur le fyftême vicieux de- progreftion inventé par
Rameau. Il eft certain que dans ce fyftême, où-1
la tonique feule a le droit de porter l’accord parfait
& où toute note qui a cet accord eft regardée comiçte
tonique ; où la dominan e devoit néreffairemént
portçr l’accord de feptième mineure avec tierce ma?
jeure; la fous-dominante celui de grande fixte, fit
la fécondé note , la (eptième fimpie, on devoit fe
trouver embarraffé quand on rencontroit quelque autre
note de la gamme portant un accord direét > qu’on
n'appeloit point fondamental.
Alors Rameau fit fes- partisans difoient que c’e-*
toient des licences. Bethify s’en tiroit plus adroitement
en nommant notes cenfées toniques celles qui por-
toier.t l’accord pa: fait fans être*des toniques véritables ,
I fit en regardant comme dominantes fimples r indépendantes
de tout mode, celles qui portoient un accord
de feptième fimpie. Comment croire en effet
qu’on eft dans le mode d’ut:t lorfqu’on trouve, un/
dans la baffe qui n’eft point note fenfible , qui. ne
monte po:nt fur Y ut fit qui porte un accord de Septième
? Comment e-oire commele pfetendoit Rameau'
qu’on parcourt des nouveaux modes à chaque note r
comme fi l’oreille pouvoit recevoir l’impreftion d’un
mode fans y être préparée par tout èe qui le catac?-
térife ?
L’objection de d’Alembert, lorfqu’il dit que «I la
« baffe n’étant dans aucun mode , léchant ■ n’eft. fit
« ne peut être dans aucun s » ne prouve rien , .car
en effet Bethify avance cette affertiôn pour leichant
comme pour la baffe. Toutes fesnbte9Waj»ute-:t-ill,
font de la gamme à’ut, donc elles font 'dp; mode
d'ut. Mais êx notes de la gamme'de folfdb fi* notes
.-de la gamme de fa font auffi de :1a gamme d’ut,
elles n’appartiennent cependant pas ; au mode
Quant à ces dominantes ajoutées par l’art, on ne
fait ce que cela veut dire ; affuremeht to’us Cês accords,
toutes ces feptièmes, toutes ces grandes fixtes
font ajoutées par l’art. D’Alembeit etoit fi vaci.lant
dans fon opinion qu’il n’ose pas même l’articuler d une
manié; e- rtfefoffie : « Il me.par oit, ditril, que le mode
<1 d’uneibaffejfondamt’ntale eft toujours détermine,.
a otï au -moins peut être fuppofe tel ou tel. » . ,. ;
11 eft temps de renoncer à toutes ces abfurdités
nées d’un f3fffême dont l’infuffilance rencontro:t des
contradictions à cha jue pas. Tout chant appartient
certainement à un mode, dépendant d’un même générateur.
Mais de la manière dont on entend le plus
généralement le motmede, c’eft-à-dire, la difp.ofition
ffes notes d’une gamme, il eft certain qu’il y 3
des partages qui laiiTent l’oreille dans un certain vague,
julqu’à ce qu’un nouveau tnode vienne 1 appuyer
fur les cordes effentielles du ton. Toute la
diverfité d’opinions élevées à cet égard ne vient que
de là différence des idées que.l’on attache au même
mot. Le langage de la mufique a fi peu .de précifion,
qu’on peut o(.po(er des volumes à,des volumes , fans
parvenir jamais à s’entendre.
(AL Framery.')
DOMINANTE. Dans le plain-chant , eft la note
que l’on rebat le plus fouvent, à quelque degré que
Ton foit de la tonique# I l y a dans le plain-chant j
dominante & tonique, mais point de médiante.
{ J . J . R o u ffe a u .)
DORIEN. ad). Le mode Dorien étoit un des plus
anciens de la mufique des Grecs , & c’étoit le plus
grave ou le plus bas de ceux qu’on a d-puis appelles
authentiques.
Le caraélère de ce mode étoit fér’eux fit grave,
mais d’une gravité tempérée : ce qui le rendoit propre
pour la guerre fit pour les fujets de ieligîon.
Platon regarde la majeflé du mode Dorien comme
très-propre à confei ver- les bonnes moeurs , & c’eft
pour cela qu’il en permet Tufagè dans fa république.
Il s’appeloit Dorien, parce que c étoit chez les peuples
de ce nom qu’il avoit été d’abord eu ufage. On
attribue l’invention de ce mode à Thamiris de T hracej
qui , ayant' eu le . malheur de défier les mufes fit
d’etre yaihcu, fut privé, par elles .de la,lyre fit des
yeux. (ƒ. J. Rouffeau. ) .
DOUBLE, ad). Intërÿalfes doubles ou redoublés,
font tous ceux qui, excèdent .l’éteaïdu.e de l’oélave.
'Èn ce fens la dixième, eft double de la t erçe , fit la
douzième double de la quinte. Quelques'-uns donnent
,auffi le nom d’intervalUs doubles à ceux qui font commodes
de deux intervalles égaux;, comme la fauffe-
quiqte qui eft. comportée de deux j tierces minènres.
.: (ƒ. J. gouffeau.)
' DOUELE. f. m. On appelle doubles des abs'd’iin
^ihant fimpie en lui-même, qui’on figure fit qu’ôn
double par l’addition'de plufieurs r.otës qui varieht
& ornent le chant fans le gâter. C’eft. ce que les
italiens appellent Vann^joni. ([Voyez Varifit:ons).
U y a cette différence dis doub'es aux broderies
ou fleurtiS, que ceux-ci font à la Ub.rté du mufi-
cien, qu’il peut.les faire ou les quitter quand il lui
plaît, pour reprendre le fimpie. Mais le double ne
fe quitte point ; fit fitôt qu’on l’a commencé , il faut
le pouffuivre iufqu’à la fin de lair.
(ƒ . 7. Rouffeau.)
DOUBLÉ eft encore un mot employé à l’opéra
de Paris , pour défigner les a&eurs en fous-ordre,
qui remplacent les premiers aéleurs dans les rôles qu e
ceux-ci quittent par maladie ou par air , ou lorfqu’un
opéra eft fur fes fins & qu’on en prépare un autre.
Il faut avoir entendu un opéra en doubles pour concevoir
ce que ç'eft qu’un tel fpeétacle, 6c quelle
doit être la patience de ceux qui veulent bien le
fréquenter en cet état. Tout le zèle des bons Citoyens
françois tien pourvus d’oreilles à l’épreuve, fùffit
à peine pour tenir a ce déteftable charivari.
( J. 7. Rouffeau. )
DOUBLE CONTREPOINT; ( V. Contre-point. )
DOUBLE-CORDE, ƒ f Manière de jeu fur le
: violon , laquelle conlifte à toucher deux cordes à
la fois faifant deux parties différentes. La double-
corde fait fouvent beaucoup d’effet. I l ejl difficile de
jouer très jufbe fur la double-corde.
(J. J. Rouffeau.)
DOUBLE-CROCHE, ƒ f. Nore de mufique qui
ne vaut que le quart d’une- noire , ou la moitié d’une
cro.ehe. 11 faut par conféquent iéize’ doubles-croches
\ pour une ronde ou pour une mefure à quatre temps.
: (Voyez Mefure, Valeur des Notes.)
On peut voir là figure de la double-croche' liée ou
i détachée- dans la i 3 7 des pli de muf Eile s’apellei
double-croche , à caufe du double crochet qu’elle porte
à fa queue , Ô£ qu’il faut pourtant bien diftinguer du
: double crochet proprement dit, qui fait le fujet de
! ftartic e fuivant. ( 7. 7. Rouffeau. ).
DOUBLE-CROCHET, f. m. S gne d’abréviation
’ qui marqué la divjfion des notes en doubîes-c'oches ,
: comme le fimpie crochet marque leur divifion en
: proches fimples. (Voyez Cochet.) Voyez a»fi la
. figure fit l’effet du double-cro -ket 1,3 8 des pl.
; de muf. ( 7 7. Rouffeau. )
'■ . DOUBLE-DIESE. ( Voyez Dufè.f)f .
: •.D.OTOLE-EMP.LOl. ƒ. m; Nom donné par M.
; ! Rameau a'jx rdeux;difféièntes ,manières,dont on peut
i • ç mhdéïe.r S: trai ter.l ’acco : d de fo,U',-do minante ; fa voir,
j t [çomm,e accord ta^dunienraî • de>.,fixte ajoutée, ou
! [ comme accQrd- de; grande fixte,. renv^rfé d’un accord