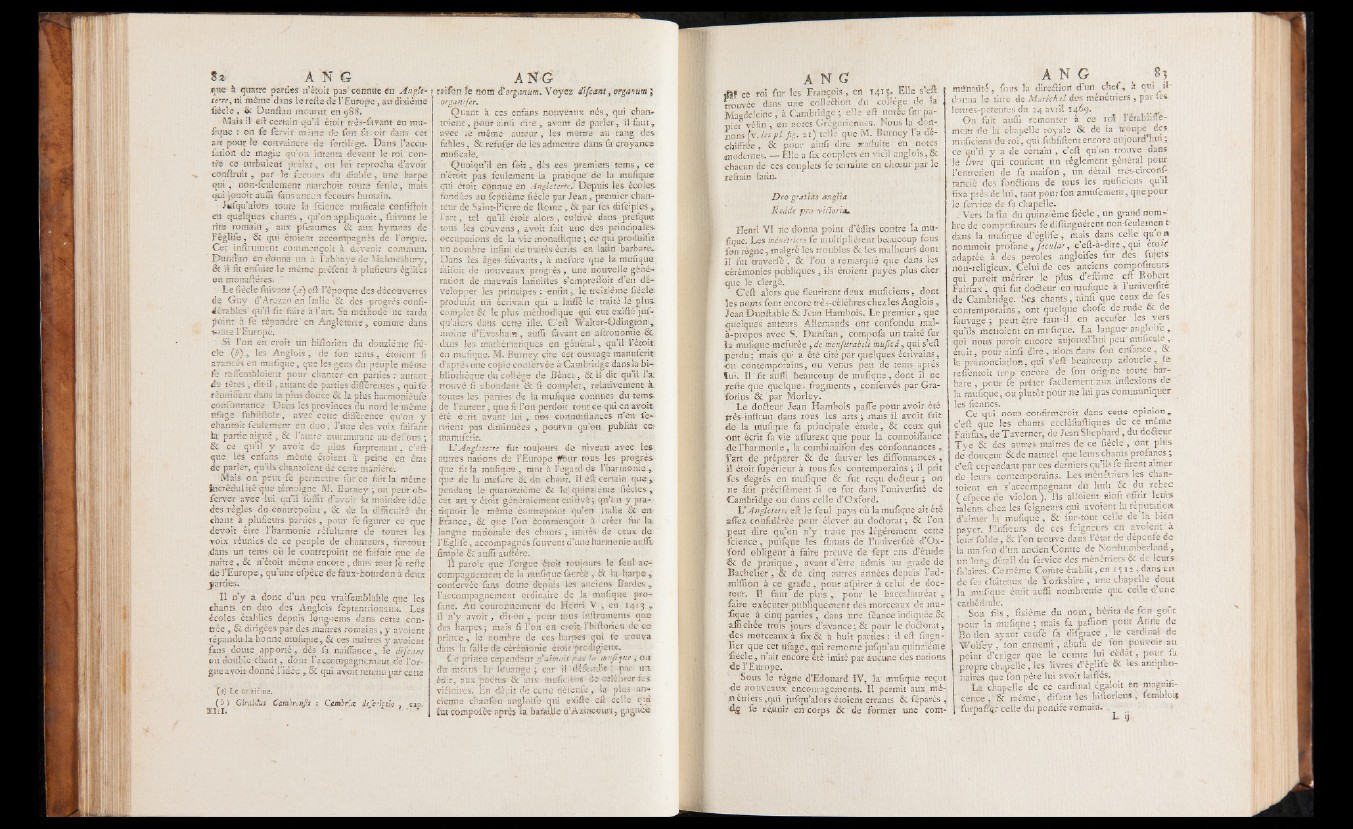
8a- A N G
que à quatre parties n’étoit pas-’1 connue en Angleterre,
ni même dans le refis ck l’Europe, au dixième
fiècle , & Dunftan mourut en 9884
Mais il e/i certain qu’il était très-la vaut en nra-
frque : an fe fer vit meme de fou fuvoir dans eet
art pour le convaincre de fertile ge. Dans Faccu»
fatiori de magie qu’on intenta devant lé roi contre
ce turbulent prélat, on lui reprocha d’avoir
eonftniit, par le feconrs du diable, une harpe
q u in on -feu lem en t marchait tonte feule, mais
qui jouoit au«Ti fans aucun fècours humain.
Jttfqu’alors tonte k feienee miificale confiftoit
en quelques chants , qu’on appliquoit fuivanf le
rite romain , aux pfeaumes & aux hymnes de
F ê g lif e , 8c qui étoient accompagnas de l ’orgue-.
C e t infiniment commençoit à devenir commun.
' Dunftân en donna un à l’abbaye de MrJmesbury,
& il fit enfui te le- même prefent à plufieurs églrles
©iî monaftères. ' x
Le fiècle fuiva-nî (a) eft l’époque des découvertes
de Guy d’Arezzo en Italie & des progrès confi-
dérables’ qu’il fit faire à l’art. Sa méthode ne tarda
point à le répandre en Angleterre, comme dans
■ fr uité l’Europè.
Si l’on en croit un hiftorien du douzième fiècle
(b) 9 les Anglois ,. de fon tems, étoient fi
avancés en mufique, que les gens dti peuple même
fe raffembloient pour chanter-en parties t autant
c e têtes , dit-il, autant de parties differentes , qui lé
réunifient dans la plus douce & la plus harmonièufe
confonnance Dans les provinces du nord le même
ufa-ge fûfififtoit-, avec cette différence qu’on y
chantait feulement en duo, l’une des voix faifant
ht partie aiguë , & l’autre murmurant au devons ;
8c ce qu’il y a voit de plus furprenant, c’eft
que les enfans même étoient à peine en état
de parler, qu’ils chantoiém de cette manière.
Mais on peut fe permettre fer ce fait la même
îhcréduL ite que témoigne M-, Burney ; on peutob-
ferver avec lui qu’il fu ilt d’avoir k moindre idée
des règles du contrepoint., & de la difficulté dii
chant à plufieurs parties , pour fe figurer ce que
devoir être l’harmonie résultante de toutes les.
voix réunies de ce peuple de chanteurs, fur-tout
dans un tems ou le contrepoint ne fàifoit que de
naître | & n’étoit même encore , dans tout le refie
de L'Europe, qu’une efpèce de faux-bourdenà deux
parties.
Il n’y a donc d’un peu vraifemblable que les
chants en duo des Anglois feptentrionaux. Les
écoles établies depuis longj-tems dans cette contrée
, & dirigées par des maîtres romains, y avoient
répandula bonne miffique, & ces maîtres y avoient ■!
fans doute apporté , dès fa naiffance , le difeant
jdu double chant, dont l'accompagnement de For-
gue avoit- donné i ’idée , & qui avoit retenu par cette
(s) Le oriieme.
(b) Giralfas Cam-mnfts ; Cambriez deferïmo . eau.
X lil. * ' ■
ANG
? r s ife r r l e n om fiorganum. V o y e z difeant, orgànùm J
Or gant fer.
Q u a n t à c e s en fan s n o u v e a u x n é s , qu i chan*-
t o i e i ï t , p o u r a iiïii dire , a v a n t d e p a r le r , il fau t r
a v e c ; e m êm e a u t e u r , le s mettre a u ran g d e s
f a b l e s , Ô L refu fer de le s admettre dan s -fa c r o y a n c e
m u fic a lè .
Q u o iq u ’ il e n f è i î , dè s c e s p rem iers t e m s c e
n 'écoit p a s fe u lem e n t la p r a t iq u é 'd e la mu fiqu e.
q u i é to it co n n u e en Angleterre* D e p u is l e s éco le s-
fon d é e s a u fe p t ièm e fiè c le pa r J e a n , p rem ie r ch an teu
r d e Sa in t-P ie r re d e R om e , 8c pa r fies d ifc ip le s
l ’a r t , te l qu ’i l é to it a l o r s , cu lt iv é dan s p r e fq u e
tou s le s c o u v e n s a v o i t fa it u n e des p r in c ip a le s
o c cu p a tion s d e la v ie m o n a ftiq u e ; c e qu i p ro d u ifit
un n om b re in fin i d e tra ité s éc rits e n latin b arbare*
D a n s le s â g e s fu iv a n t s , à m e fu r e q u e l a m u fiq u e
fa ifo it d e n o u v e a u x p ro g r è s , un e n o u v e lle g én é ra
tion de m au v a is la d a i lle s s’em p r e fio it d ’en d é v
e lo p p e r le s p r in c ip e s : enfin le. tre iz ièm e fiè c le .
p ro d u ifit un é c r iv a in q u i a. laiffé le. traité l e plus,
c om p le t 8c l e p lu s m é th o d iq u e qu i eut- e x if té ju f -
q u ’a lo r s dans c e t t e file . G ’eft W â lt e r -Q d in g fom ,
m o in e d ’E v e sh am , a u fii fa v à n t en a ftro u om ie ô c
clans l e s math ém a tiqu e s en g é n é r a l , q u ’i l F é to it
en mu fiqu e., M . B u rn e y c i te c e t o u v ra g e raanuferit;
cl’aprè s u n e c o p ie confie rvé e à .G a i» b r id g e dan s la b ib
lio th è q u e d u c o l lè g e cle B é n e t , & fi d it qu ’il, l ’ a;
t ro u v é fi a b o n d an t & fi c o m p le t , r e la t iv em e n t à.
tou te s le s parties' dé. la mu fiqu e c o n n u e s d u tems.
d e l ’a u t e u r , q u e fi l ’on- p e rd o it to u t C.e q u i en a v o i t
été. é c r it a v a n t lu i y n o s con n o ifian ce s - n ’èn f e -
ro ie n t pas d im in u é e s p o u rv u q u ’o n p u b liâ t ce;
mamiferir..
VAngleterre fi.it tou jo u r s d e n iv e a u a v e c l e s
au tre s nations d e l ’E u ro p e £Our tou s le s progrès-
q u e fit la m u fiq u e , tant à F é g a rd de l ’h a rm o n ie ,,
q u e d e la m e fu r e & du. ch an t. Il e f t ce rta in q u e ^
p e n d a n t le qua torz ième ' & le.; q u in z ièm e fiè c le s ,
cet. a r t y é to it g én é ra lem en t cu lt iv é ;. q ificn y p ra -
f iq u o it le m êm e c o n trep o in t qu’ en I ta lie & e n
F r a n c e , & q u e l ’o n ê om ra en ç o it à c ré e r fu r la
la n g u e n a t io n a le de s ch ants , im ité s de ceux, d e
F E g l i f e , a c com p a gn é s fo u v e n t d’un e h a rm o n ie a u fi î
f im p ie 8c au fii a u f t é r e . .
I l p a ro î r q u e l ’o rg u e é to it tou jo u r s 1e féuF a c com
p a gn em e n t d e la m u fiq u e fa c r é ê , & la : h a rp e *
c o n fe r v é e faits cloute d e p u is les an c ie n s Ba rd e s y
1 A c com p a gn em en t ordinaire d e la m u fiq u e p ro fan
e . A u co u ro n n em e n t de Henri- V , e n 1 4 1 3 ^
i l n ’y a v o i t , dit-on1 ,. p o u r tous- in firum en ts q u e
des h a rp e s ; m a is fi l’o n en cr©i% F h iflo r ien d e c e
p r in c e y le n om b r e d e c e s ha rp e s q u i fe t ro u v a
dans la f a lle d e c é r ém o n ie é to ir prodigieux-.
C e prince- c e p e n d a n t n nhnoit f&s la-mufique , o a
cTtr m o in s la* lo u a n g e ; c a r il; d é fe n d it l .-pa r un.
é d i t , a u x jïOëtes & a u x mufic iê^ s - c è lé o r e f fies
v ié lo ir c s . E n dép it clë c e tte d é f e n f e , la p lu s an -
e iem ie ch an fo n a n g lo ife q u i . e x tf ie e f i c e lle q u i
fu t d om p o fé e aprè s la b a ta ille é ’A z in c o v u t , g a g n é e
A N G
rfïf cê fol fur les François., en I 4*î- Elle s’eft
trouvée dans une colleiSion du collège de la
Magdeleine , à Cambridge ; elle eft notée for pa-
pier vélin , en notes Grégoriennes. Nous la -defi- îons (v. les pl.fig. 21) telle que M. Burney l’a déchiffrée
, & pour ainfi dire traduite én notes
3iiodern.es. — Elle a f i x couplets en vieil anglois, 8c
chacun de ces couplets fe termine en choeur par le
refrain latin.
Deo grattas anglia
Redde pro vifiorix.
Henri VI ne donna point d’édrts contre la mufique.
Les ménétriers fe multiplièrent boauco-up fous
ïbn règne, malgré les troubles & les malheurs dont
il fut traverfé , & l’on a remarqué que dans les
cérémonies publiques , ils étoient payés plus cher
que le clergé.
G’efl alors que fleurirent deux muficiens ,. dont
les noms font encore très-célèbres chez les Anglois ,
Jean Dunflable & Jean Hambois. Le premier , que
quelques auteurs Allemands onf confondu mal-
à-propos avec S. Dunfian, compofa un traité fur
la mufique mefurée y de menfurabili tnujicâ , qui s’efl
perdu ; mais qui a été cité par quelques écrivains,
Ou contemporains, ou venus peu de tems apres
fui; Il fit aufii beaucoup de mufique, dont il ne
refie que quelques fragments , confervés par Gra-
forius & par Morley.
Le dofieur Jean Hambois paffe pour avoir été
jrès-inftruit dans tous les arts ; mais il avoit fait
de la mufique fia principale étude , 8c ceux qui
ont écrit fa vie affurent que pour la connoiffance
de l ’harmonie , la combinaifbn des confonnances ,
l ’art de préparer & de fauver les diffonnances ,
il étoit fupérieur à tous fes contemporains ; il prit
fes degrés en mufique & fut reçu do&eur ; on
ne fait précifémènt fi c-é fut dans l’univerfité de
Cambridge ou dans celle d’Oxford.
L’ Angleterre g fl le feul .pays où la mufique ait été
affez confidérée pour élever au do&orat ; & Fon
peut dire qu’on n’y traite pas légèrement cette
Icience ? puifque les fiatuts de l ’univêrfité d’Ox-
*ford obligent à faire preuve de -fept ans d’étude
St de pratique,, avant d’être admis au grade de
Bachelier , & de cinq autres années depuis 1 ad-
anifïiôn à ce grade, pour afpirer à celui de docteur.
Il faut de plus , pour le baccalauréat ,
faire exécuter publiquement des morceaux de inu-
Jique à cinq parties , dans une féance indiquée &
.affichée trois jours d’avance; & pour le doéïorat,
des molceaux à fix & à huit parties : il eft fingu-
lier que cet ufage, qui remonte jufqu’au quinzième
fiè c le , i f ait encore été imité par aucune des nations
de l’ Europe.
Sous le règne d’Edouard IV, la mufique reçut
de nouveaux encouragements. 11 permit aux mé-
nétriers,qui jufqu’alors étoient errants .& fépàrés
d£ fe réunir en corps 3c de former une com-
A N G 8 3
m l în a ù t é , fo u s la d ir e é lio n d’ un c h e f , & q u i iL
d o n n a l e titre d e Maréchal de s m én é tr ie r s , pa r fé s
le ît r e s -p à ten te s d u 24 a v r il 1469. _
O n fart au fii r em o n te r à c e ro i l ’ é ta b lif fe -
m en t d e la c h a p e lle r o y a l e 8c d e la t ro u p e d e s
m u fic ien s d u r o i , q u i fu b fiften t en c o r e a u jo u rd ’h u i ;
c e q u ’ il y a d e c e r ta in , c ’e f t qu ’ o n t ro u v e dan s
l e livre q u i c o n t ie n t u n r é g lem e n t g é n é ra l p o u r
l ’en tre tien d e fa m a ifo n , u n d é ta il trè s-circon f*
tan cié de s fo n d io n s d e tou s le s m u fic ien s q u il
fix a p rè s d e lu i , tan t p o u r fo n am u fem e n t , q u e p o u r
le f e r v i c e d e fa c h a p e lle .
, V e r s la f in du q u in z ièm e f iè c le , u n gran d n om b
r e d e c om p o ïite iir s fe d ifiin g u è r en t n cn -fe u lem e n t
dans la m u fiq u e d’ é g life , mais dans celle^ q u o »
n om m o it p ro fa n e , jecular, c ’e ft-à -d ir e , qu i cto te
ad ap té e à d e s p a ro le s a n g lo ife s fu r de s fu je t s
n ô n - r e lig ie u x . C e lu i d e c e s an c ie n s c om p o f it e u r s
q u i p a ro ît m é r i te r l e p lu s d’ efiime^ e f t R o b e r t
F a i r fa x , q u i fu t d o â e u r en m u fiq u e a 1 uîvive rfite
h e C am b r id g e . S e s c h a n t s , a in fi q u e c e u x d e fe s
c o n t em p o r a in s , o n t q u e lq u e c h o fe d e ru d e 8c d e
fa u v a g e ; p e u t ê t r e fa u t - i l e n a c cu fe r le s v e r s
q u ’ils m e t to ien t e n m u fiq u e . L a la n g u e - a n g lo ife ,
qu i n o u s p a ro ît en c o r e a u jo u rd ’h u i p e u sm i f ic a .e ,
é t o i t , p o u r a in fi d ire , a lo r s d a n s fo n e n f a n c e , &
la p r o n o n c ia t io n , q u i s’ e f i b e a u c o u p a d o u c i e , fe
r e f fe n to it t ro p e n c o r e d e fo n o r ig in e to u te b arb
a re , p e u r fe p r ê te r fa c i le ni ent^aux in f le x io n s d e
la m u f iq u e , o u p lu tô t p o u r n e lu i p a s com m u n iq u e r
le s fien n e s .
C e q u i n o u s c o n f irm e ro it dans c e t t e o p in io n *
c ’ e f i q u e le s ch an ts e c c lê f ia f iiq u e s d e c e m êm e
F a i r fa x , d e T a v e r n e r , d e J e a n S h e p h a r d , d u d e f t e u r
T y e & d e s au tre s ma ître s d e c e f i è c l e , o n t p lu s
d e d o u c e u r & d e n a tu re l q u e leu r s ch an ts p ro fan e s ;
c ’ efi: c e p en d an t p a r c e s d e rn ie r s qu ’ils f e f ir en t a im e r
d e leu r s c o n tem p o ra in s . L e s m én é tr ie r s le s ch aR -
to ien t e n s’ a c c om p a g n am d u lu th & d u r e b e c
( e fp è c e d e v io lo n ) . Us a lla ie n t a in fi o ffr ir le u r s
ta len ts c h e z le s fe ig n e u r s q u i a v o ie n t la r ép u ta tio n
d’aim e r la m u f iq u e , 8c fu r -to u t c e l l e d e là b ié n
p a y e r . P lu f ie u r s d e c e s fe ig n e u r s en a v o ie n t à
le u r f o l d e , & l’on t ro u v e dan s l ’é ta t d e d é p e n fe d e
la m a îfo n d ’un a n c ie n C om t e d e N o r th um b e r la n d ,
u n lo n g d é ta il d u fe r v i c e de s m én étriers 8c d e le u r s
• fa lah e s ? C em ê r n e C om t e é t a b l i t , en 1 5 1 2 , d a n s u n
d e fe s c h â te au x d e Y o r k s h i r e , u n e c h a p e l le d o n t
la .mufique é to it aü fîi nombreu fie q u e C e lle d’u n e
c a th éd ra le . '
S o n f ils , f ix ièm e d u n o m , h é r ita d e fo n gOut
p o u r la m u fiq u e ; m a is fia p a ff io n p o u r A n n e d e
B o lie n a y a n t c a u f é fia difigta c e , l e ca rd in a l de
"W o lf ie y , fo n e n n e m i , a b u fa d e fo n p o u v o i r au
p o in t d’ e x ig e r q u e l e c om te lu i c é d â t , p o u r fa
p ro p r e c h a p e l l e , le s liv r e s d’è g l i fe 8c le s a n t ip h o -
' n a ire s q u e fo n p è r e lu i a v o i t la if fe s .
L a c h a p e lle d e c e ca rd in a l é g a lo it e n m a gn ific
e n c e , 8c m em e , cîifent le s ln fto r ieu s , f em b lo i j
'forpaffiSr c e lle d u p o n t ife -rom a in . . .