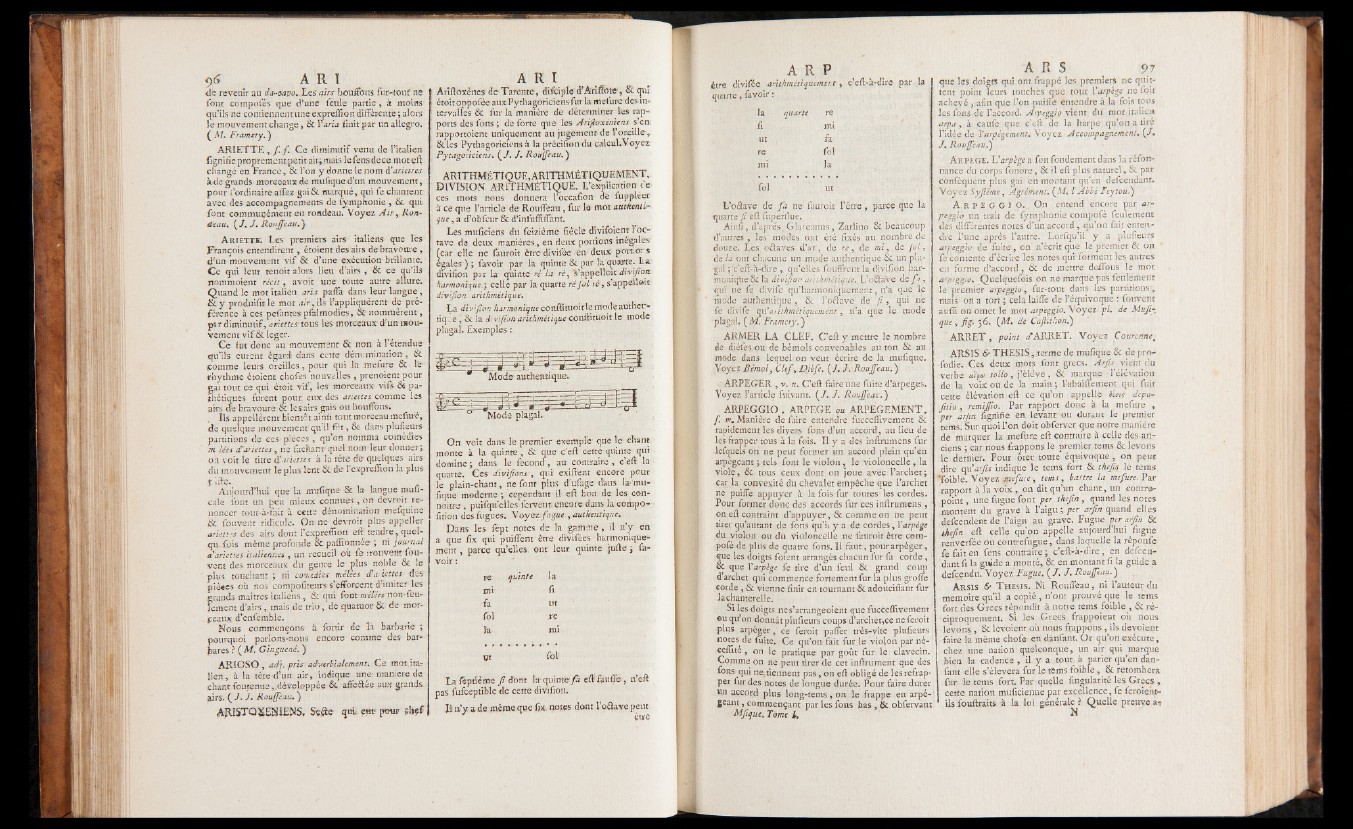
9 <S A R I
de revenir au da-eapo.. Les airs- bouffons fùr-touf ne
font compofés que d’une feule partie , à moins
qu’ils nè contiennent une exprefiion différente ; alors
le mouvement changé, & Varia finit par un allegro.
( AI. F ramer y. j
ARIE TTE f . Ce diminutif venu de l’italien
lignifie proprement petit air; mais lefensde ce mot eft
changé en France, & l’on y donne le nom d'ariettes
à de grands morceaux- de mufique d’un mouvement,
pour l’ordinaire afîez gai & marqué, qui fe chantent
avec des accompagnements de lymphome , 8c qui
font communément en rondeau. Voyez A ir ,, Rondeau.
( 7 . J. Rouffeau.j
A riettk. Les premiers airs italiens que les-
François entendirent, étoient des airs de bravoure ,
d'un mouvement v if & d’une exécution brillante.
C e qui leur tenoit alors lieu d’airs , 8c ce qu’ils
nommoient récit, avoit une toute autre allure.
Quand'le mot italien aria paffa dans leur langue ,
& y produifit le mot air y ils Rappliquèrent de préférence
à ces pefantes pfàlmodies, & 'nommèrent,
ptr diminutif, ariettes tous les morceaux cfun mouvement
v if & léger.
Ce fut donc au mouvement 8c non. à l’étendue
qu’ils eurent égard» dans cette dénomination-, &
comme leurs oreilles, pour qui la mefure & l’e
chythme étoient cliofes nouvelles , prenoient pour
gai tout ce qui étoit v if, les morceaux vifs & pathétiques
furent pour, eux des ariettes comme les
airs de bravoure & les airs gais ou bouffons.
Ils appellèrent bientôt ainfi tout morceau rnefuré,
ide quelque mouvement qu’i l Fit, & dans plufieurs
partitions de ces pièces , qu’on nomma comédies
m lies d'ariettes, ne fackanr quel nom leur donner;
on voit le titre d'ariettes à la tête dé quelques airs
du mouvement le plus lent & dé 1 exprelîion la plus
t iîfo*
Aujourd’hui que la mufique & la langue mufi-
cale font un peu mieux connues , on- devroit renoncer
tout-à-fait à cette dénomination mefquine
iSç fou vent ridicule. On ne devroit plus appeller
ariettes des airs dont l’expreflion eft tendre, quel-
qu.fois même profonde oc paflîonnée ; ni journal
d'ariettes italiennes , un recueil où fe irouvent fou-
vent des morceaux du genre le plus noble 8c le
plus touchant ; ni comédies mêlées <2ariettes des-
pièees où nos composteurs s’efforcent d;imiter les
grands maîtres italiens, & qui font mêlées non-feulement
d’a ir sm a is de trio, de quatuor & de morceaux
d’enfemble.
Nous commençons à. forrir de la barbarie ;
pourquoi parlons-noiis encore comme des barbares
? (AL Ginguenè. )
ARIOSO , ad), pris adverbialement. Ce mot itar
lien , à la tête d’un air, indique une- maniéré de
chant foutenue,,développée 8c. afte&éeaux grands,
gûrs. ( 7 . J. Rouffau. j
AJUSTQSENJENS, Sç&e- qui eut pour ?H«f
A R I
Aiîftoxènes de Tarante , difoiple d’Àriftbüe', 81 qnf
étoit oppofée aux Pythagoriciens fur la melùre des intervalles
8c lur la manière dé déterminer lés rapports
dès fons ; de forte que les Anfioxénitns s’en
rapportoient uniquement au jugement de l’oreille
8c les Pythagoriciens à la précifton du calcul.Voyez
Pytagoriciens. ( 7. 7» Rouleau,}
ARITHMÉTIQUE, ARITHMÉTIQUEMENT
DIVISION ARITHMÉTIQUE. L’explîcation c’e
ces mots nous donnera l’occafion dé fuppléer
à ce que l’article de Roufleau, fur lo mot authentic
que, a cfobfcur 8c d’iniuffiflant.
Les muficiens du feizième fiècle divifoient 1 octave
de deux manières., en deux portions inégalés-
(car elle ne fàuroit être-clivifée en deux port:or s
ég a le s ); favoir par la quinte- 8c par la quarte. La
divifion par la- quinte ré- la ré, Vappelloit divifion
harmonique.; celle par la-quarte réJol té, s’appelait
divifion arithmétique.
Ta divifion harmonique conftituoitle mode anther*
tiqee, 8c la divifion arithmétique c.onftituoit le mode
plagal. Exemptés :
Mode- authentique.
E S 5 E
Mode plagal.
On voit dans le premier exemple que le chant
monte à la quinte, Si que c’e fl cette quinte qui
domine ; dans, le fécond, au- contraire , c’efl: la
quarte. Ces divifion s , qui exiftènt encore pour
le plain-chant, ne font plus d’ufage dàns là* mufique
moderne ; cependant il eft hon de: lescon-
noître , puifqu-elles fervent encore dans la cortipo-
fition des fugues. Voyez fugue , authentique.
Dans les fept notes dé l'a gamme, il- n?y en
a que fix qui puiffent être divifées harmoniquement
, parce qu’elles onr leur quinte jufle ; favoir
:
re quinte la
mi fi
fa ut
fol xc
la mi
u t f o l
La feptième f i dont îar quinte/z eft fauflé , n’eft
pas fufceptible de cette divifion.
J ln V a d e même que fix notes dont l’oâayepeut
y être
A R P
être divifée arithmétiquement, e’eft-à-dire par la
quarte, favoir :
la quarte re
fi mi
ut fa
re fol
mi la
fol ut
L’o&ave de fa ne fauroit l’être , parce que la
quarte f i efl: fuperflue.
Ainfi , d’après^ Glareanus , Zarlino 8c beaucoup
d’autres , les modes ont été fixés au nombre de .
douze. Les oâaves d'ut , de re, de mi, de f o l , i
de la ont chacune un mode authentique & un plagal
; c’eft-à-dire , qu’elles foüffrent la divifion har-
moniqtie 8c la divifion arithmétique. L’oîlaye de f i ,
qui ne fe divife qu’harmoniqiiement, n’a que le
mode authentique , 8c l’o&ave' d t f i , qui né
fé divife qu’arithmétiquement , . n’a qtie le mode
plagal. (AL Fr amer y.')
ARMER L A CLEF. C ’efl: y mettre le nombre
de dièfes.ou de bémols convenables au ton 8c au
mode dans lequel on veut écrire de la mufique.
Voyez Bémol, Clef, Di'efe. ( 7. J. Rouffeau.j
ARPEGER , v. n. C ’efl: faire une fuite d’arpeges.
Voyez l’article foiyant. ( 7. 7. Rouffeau.j
ARPEGGIO , ARPEGE oh ARPEGEMENT,
f. m, Manière de faire entendre fucceflivement 8c
rapidement les diyers fons d’un accord , au lieu de
les frapper tous à la fois. Il y a des inftrumens fur .
lefquels on ne peut former un accord plein qu’en
arpégeant ; tels font le violon, le violoncelle, la
viole, 8c tous Ceux dont on joue avec l’archet ;
car la convexité du chevalet empêche que l’archet
ne puiffe appuyer à la fois fur toutes les cordes.
Pour former donc des accords fur ces inftrumens ,
on efl: contraint d’appuyer, 8c comme on ne peut
tirer qu’autant de fons qu’il, y a de cordes, Varpège
du violon ou du violoncelle ne fauroit être com-
pofé de plus de quatre fons. Il faut, pour arpéger,
que les doigts foient arrangés chacun fur fa corde ,
8c que Varpège fe tire d’un feul 8c grand coup
d’archet qui commence fortement for la plus girofle
corde , 8c vienne finir en tournant 8c adouciflant for
la chanterelle.
Si les doigts ne s'arrange©!ent que fucceflivement
©u qif*on donnât plufieurs coups d’archet,ce ne feroit
plus arpéger, ce feroit paner très-vite plufieurs
notes de fuite. Ce qu’on fait fur le violon par né-;
ceflité , on le pratique par goût for le clavecin.
Comme on ne peut tirer de cet infiniment que des
fons qui ne( tiennent pas, on eft obligé de les refrapper
for des notes de longue durée. Pour faire durer,
un accord plus long-tems, on le frappe en arpé- '
géant, commençant par les fons bas, & obfervant
Mfique. Tome U
A R S 9 7
que les doigt? qui ont frappé les premiers ne quittent
point leurs touches que tout Varpège ne foit
achevé , afin que l’on puiflé entendre à la fois tous
les fons de l’accord. Arpeggiç vient du' mot italien
arpa , à caufe que c’efl: de la harpe, qu’on a tiré
i’idée de V arpège ment. Voyez Accompagnement. (7«
7. Rouffeau.j
A rpégé. L'arpège a fon fondement dans la réfoii-
nance du corps fondre, 8c il eft plus naturel, 8c par
conféqüent plus gai en montant qu’en defeendant.
Voyez Syflême, Agrément. (M. IAbbé Feytou.j
A .r p e g g i o . On entend encore par ar-
peggiô. un trait de. fyniphonie compofé feulement
des différentes notes d’un accord, qu’on fait entendre
l’une âpres l’autre. Lorfqu’il y a plufieurs
arpeggio de fuite, on n’écrit que le premier 8c on
fe contente d’écrire les notes qui forment les autres
en forme d’accord, 8c de mettre defifous le mot
arpeggio. Quelquefois on ne marque pas feulement
le premier arpeggio, fur-tout dans les partitions^
mais on a tort; cela laiffe de l’équivoque : fouvent
aufli on omet le mot arpeggio. Vo yez pl. de Mu fi-,
que , fi g. 3 6. (M. de Cafiiihon.j
A R R E T , point /AR R E T . V o y e z Couronnet
ARSIS & THESIS , terme de mufique & de pro-
fodie. Ces deux mots font grecs. Arfis v'iept àu
verbe »ifet tollo , j’élève , & marque - l’élévation
de la voix où de la main ; l’abaiffement- qui fuit
cette élévation eft ce qu’on appellé &<ns depo-
fitio , remijfio. Par rapport donc à la mefure ,
per arfin fignifie en levant -ou durant le premier
tems. Sur quoi l’on doit obferver que notre manière
de marquer la mefure eft contraire à celle des anciens
; car nous frappons le premier tems 8c levons
le dernier. Pour ôter toute équivoque, on peut
dire quarfis indique le tems fort 8c thefis le tems.
*foiblè. Vo yez mefure , tems, battre la mefure. Par
rapport à la voix , on dit qu’un chant, un contrepoint
, une fugue font per thefin, quand les notes
montent du grave à l’aigu; per arfin quand elles
defcendent de l’aigu au grave. Fugue per arfin 8c
thefin eft celle qu’on appelle aujourd’hui fugue
renverfée ou contrefugue, dans laquelle la réponfc
fe fait en fens contraire; c’eft-à-dire, en defeen-
dant fi la giûde a monté, 8c en montant fi la guide a
defeendu. Vo yez Fugue. ( 7. 7. Roujfeau. )
Arsis & T hesis. Ni Roufleau, m l’auteur du
mémoire qu’il a copié, n’ont prouvé que le tems
fort des Grecs répondît à notre tems foible , 8c réciproquement.
Si les Grecs frappoient où nous
levons , 8c levoient où nous frappons, ils dévoient
faire là même chofe en dànfant. Or qu’on exécute,
chez une nation quelconque, un air qui marque
bien la cadence , il y a tout à parier qu’en dan-
fant elle s’élèvera fur le tems foib le, 8c retombera
fur le tems fort. Par quelle fingularité les Grecs ,
cette nation muficienne par excellence, fe feroieîit-
ils fouftraits à la loi générale ? Quelle preuve a.