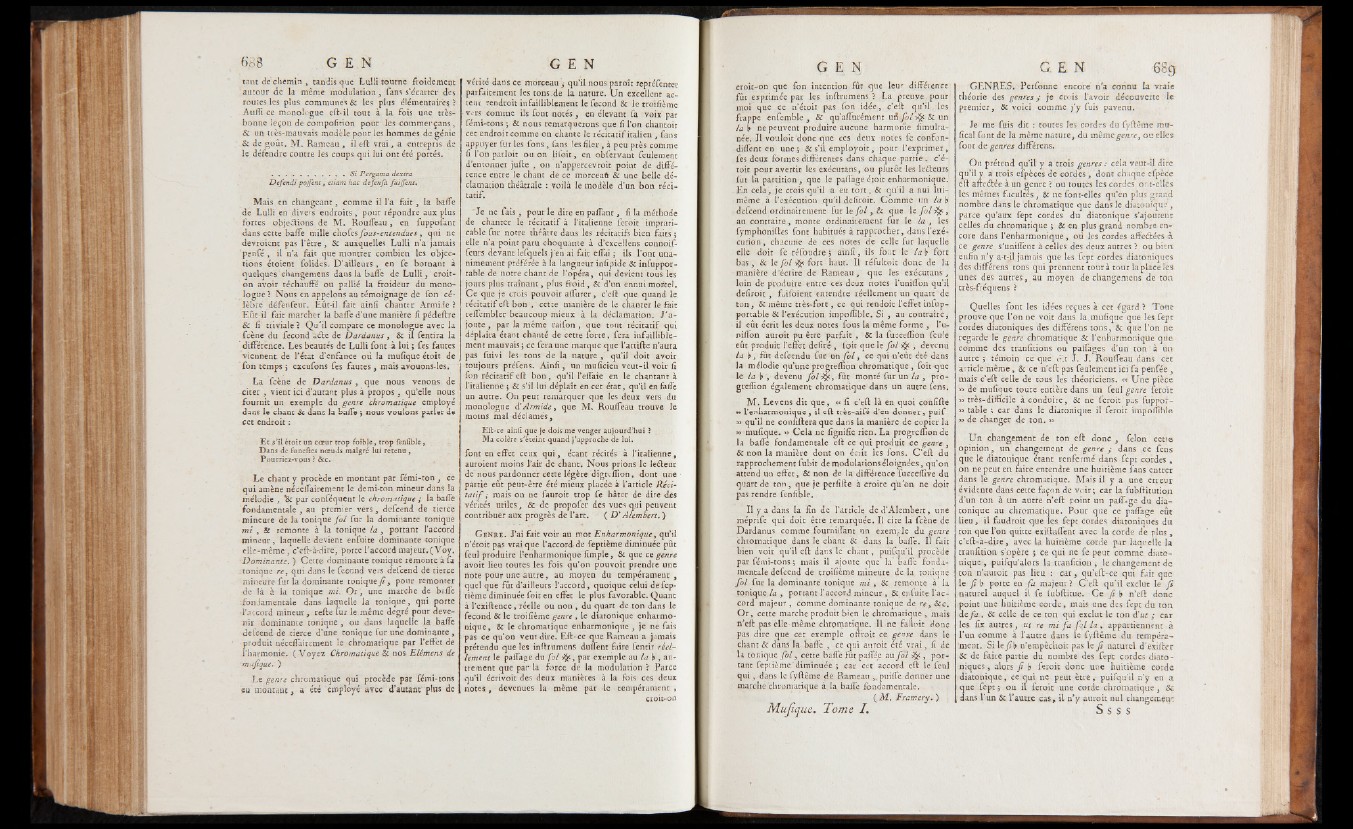
tant dé chemin , tandis que Lulli tourne froidement
autour de la même modulation , fans s’écarter dés
routes les plus communes & les plus élémentaires ?
Auffi ce monologue eft-il tout à la fois une très-
bonne leçon de compofition pour les commerçans,
& un très-mauvais modèle pour les hommes de génie
& de goût. M . Rameau j il eft v ra i, a entrepris de
le défendre contre les coups qui lui ont été portés.
...............................St Pergama dextra
Defendi pojfent, etiam hac defenfa fuijjent.
Mais en changeant, comme il l’a fait , la baffe
de Lulli en divers' endroits , pour répondre aux plus
fortes objections de M. RoulTeau, en fuppofant
dans cette balle mille chofes fous-entendues, qui ne
devrôient pas l’ê tre, & auxquelles Lulli n’a jamais
penfé , il n’a faic que montrer combien les objections
étoient folides. D ’ailleurs , en fe bornant à
quelques changemens dans la baffe de Lulli , croit-
on avoir réchauffé ou pallié la froideur du monologue
? Nous en appelons au témoignage de fon célèbre
défenfeur. Eût-il fait ainfi chanter Armide ?
Eût-il fait marcher la baffe d’une manière fî pédeftre
8c lî triviale? Q u ’il compare ce monologue avec la
fcène du fécond aéte de Dardanus , & il fentira la
différence. Les beautés de Lulli font à lui ; fes fautes
viennent de l’état d’enfance où la mufique étoit de
fon temps ; exeufons fes fautes , mais avouons-les.
La fcène de Dardanus, que nous venons de
citer , vient ici d’autant plus à propos . qu’elle nous
fournit un exemple du genre chromatique employé
dans le chant 8c dans la baffe ; nous voulons parler de
cet endroit :
E t s’il étoit un coeur trop foible, trop fenfîble ,
Dans de funeftes noeuds malgré lui retenu ,
Pourriez-vous ? &c.
L e chant y procède en montant par fémi-ton s ce
qui amène néceffairement le demi-ton mineur dans la
mélodie , & par conféquent le chromatique y la baffe
fondamentale, au premier v e r s , defeend de tierce
mineure de la tonique fo l fur la dominante tonique
mi , & remonte à la tonique la , portant l’accord
mineur, laquelle devient enfuite dominante tonique
elle-même, c’eft-à-dire, porte l’accord majeur. (V o y .
Dominante. ) C e tte dominante tonique remonte à la
^tonique re, qui dans le fécond vers defeend de tierce
mineure fur la dominante tonique f i y pour remonter
de là à la tonique mi. O r , une marche de baffe
:fonJamentale dans laquelle la tonique, qui porte
-l’accord mineur, refte lur le même degré pour devenir
dominante tonique , ou dans laquelle la baffe
defeend de rierce d’une tonique fur une dominante ,
produit néceffairement le chromatique par l’effet de
i’harmonie. (V o y e z Chromatique & nos Elémens de
mufique. )
Le genre chromatique qui procède par fémi-tons
eu montant, a été employé avec d’autant plus de
vérité dans ce morceau y qu’il nous paraît repréfenter
parfaitement les tons.de la nature. Un excellent acteur
rendroit infailliblement le fécond & le trailième
vers comme ils font notés , en élevant fa voix par
fémi-tons j & nous remarquerons que fi l’on chantoic
cet endroit comme on chante le récitatif italien , fans
appuyer fur les fon s , fans les file r , à peu près comme
fi l’on parloir ou on lifo it, en obfervant feulement
d’entonner jufte ^ on n’appercevroit point de différence
entre le chant de ce morceaft 8c une belle déclamation
théâtrale : voilà le modèle d’un bon récitatif.
Je ne fais , pour le dire en paffant, fi la méthode
de chanter le récitatif à l’italienne feroit impraticable
fur notre théâtre dans les récitatifs bien faits ;
elle n’a point paru choquante à d’excellens connoif-
feurs devant lefquels jen ai fait efl'ai $ ils l’ont unanimement
préférée à la langueur infipide & infuppor-
table de notre chant de l’opéra, qui devient tous les
jours plus traînant, plus fro id , & d’un ennui mortel.
C e que je crois pouvoir aflurer, c’eft que quand le
récitatif eft boh , cette manière de le chanter le fait
reffembler beaucoup mieux à la déclamation. J 'a joute
, par la même raifon , que tout récitatif qui
déplaira étant chanté de cette for te , fera infailliblement
mauvais; ce fera une marque que l’artifte n’aura
pas fuivi les tons de la nature, qu’il doit avoir
toujours préfens. A in fi, un muficien veut-il voir fi
fon récitatif eft b on , qu’il l’effaie en le chantant à
l’italienne ; 8c s’il lui déplaît en cet état, qu’il enfaffe
un autre. On peut remarquer que les deux vers du
monologue d’Armide, que M. Rouffeau trouve le
moins mal déclamés,
Eft-ce ainfi que je dois me venger aujourd’hui ?
Ma colère s’éceint quand j’approche de lui.
font en effet ceux q u i, étant récités à l’italienne,
auroient moins l’air de chant. Nous prions le leéleur
de nous pardonner cette légère digrclfion, dont une
partie eût peut-être été mieux placée à l’article Récitatif
; mais on ne fauroit trop fe hâter de dire des
vérités utiles, & de propofer des vues qui peuvent
contribuer aux progrès de l’àrt. ( D'Alembert. )
G enre. J’ai fait voir au mot Enharmonique, qu’ il
n’étoit pas vrai que l’accord de feptième diminuée pût
feul produire l’enharmonique fîmple, & que ce genre
avoit lieu toutes les fois qu’on pouvoit prendre une
note pour une au tre, au moyen du tempérament ,
quelque fût d’ailleurs l’accord, quoique celui de feptième
diminuée foit en effet le plus favorable. Quant
à l’exiftence » réelle ou n o n , du quart de ton dans le
fécond & le trôifième genre , le diaronique enharmonique,
& le chromatique enharmonique , je ne fais
pas ce qu’on veut dire. Eft-ce que Rameau a jamais
prétendu que les inftrumens duffent faire fentir réellement
le paffage du fol par exemple au la 1», autrement
que par la force de la modulation ? Parce
qu’il écrivoit des deux manières à la fois ces deux
n o tes , devenues la même par le tempérament »
Cioit-on
croit-on que fon intention fût que leur différence
fût exprimée par les inftrumens? La preuve, pour
moi que ce n’étoit pas fon idée, c’eft qu’il les
frappe enfcmble , & qu’affùrément uff fo l & un
la ^ ne peuvent produire aucune harmonie fimulra-
néè. Il vouloit ’donc que ces deux notes fe confon-
diffent en une; & s’il employoit, pour l’exprimer,
fes deux formes différentes dans chaque partie.. c’é-
toit pour avertir les çxécutans, ou plutôt les leéteurs
fut la partition , que le paffage étoit enharmonique.
En cela, je crois qu’il a eu t o r t , & qu’il a nui lui-
même à l’exécution qu'il defiroit. Comme un la b
defeend ordinairement fur 1 a f o l , & que 1 z fo l ,
au contraire, monte ordinairement fur le la , les
fymphoniftes font habitués à rapprocher, dans l’exécution
, chacune de ces notes de celle fur laquelle
elle doit fe réfoudre > a infi, ils font le la\ fort
b a s , & le fo l fort haut. Il réfultoit donc de la
manière d ’écrire de Rameau, que les exécutans ,
loin de produire entre ces deux notes l’uniffon qu’il
de firoit, fuifoient entendre réellement un quart de
to n , & même très-fort, ce qui rendoic l’effet infup-
portable & l’exécution impoffible. Si , au contraire j
il eût écrit les deux notes fous la même forme , l’u-
niffon auroic pu être parfait , & la fucèeflion feule
eût produit l’effet defiré , loit que le fol ■%£ , devenu
la b , fût defeendu fur un f o l , ce qui n’eût été dans
Ja mélodie qu’une progrelfion chromatique, foit que
le la b , devenu fo l 5$c-,-fûc monté fur un la , pro-
gtclfion également chromatique dans un autre Cens.
M . Levens dit que, ce fi c’eft là en quoi confifte
» l’enharmonique, il eft très-aifé d’en donner, puif-
» qu’il ne confifteraque dans la manière de copier la
» mufique. » C e la ne lignifie rien. La progrelfion de
la baffe fondamentale eft ce qui produit ce genre ,
& non la manière dont on écrit les fons. C ’eft du
rapprochement fubit de modulations éloignées, qu’on
attend un effe t, & non de la différence fucceflive du
quart de ton , que je perfifte à croire qu’on ne doit
pas rendre fenfible.
Il y a dans la fin de l’article de d’Alembert, une
méprife qui doit être remarquée. Il cite la fcène de
Dardanus comme fournilfant un exemple du genre
chromatique dans le chant 8c dans la baffe. Il fait
bien voir qu’ il eft dans'ie chant, puifqu’il procède
par fémi-tons ; mais il ajoute que la baffe Fondamentale
defeend de trôifième mineure de la tonique
fo l fur la dominante tonique mi , & remonte à la
tonique la , portant l’accord mineur , 8c epfuire l’accord
majeur, comme dominante tonique de re y &c.
O r , cette marche produit bien le chromatique , mais
n’eft pas elle même chromatique. Il ne falloit donc
pas dire que cet exemple offrait ce genre dans le
chant 8c dans la baffe , ce qui auroic été v r a i, fi de
la tonique fo l , cette baffe fût paffée au fo l >$c, portant
feptième diminuée ; car cct accord eft le feul
q u i, dans le fÿftême de Rameau ,s puiffe donner une
marche chromatique à la baffe fondamentale.
(. M. Framery. )
Mufique. Tome I.
G EN R E S . Perfonne encore n’a connu la vraie
théorie des genres y je crois l’avoir découverte le
premier, & voici comme j’y fuis pavenu.
Je me fuis dit : toutes les cordes du fyftême mtî-
fical font de la même nature, du même genre, ou clics
font de genres différens.
On prétend qu’il y a trois genres : cela veut-il dire
qu’il y a trois efpèces de cordes , dont chaque efpèce
eft affe&ée à un genre ? ou toutes les cordes ont-elles
les mêmes facultés, & ne font-elles qu’en plus grand
nombre dans le chromatique que dans le diatonique,
parce qu’aux fept cordes du diatonique s'ajoutent
celles du chromatique ; & en plus grand nombre encore
dans l’enharmonique, où les cordes affrétées à
ce genre s’uniffent à celles des deux autres ? ou bien
enfin n’y a-t^l jamais que les fept cordes diatoniques
des différens tons qui prennent tour à tour la place les
unes des autres, au moyen de clîangemens de ton
très-fréquens ?
Quelles font les idées reçues à cet égard ? T o u t
prouve que l’on ne voit dans la. mufique que les fept
cordes diatoniques des différens tons, & que l’on ne
regarde lé genre chromatique & l’enharmonique que
cdmme des tranfidons ou paffages d’un ton à un
autre ; témoin ce que dit J. J. Rouffeau dans cct
article m ême, 8c ce n’eft pas feulement ici fa penfée,
mais c’eft celle de tous les théoriciens. « U n e pièce
* de mufique toute entière dans un feul genre ferait
» très-difficile à conduire, & ne feroit pas fuppof-
» table ; car dans le diatonique il feroit impolfible
» de changer de ton. »
U n changement de ton eft donc , félon cette
opinion, un changement de genre y dans ce fens
que le diatonique étant renfermé dans fept cordes ,
on ne peut en faire entendre une huitième lans entrer
dans le genre chromatique. Mais il y a une erreur
évidente dans cette façon de vo ir ; car la fubfticutiqn
d’un ton à un autre n’eft point un paffage du diatonique
au chromatique. Pour que ce paffage eût
lieu , il faudrait que les fept cordes diatoniques du
ton que l’on quitte exiftaffent avec la corde de plus ,
c’eft-à-dire, avec la huitième corde par laquelle la
tranfition s’opère ; ce qui ne fe peut comme diatonique,
piiifqu’alors la tranfition > le changement de
ton n’auroit pas lieu : c a r , qu’eft-ce qui fait que
le f i b porte en fa majeur ? C ’eft qu’ il exclut le f i
naturel auquel il fe (ubftitue. C e f i n’eft donc
point une huitième corde, mais une des fept du ton
de fa , 8c celle de ce. ton qui exclut le ton d’ut ; car
les fix autres, ut re mi fa f i l la , appartiennent à
l’un comme à l’autre dans le fyftême du tempérament.
Si 1 t fi^ n’empêchoic pas le f i naturel d'exifter
8c de faire partie du nombre des fept cordes diatoniques
, alors fi b ferait donc une huitième corde
diatonique, ce qui ne peut être, puifqu’il n’y en a
que fept ; ou il ferait une corde chromatique , 8c
dans l ’un 8c l’ autre cas, il n’ y aurait nul changement