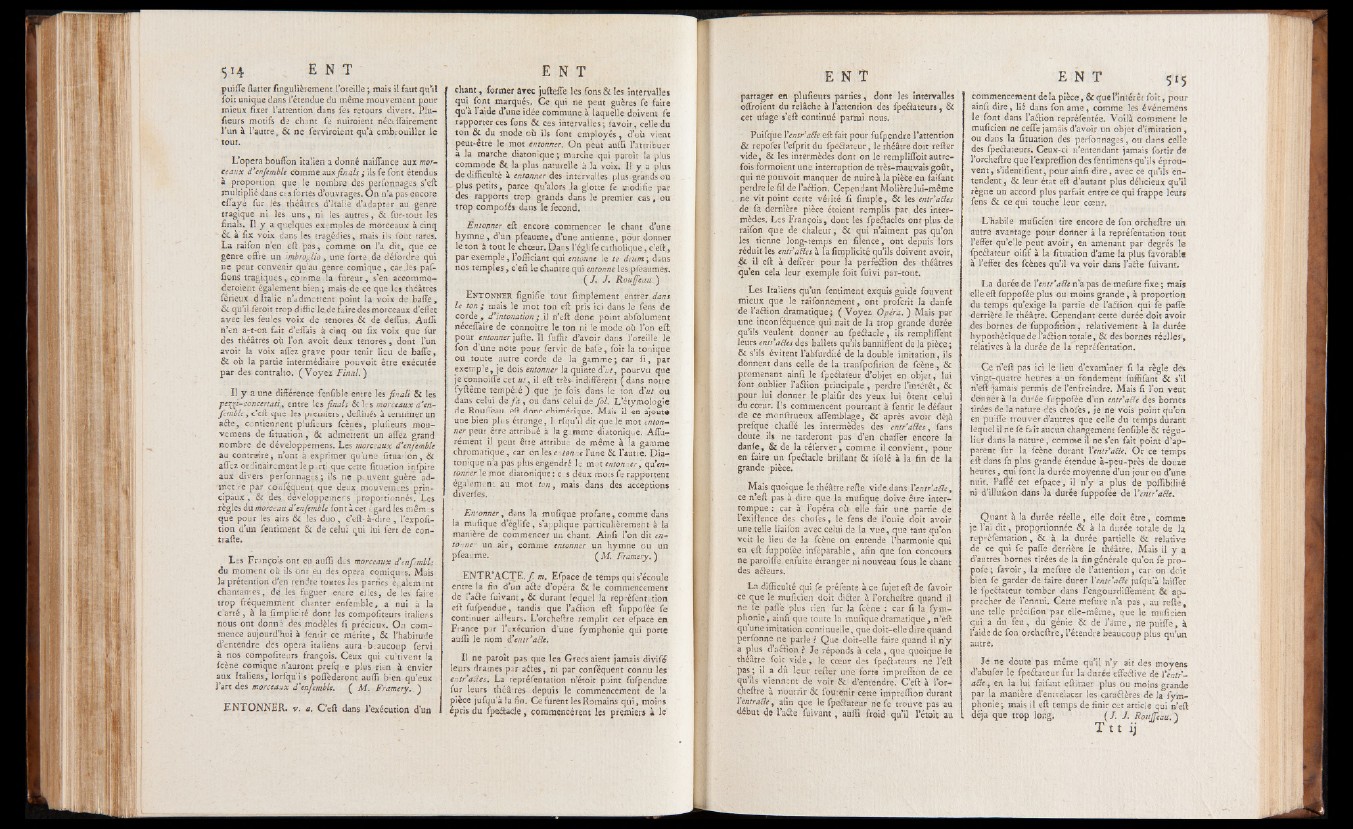
puiffe flatter fingulièrement l’oreille ; mais il faut qu’il
foit unique dans l’étendue du même mouvement pour
mieux fixer l’attention dans fies retours divers. Plusieurs
motifs de chant fie nuiraient néct flairement
l ’un à l’autre, & ne ferviroient qu’à embrouiller le
tout.
L’opera bouffon italien a donné naiffance aux morc
e a u x d ’ enfemble comme a u x f in a l s ; ils fie font étendus
à proportion que le nombre des perfionnages s’eft
multiplié dans et s fortes d’ouvrages. On n’a pas encore
effayé fur les théâtres d’Italie d’adapter au genre
tragique ni les uns, ni les autres ,• & fur-tout les
fi nais. Il y a quelques exemples de morceaux à cinq
&. à fix voix dans les tragédies, mais ils font rares,
l a raifon n’en eft pas, comme on l’a dit, que ce
genre offre un im b ro glio 3 une forte .de défordre qui
ne peut convenir qu’au genre comique, car .les paf-
fions tragiques, comme la fureur, s’en accommoderaient
également bien ; mais de ce que les théâtres
férieux dItalie n’admettent point la voix de baffe,
& qu’il ferait trop difficle.de faire des morceaux d’effet
avec les feules voix de tenores & de dédias. Audi
n’en a-t-on Lit d’effais à cinq ou fix voix que fur
des théâtres où l’on avoit deux tenores, dont l’un
avoir la voix allez grave pour tenir lieu de baffe,
& où la partie intermédiaire pou voit être exécutée
par des contralto. (Voyez F i n a l . ' )
Il y a une différence fenfible entre les f in a l i & les
p e t f j - c o n c e r tâ t^ entre les f in a l s & les m o r c ea u x d ’ enfem
b le , c’eft que les premiers , deftinés à terminer un
a£le,. contiennent pîufieurs fcènes, plufieurs mou-
vemens de fituation, & admettent un affez grand
nombre de développe mens. L e s m o r c ea u x d ’ en femble
au contraire ; n’ont à exprimer qu’une fitua-ion, &
affez ordinairement le parti que cette fituation i nfpire
aux divers perfionnages; ils ne peuvent guère admet
re par corifé.quent que deux mouvemens principaux
, & des développemers proportionnés. Les
règles du m orcea u d ’ enfemble font à cet égard les mêm .s
que pour lès airs & les duo, c’eft-à-dire, l'expofi-
tion d’un fentiment & de celui qui lui fert de contraire.
Les François ont euauffi des m o r c ea u x d ’e n fm b l e
du moment où ils Ont eu des opéra comiques. Mais
la prétention d’en rendre toutes les parties égalent nt
chantantes, de les fuguer entre elles, de les faire
trop fréquemment chanter enfemble, a nui à la
c'arté , à la fini pl ici té dont les compofiteurs italiens
nous ont donné des modèles fi précieux. On commence
aujourd’hui à fenrir ce mérite, & l’habitude
d’entendre des opéra italiens aura beaucoup fervi
à nos compofiteurs françois. Ceux qui cultivent la
fcène comique n’auront prefq e plus rien à envier
aux Italiens/lorfqui's poffèderont auffi bien qu’eux
l’an des m o r c ea u x d ’ enjem b le. ( M . F ram e ry . )
ENTONNER, v . a, C’eft dans l’exécution d’un
chant, former avec jufteffe les fions & les intervalles
qm font marqués. Ce qui ne peut guères fe faire
qu’à laide d’une idée commune à laquelle doivent fe
rapporter ces fions & ces intervalles ; favoir, celle du
ton & du mode où ils font employés, d’où vient
peut-être le mot en tonner. On peut auffi l’attribuer
a la marche diatonique ; marche qui paraît la plus
commode & la plus naturelle à la voix. Il y a plus
de difficulté a entonner des intervalles plus grands ou
. plus petits, parce qu’alors Ja glotte fe çnodifie par
des rapports trop grands dans le premier cas , ou
trop compofés dans le fécond.
E n to n n e r eft encore commencer le chant d’une
hymne , d’un pfeaume, d’une antienne, pour donner
le ton à tout le choeur.Dars l’églife catholique, c’eft,
par exemple, l’officiant qui entonne le te d eum ; dans
nos temples, c’eft le chantre qui en tonne les pfeaumes.
(/ . /. R o u j f e a u .')
Entonner fignifie tout fimplement entrer d a n s
l e t o n ; mais le mot ton eft pris ici dans le fens de
corde, d ’ in to n a tio n ,\il n’eft donc point abfolument
néceffaire de connoître le ton ni le mode où l’on eft,
pour entonner jufte. Il fuffit d’avoir dans l’oreille le
fon d’une note pour fervir de bafe, foit la tonique
ou toute autre corde de la gamme ; Car fi, par
exemp’e, je dois entonner la quinte d ’ u t , pourvu que
jeconnoiffe cet u t , il eft très-indifférent (dans notre
: fyftême tempéré) que je fois dans le ton d ’u t ou
dans celui de f a , ou dans celui d e f o l . L’étymologie
de RoufTeau eft donc chimérique. Mais il en ajoute
une bien plus étrange, 1- rfqu’il dit que le mot en tonn
er peut être attribué à la g.rame- diatonique. Affu-
rément il peut être attribue de même à la gamme
chromatique, car on les en to n n eTune & l’autre. Diatonique
n’a pas plus engendré le mot en to n n e r , qu*«z-
tonr.er le mot diatonique: c s deux mots fe rapportent
également, au mot t o n , mais dans des acceptions
» diverfes.
E n 'o n n e r , dans la mufique profane, comme dans
la mufique d’églife, s’applique particulièrement à la
manière de commencer un chant, Ainfi l’on dit ento
n n e - un air, comme en tonn e r un hymne ou un
pfeaume. ( M . Fram e ry . )
ENTR’ACTE./! m. Efpace de temps qui s’écoule
entre la fin d’un afte d’opéra & le commencement
de l’aâe fuivant, & durant lequel la repiéfentation
eft fufpendue, tandis que l’aétion eft fuppofée fe
continuer ailleurs. L’orcheftre remplit cet efpace en
France par l’exécution dune fymphonie qui porte
auffi le nom d’ e n t r ’aSle.
Il ne paraît pas que les Grecs aient jamais divifé
leurs drames par aéles, ni par conféquent connu les
en tr ’a S le s . La repréfentation n’étoit point fufpendue
fur leurs théârres depuis le commencement de la
pièce jufqu'à la fin. Ce furent les Romains qui, moins
épris du fpeétacle, commencèrent les premiers à le
partager en plufieurs parties, dont les intervalles
offraient du relâche à l’attention des fpeélateurs, &
cet ufage s’eft continué parmi nous.
Puifque Y en tr ’aSle eft fait pour fufpendre l’attention
& repofer l’efprit du fpeélateur, le théâtre doit refter
vide, & les intermèdes dont on le rempliffoit autrefois
formoient une interruption de très-mauvais goût,
qui ne pouvoit manquer de nuire à la pièfce en faifant
perdre le fil de l’aélion. Cependant Molière lui-même
ne vit point cette vérité fi fimple, & les en tr’ aSles
de fa dernière pièce étoient remplis par des intermèdes.
Les François, dont les fpeélacles ont plus de
raifon que de chaleur , & qui n’aiment pas qu’on
les tienne long-temps en filence, ont depuis lors
réduit les entr’ aSles à la fimplicité qu’ils doivent avoir,
& il eft à deffrer pour la perfe&ion des théâtres
qu’en cela leur exemple foit fuivi par-tout.
Les Italiens qu’un fentiment exquis guide fouvent
mieux que le raifonnement, ont proferit la danfe
de l’a&ion dramatique; ( Voyez O p é r a . ) Mais par
une inconféquence qui naît de la trop grande durée
qu’ils veulent donner au fpeélacle, ils rempliffent
leurs entr’aSles des ballets qu’ils banniflent de la pièce ;
& s’ils évitent l’abfurdité de la double imitation, iis
donnent dans celle de la tranfpofition de fcène, &
promenant ainfi le fpeélateur d’objet en objet, lui
font oublier l’aélion principale , perdre l’intérêt, &
jîour lui donner le plaifir des yeux lui ôtent celui
du coeur. I s commencent pourtant à fentir le défaut
de ce monftrueux affemblage, & après avoir déjà
prefque chaffé les intermèdes des en tr’ a S le s , fans
doute ils ne tarderont pas d’en chaffer encore la
danfe, & de la réfervèr, comme il convient, pour
en faire un fpeftade brillant & ifolé à la fin de la
grande pièce.
Mais quoique le théâtre refte vide dans-1’en tr ’a S le ,
ce n’eft pas à dire que la mufique doive être interrompue
: car à l’opéra cù elle fait une partie de
l’exiftence des chofes, le fens de l’ouïe doit avoir
une telle liaifon avec celui de la vue, que tant qu’on
veit le lieu de la fcène on entende l’harmonie qui
en eft fuppofée infépârable, afin que fon concours
ne paroifte enfuite étranger ni nouveau fous le chant
des a&eurs.
La difficulté qui .fe préfente à ce fujeteftde favoir
ce que le muficien doit diéler à l’orcheftre quand il
ne fe paffe plus rien fur la fcène : car fi la fym-
phonie, ainfi que tonte la mufique dramatique , n’eft
qu une imitation continuelle, que doit-elle dire quand
perfonne^ ne parle ? Que doit-e|le faire quand il n’y
a plus d’aâion ? Je réponds à cela , que quoique le
théâtre foit^ vide, le coeur des fpeélateurs ne l’eft
.pas ; il a du leur refter une fort« impreffiôn de ce
qu ils viennent de voir & d’entendre. C’eft à l’or-
qheftre à nourrir & foutenir cette impreffiôn durant
1 en traSle, afin que le fpeélateur ne fe trouve pas au
début de lade fuivant, auffi froid qu’il l’étoit au
commencement delà pièce, & que l’intérêt foit, pour
ainfi dire, lié dans fon ame , comme les événemens
le font dans l’a&ion repréfentée. Voilà comment le
muficien ne ceffe jamais d’avoir un objet d’imitation,
ou dans la fituation des perfonnages , ou dans celle
des fpe&ateurs. Ceux-ci n’entendant jamais fortir de
l’orcheftre que l'expreffion des fentimens qu’ils éprouvent,
s’identifient, pour ainfi dire, avec ce qu’ils entendent
, & leur état eft d’autant plus délicieux qu’il
règne un accord plus parfait entre ce qui frappe leur*
fens & ce qui touche leur coeur.
L’habile muficien tire encore de fon orcheftre un
autre avantage pour donner à la repréfentation tout
l’effet qu’elle peut avoir, en amenant par degrés le
fpeélateur oifif à la fituation d’ame la plus favorable
à l’effet des fcènes qu’il va voir dans l’aéte fuivant.
La durée de Yen tr ’ aSle n’a pas de mefure fixe ; mais
elle eft fuppofée plus ou moins grande, à proportion
du temps qu’exige la partie de l’aéfion qui le paffe
-derrière le théâtre. Cependant cette durée doit avoir
des bornes de fuppofition, relativement à la durée
hypothétique de l’a&ion totale, & des bornes réelles ,
relatives à la durée de la repréfentation.
Ce n’eft pas ici le lieu d’examiner fi la règle des
vingt-quatre heures a un fondement fuffifant & s’il
n’eft jamais permis de l’enfreindre. Mais fi l’on veut
donner à la durée fuppofée d’un en tra S le des bornes
tirées de la nature des chofes, je ne vois point qu’où
en puiffe trouver d’autres que celle du temps durant
lequel il ne fe fait aucun changement fenfible & régulier
dans la nature, comme il ne s’en fait point d’apparent
fur la fcène durant Yentr’aSle, Or ce temps
eft dans fa plus grande étendue à-peu-près de douze
heures , qui font la durée moyenne d’un jour ou d’une
nuit. Paffe cet efpace, il n y a plus de poffibilité
ni d’illufion dans la durée fuppofée de Y e n t r ’aSle.
Quant à la durée réelle, elle doit être, comme
je l’ai dit, proportionnée & à la durée totale de la
repréfentation, & à la durée partielle & relative
de ce qui fe paffe derrière le théâtre. Mais il y a
d’autres bornes tirées de la fin générale qu’on fe pro-
pofe; favoir, la mefure de l’attention, car on doit
bien fe garder de faire durer Y e n tr ’aSle jufqu'à laiffer
lé fpe&ateur tomber dans l’engourdiflement & approcher
de l’ennui. Cette mefure n’a pas, au refte,
une telle précifion par elle-même., que le muficien
qui a du feu, du génie & de lame, ne puiffe, à
l’aide de fon orcheftre, l’étendre beaucoup plus qu’un
autre.
Je ne doute pas même qu’il n’y ait des moyens
d’abufer le fpe&ateur fur'la durée effeéfive de Yentr’aSle
, en la lui faifant eftimer plus ou moins grande
par la manière d’entrelacer les cara&ères de la fymphonie
; mais il eft temps de finir cet article qui n’eft
déjà que trop long, ( J . J . R p u j f e a u . ')