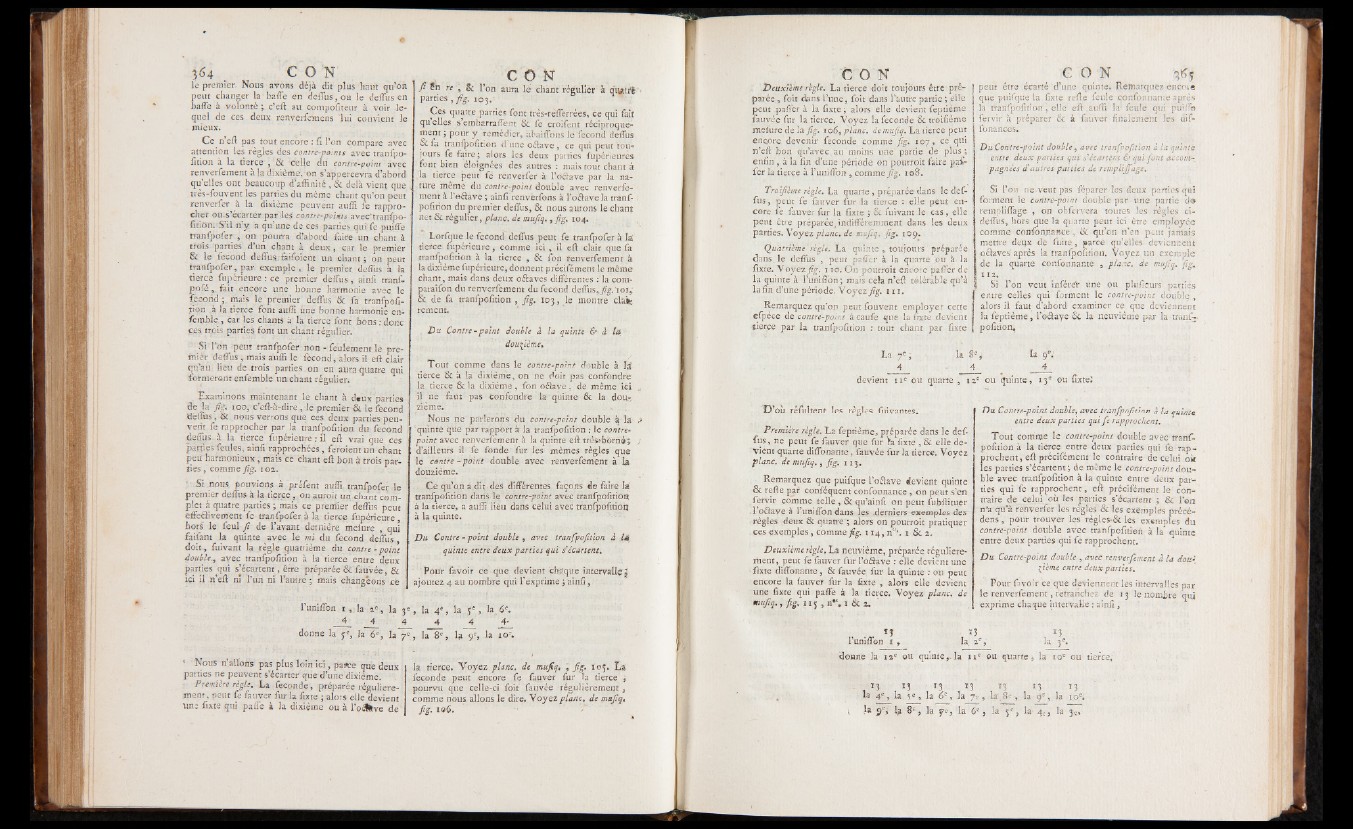
3 6 4 C O N
le premier. Nous avons déjà dit plus haut qu’on
peut changer la baffe en deffus , ou le deffus en
baffe à volonté ; c’eft au compofiteur à voir lequel
de ces deux renverfemens lui convient le
mieux.
Ce n’efl pas tout encore : fi l’on compare avec
attention les règles des contre-points avec tranlpo-
fition à la tierce celje du contre-point mec
renverfement à la dixième, on s’appercevra d’abord
qu’elles ont beaucoup d’affinité , & delà vient que
tres-fouvent les parties du même chant qu’on peut
renverfer a la dixième peuvent aufli le rapprocher
ou.s’écarter par lies contre-points avec'trapfpo-
fitiOn; S’il n’y a qu’une de ces parties qui fe puiffe
tranfpofer , on pourra d’abord fa ite , un chant à
trois parties d’un chant à deux , car le premier
& le fécond deffus. faifoient un chant ; on peut
tranfpofer, par, exemple, le premier deiîus a la
tierce fupérieure : ce premier deffus , ainfi tranf-
p o fé ? fait encore une bonne harmonie avec le
fécond mais le premier deffus & fa tranfpofi-
fton .à la tierce font auffi une bonne harmonie en-
fetpble , car les chants à la tierce font bons : donc
ces trois parties font un chant régulier.
’ Sj l’on peut tranfpofer non - feulement le prend
év deffus ,.mais auffi le fécond, alors il eft clair
qu’au lieu de trois parties on en aura quatre qui
formeront enfemble unchant régulier;
Examinons maintenant le chant à deux parties
de la fié. ioo, t ’eft-à-dire , le premier & le fécond :
demis, &. nous verrons que ces deux parties peuvent
fe^ rapprocher par la tranfpofition du fécond ■
deffus. à la tierce fupérieure : il eft vrai que ces j
parties feules, ainfi rapprochées., feraient un chant
peu harmonieux, mais ce chant eft bon a trois parties
, comme fi-, 102.
■ Si .nous pouvions à 'prêtent auffi, tranfpofer le
premier deffus à la tierce „o n aurait un chanVcom- ;
plet à quatre parties ; mais ce premier deffus peut ‘
effeélivement fe tranfpofer à la tierce fupérieure
hors le feul f i de l’avant dernière mefure , qui
faifant la quinte avec le mi du fécond deffus
doit., fuivant la règle quatrième du contre f point
double., avec tranfpofition à la tierce entre deux
parties qui s’écartent, être préparée & fauvée, &
ici il n’eft nï l’un ni l’autre ; mais changeons ce
C O N
f i tn re , & l’on aura le chant régulîèr à qtMtffc
parties, fig, 103.'
Ces quatre parties font très-rèfferrées, ce qui fait
quelles s’embarraient & fe croifent réciproquement
; £our y remédier, abaiffons le fécond deffus
& fa tranfpofition d’une oéfcave, ce qui peut tou-»
jours fe faire; alors les deux parties fupérieures
font bien éloignées des autres : mais tout chant à
la tierce peut fé renverfer à l’oftave par la nature
meme du contre-point double avec renverfement
à Foélave ; ainfi renvèrfons à Foélave la tranfpofition
du premier deffus, & nous aurons le chant
net & régulier, plane. de mufiq. , fig, 104.
Lorfque le fécond deffus peut fe tranfpofer à là
tierce fupérieure, comme i c i , il eft clair que fa
îranfpofition à la tierce , & fon renverfement à
la dixième fupérieure, donnent préeifément le même
chant, mais dans deux oftaves différentes : la com-
paraifon du renverfement du fécond deffus, fig. '101^
& de fa tranfpofition , fig, 103, le montre claie
renient.
, Du Contre-point double à la quinte & à là
douzième.
Tout comme dans le contre-point double à la'
tierce & à la dixième, on ne doit pas confondre
la tierce & la dixième, fon oéiave, de même ici
il ne faut pas Confondre la quinte & la dou-
'zïèmeF ‘ s ■
Nous ne parlerons ' du Contre-point double à la
quinte que par rapport à la tranfpofition : le contrepoint
avec renverfement à la quinte eft trèss-borrié;
d’ailleurs il fe fonde fur les mêmes règles que
lé contre - point double avec renverfement à la
douzième.
Ce qu’on a.dit des différentes façons de faire la
tranfpofition dans le contre-point avec tranfpofition
à la tierce, a auffi lieu dans celui avec tranfpofitioii
à la quinte.
Du Contre-point double , avec tranfpofition à 14
quinte entre deux parties qui / écartent.
Pour favoir ce que devient chaque intervalle 9
ajoutez 4 au nombre qui l’exprime ; ainfi ,
l’uniffon I , la 1«, |a 3?, la .4e , la j 5 , la 6e.
4 4 4 4 4 4-
donne la 5', la 6e, la 7e, hTiF, liTgS la 10'.
‘ Nous n’allons pas plus loin ic i, parée que deux
parties ne peuvent s’écarter que-d’une dixième.
Première règle. La fécondé, préparée régulièrement,
peut fe fauver. fur la fixte ; alors elle devient
une fixte qui ja ffe à la dixième ou à l ’oéfeve de
la tierce. Vo y e z plane, de mufiq. \ fig. toç. ta
fécondé peut encore fe fauver fur ta tierce j
pourvu que celle-ci foit fauvée régulièrement,
comme nous allons le dire, Voyez plane, de mufiq,
fis •
C O N
JDeux'ième règle. La tierce doit toujours être préparée.,
foit dans l’une, foit dans l’autre partie ; elle
peut palier à la fixte ; alors elle devient feptième
fauvée fur la tierce. Voyez la fécondé 6c troifième J
mefure de la fig. 106„ plane, de mufiq. La tierce peut
encore devenir fécondé comme fig. 10 7, ce qui
n’eft bon qu’avec au moins une partie de plus;
enfin , à la fin d’une période on pourroit faire gaffer
la tierce à Funiffon, comme/f. 108.
Troifième règle. La quarte, préparée dans le deffus
, peut fe fauver fur la tierce : elle peut encore
le fauver fur la fixte ; & fuivant le cas , elle
peut être préparée^ indifféremment dans les deux
parties. Voyez plane, de mufiq. fig. 109.
Quatrième règle. La quinte , toujours préparée
dans. le deffus , peut gaffer à la quarte pu à la
fixte. Vo yez fig. 110. On pourroit encore paffer de
la quinte à Funiffon ; mais cela n’eft tolérable qu’à
la fin d’ une période. Vo y e z fig. 111.
Remarquez qu’on peut fouvent employer cette
efpèce de contre-point à caufe que la fixte devient
tierce par la tranfpofition : tout chant par fixte
G O N 36*
peut être écarté d’une quinte. Remarquez encote
que puifque la fixte refte feule confonnante après
la tranfpofition, elle eft ,auffi la feulé qui puiffe
fervir à préparer & à fauver finalement les dif-
fonances.
Du Contre-point double, avec tranfpofition à la quinte
entre deux parties qui s*écartent & qui font accompagnées
d’autres parties de remplijfage.
Si Fon ne-veut pas féparer les deux parties qui
forment le contre-point double par une partie d@
rempliffage , on obferyera toutes les règles ci-
deffus, hors que la quarte peut ici être employée
comme confonuance, & qu’on n’en peut jamais
mettre deux de fuite, parce qu’elles deviennent
oétaves après la tranfpofition. Vo yez un exemple
de la quarte confonnante , plane, de mufiq. fig,
! 1:2.
Si Fon veut inférër une ou plufieurs parties
entre celles qui forment le contre-point double,
alors il faut d’abord examiner ce que deviennent
la feptième, l’odaye ôj. la neuvième pa* la tranf^
pofition,
La 7e ; la 8e* la 9e:
4 • 4 ' g j g g g
devient 11e ou quarte , 12e ou quinte, 13e ou fixte»
D ’où réfultent les règles fuivantes.
Première règle. La feptième, préparée dans le deffus
, ne peut fe fauver que fur Va fixte , & elie devient
quarte diffonante, fauvée fur la tierce. Voyez
plane, de mufiq. , fig. 113,
Remarquez que puifque Foéîave devient quinte
& refte par conféquent confonnance , on peut s’en
fervir comme telle , & qu’ainfi on peut fubftituer
,1’odave à Funiffon dans les .derniers exemples des
règles deux & quatre ; alors on pourroit pratiquer
ces exemples, comme fig. 114 , n°s. 1 & 2.
Deuxième règle. La neuvième, préparée régulièrement,
peut fe fauver fur I’oâave : elle devient une
fixte diffonante, & fauvée fur la quinte : on peut
encore la fauver fur la fixte , alors elle devient
une fixte qui paffe à la tierce. Voyez plane. de
tâte 115 j n*‘. 1 & 2.
Du Contre-point double, avec tranfpofition à la quinte
entre deux parties qui fe rapprochent.
Tout comme le contre-point double avec tranfpofition
à la tierce entre deux parties qui fe rapprochent,
eft préeifément le contraire de celui ow
les parties s’écartent; de même le contre-point double
avec tranfpofition à la quinte entre deux parties
qui fe rapprochent, eft préeifément le contraire
de celui où les parties s’écartent ; & Fon
n’a qu’à renverfer les règles & les exemples précé-
dens, pour trouver les règles*& les exemples du
contre-point double avec tranfpofition à la quinte
entre deux parties qui fe rapprochent.
Du Contre-point double , avec renverfement à la douzième
entre deux parties.
Pour favoir ce que deviennent les intervalles par
le renverfement, retranchez de 13 le nombre qui
exprime chaque intervalle : ainfi,
Funiffon 1 ,
donne la 12e ou quinte,.
35
la 2e,
la 11e ou quarte la 10e ou tierce;
HÉ» i r a
la 4e , la , s » ,
ï 3
la 6e , l1aÏ 3j e .
• *3
» ta'. 8e ,
13 13
la 9S, la io (
Ja \î 8e , la ye,, la 6e :. la 5e . ta’ 4e > ta 3 e»