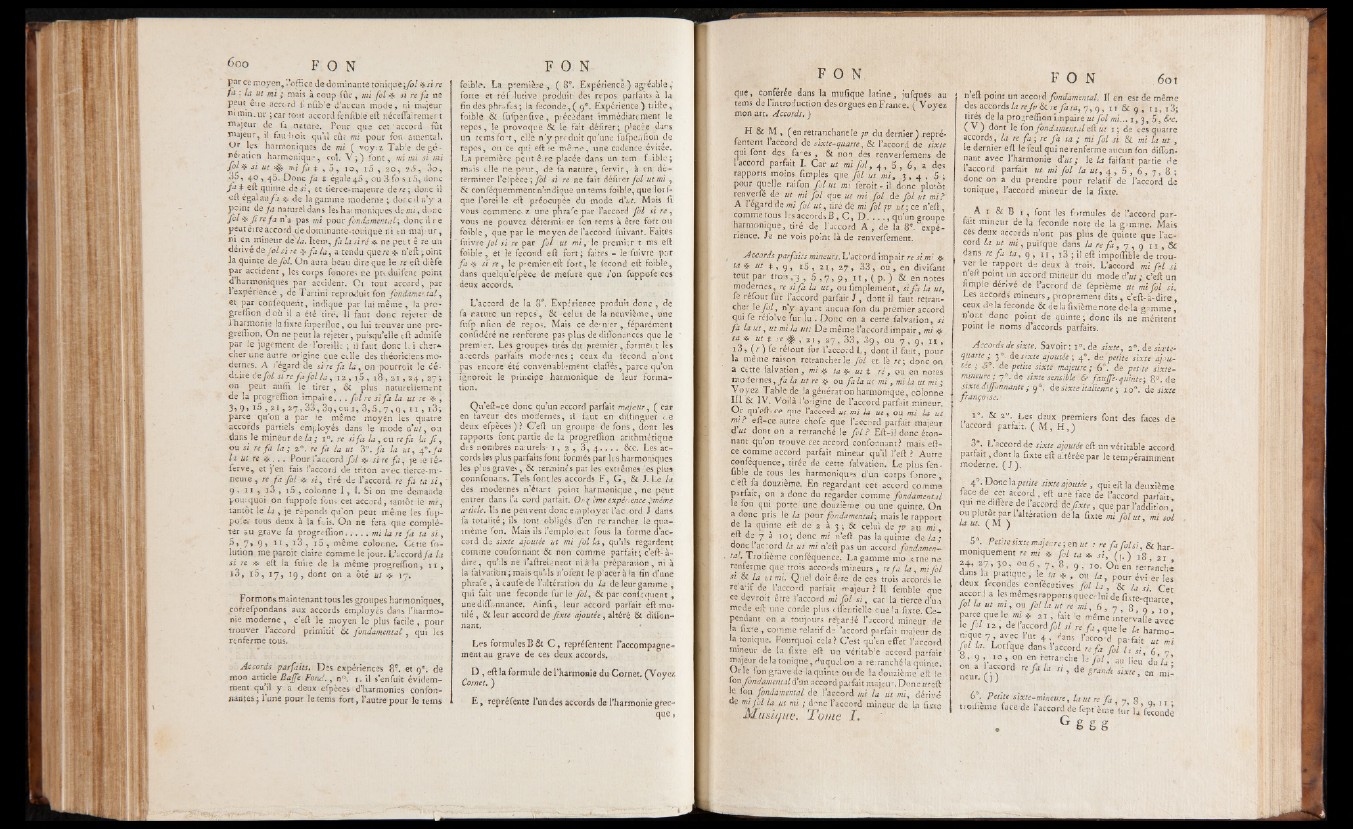
6oo F O N
par ce moyen, î’office de dominante tonique\fol #si re
fa : la ut mi ; mais à coup fûr , mi fol # si re fa ne
peut eue accord finfib’e d’aucun mode, ni majeur
nimin.ur ;car tout accord fenfibië eft néceffairemert
majeur de fa nature. Pour que ce t’ accord fût
majeur, il fau-ûoit qu’il eut mi pour fon- amental.
Dr l?s harmoniques de mi ( voy-.z Table de g é nération
harmonique, col. V ; ) font, mi mi si mi
fo l # si ut >$Sï mi f i $ , 5 , i o , 15 , 20 , 2.5 , 3o ,
4° î .4&- Donc fa £ égale^â , ou 3 f o s j 5, donc
f a t eft quinte de j-i, et tierce-majeure de re ; donc il
eft égal au fa # de la gamme moderne ; dor.c il n’y a
point de fa naturel dans leshaimoniques demi, donc
fo l # f i re fa n’a pas mi pour fondamental ; donc il re
peut erre accord de dominante-tonique ni tn maj . ur,
ni en mineur de la. Item, fa la si ré # ne peut ê re un
dérivé de fol si re # fa la, a tendu que re # n’eft j. oint
la quinte de fol. On aura beau dire que le re eft dièfe
par accident, les corps fonores ne prcduifenr point
d harmoniques par accident. Oi tout accord, par
1 expenence , de Tartini reproduit fon fondamental,
et par conséquent, indique par lui même , la pre-
greffion doit il a été tiré. Il faut donc rejeter de
1 harmonie la fixre fuperflue, ou lui trouver une prc-
greffion. On ne peut la rejeter, puisqu’elle eft admife
par le jugement çle ' l’oreille ; il faut donc h i cher-6-
cner une autre origine que celle des théoriciens modernes.
A ;’égard de sire fa la , on pourroit le cé-
dnire de fo l si re f i fol la , 12 , i 5 , 18 , a i , 24,27 ;
on peut aùffi le tirer , & plus naturellement
de la progreffion impaire. . . fo l re si fa la ut re # ,
3 ,9, i 5 , 2 1 , 2 7 , 33, 3 9 ,o u j, 3, 5 , 7 , 9 , 1 1 , i 3;
parce qu’on a par ie même moyen les quatre
accords partiels employés dans le mode aW , ou
dans le mineur de la ; i° . re si fa la , eu refa là f i ,
ou si re fa la ; 20. re f i la ut 3°. fa la ut, 4 f a
la ut re # . . . Pour l’accord fol # si re f a , je ie ré-
ler ve, et j’en fais l’accord de triton avec tierce-nv-
neuie, re .fa fol # s i, t-ré de l’accord re fa ta s i ,
9 , 1 1 , i 3 , i 5 , colonne I , I. Si on me demande
pourquoi on fuppofe fous cet accord, tantôt le mi,
tantôt le la , je réponds qu’on peut même les fup-
poie» tous deux a la fois. On ne fera que compléter
au grave fa progreffion ; . . . . mi la re fa ta s i ,
5 , 7, 9, i l , i 3 , i 5 , même colonne. Cette fo-
lution me paroit claire comme le jour. L’accord/à la
si re # eft la fuite de la même progreffion, 1 1 ,
i 3 , i 5 , 1 7 , 19 , dont on a ôté ut # 17.
Formons maintenant tous les groupes harmoniques,
correfpondans aux accords employés dans l’harmonie
moderne, c’eft le moyen le plus facile , pour
trouver 1 accord primitif ÔC fondamental, qui les
renferme tous.
Accords parfaits. Des expériences 8e. et 9e. de
mon article Baffe Fond. , n°. 1. il s’enfuit évidemment
qu il y a deux efpèces d’harmonies confondante5
• l’une pour letems fort, l’autre pour le tems
F O N
foible. La première, ( 8°. Expérience ) agréable
forte et réDlutive produit des repos parfaits à la
fin des phriifts ; la fécondé , ( 9e. Expérience ) trifte,
foible & fufpsnfive, précédant immédiatement le
repos, le provoqué & le fait défirer; placée dans
un temsfo 't , elle n’y produit qu’une fufperifion de
repos, ou ce qui eft ie même, une cadence évitée.
La première peut ê.re placée dans un tem faible;
mais elle ne.peut, de fa nature, fervir, à en déterminer
l’efpèce ; foi si re ne fait défirer fol ut mi,
& conféquemment n’indique un tems foible, que dorique
l’oreiUe eft préocupée du mode d’/<r. Mais fi
vous commence une pnra'e par l’accord fol si re,
vous ne pouvez déterminer fou rems à être foft ou
foible, que par le moyen de l’accord fuivant. Faites
fuivre fol si re par fo l ut mi, le premier t ms eft
foible, et le fécond eft fort; faites - le fuivre par
fa # si re, le premier eft fort, le fécond eft foible,
dans queiqu’efpèce de mefure que l’on fuppofe ces
-deux accords.
L’accord de la ,8e. Expérience produit donc , de
fa nature un repos, & celui de la neuvième, une
fufp.nfion de .repos. Mais ce dernier, féparément
confidéré ne renferme pas plus de diiTonances que le
prem’:er. Les groupes tirés du premier, formet.t lès
accords parfaits modernes ; ceux du fécond n’ont
pas encore été convenablement claffés, parce qu’on
ignoroit le principe harmonique de leur formation.
Qu’eft-ce donc qu’un accord parfait majeur, ( car
en faveur des modernes, il faut en distinguer de
deux efpèces) ? C ’eft tin groupe de fons, dont les
rapports font partie de la progreffion arithmétique
des nombres naturels- 1 , 2 , 3 , 4 . . . . &c. Les accords
les plus parfaits font formés par les harmoniques
les plus graves, & terminés par les extrêmes ’.es plus
connfonans. Tels fontles accords F , G , & J. Le la
des modernes n’étart point harmonique, ne peut
entrer dans l’a cord parfait. Or ^'eme expérience fmêtr.e
article. Ils ne peuvent donc employer l’ac .ord J dans
fa totalité; ils font obligés d’en re rancher le quatrième
fon. Mais ils l’emploient fous la forme d’accord
de sixte ajoutée ut mi fo l ia , qu’ils regardent
comme conformant & non comme parfait; c’eft-à-
dire, qu;!s ne l’aftreunent ni à la préparation, ni à
la falvati'on ; mais qu’ils notent le p'acer à la fin d’une
phrafe , àcaufede l’altération du la de leur gamme ,
qui fait une fécondé fur lé fo l, & par conféquent,
une difïonnance. Ainfi, leur accord parfait eft mutilé
, & leur accord de fixte ajoutée, altéré Si diffon-
nant. '
Les formules B & C , repréfentent l’accompagnement
au grave de ces deux accords.
D , eft la formule de l’harmonie du Cornet. (V oyez
Cornet. )
E , repréfente l’un des accords de l’harmonie grecque,
F O N
que, conférée dans la mufique latine, jufques au {
tems de l’introduction des orgues en France. ( Voyez
mon arr. Accords. )
H & M , (en retranchant le jp du dernier ) repréfentent
1 accord de sixte-quarte, & l’accord de sixte
qui font des fares , & non des renverfemens de
l’accord parfait I. Car ut mi fo l, ^ , 5 , 6, a des
rapports moins fimples que fol ut mi, 3 , 4 , 5 ;
pour quelle raifon fo l ut mi feroit-il donc plutôt
renverfé de ut mi fol que ut mi fo l de fol ut mi?
A 1 égard de mi fo l ut, tiré de mi fo l jv ut ; ce n’eft,
comme tous les accords B , C , D . . . . , qu’un groupe
harmonique, tiré de l’accord A , de la 8e. expérience.
Je ne vois point là de renverfement.
Accords parfaits mineurs. L’accord impair re sijni #
ta# ut t , 9 , i 5 , 21 , 2 7 , 33, ou , en divifant
tout par trois ,-^3', 5 , 7 , 9 , 1 1 , ( p. ) & en notes
modernes, re si fa la ut, ou fimplement, si fa la ut,
fë réfout fur l’accord parfait J , dont il faut retrancher
\efol, n’y ayant aucun fon du premier accord
qui fe réfolve fur lu'. Donc on a cette falvation, si
fa la ut, ut mi la ut: De même l’accord impair, mi #
ta # ut t re , 2 1 , 27 , 3 3, 39 , ou 7 , 9, n ,
ï 3s (r ) fe rélout fur l’accord L , dont il faut, pour
la même raison retrancher le fo l et je re; donc on
a cette falvation, mi # ta # ut £ ré, ou en notes
modernes, fa la ut re # ou fa la ut mi , mi la ut mi ^
Voyez Table de la génération harmonique, colonne
III & IV. Voilà l’origine de l’accord parfait mineur.
Or qu eft- ce que l’accord ut mi la u t , ou mi la ut
mi ? eft-ce autre chofe que l’accord parfait majeur
d'ut dont on a retranché le fol ? Eft-il donc étonnant
qu’on trouve cet accord conformant? mais eft-
ce comme accord parfait mineur qu’il l’eft ? Autre
conféquence, tirée de cette falvation. Le plus fen-
fible de tous les harmoniques d'un corps fonore,
c eft fa douzième. En regardant cet accord comme
parfait, on a donc du regarder comme fondamental
le fon qui porte une douzième ou une quinte. On
a donc pris le la pour fondamental; mais le rapport
de la quinte eft de 2 à 3 ; & celui de jv au ma ,
eft de 7 à 10; donc mi n’eft pas la quinte de la;
donc l’acrord la ut mi n’eft pas un accord fondamen--
. ta1. TroTième conféquence; La gamme mo Itrne ne
renferme que'trois accords mineurs , refa la , mi fol
si St. la ut mi. Quel doit être de ces trois accords le
re’a-if de l’accord parfait majeur? Il femble que
ce dçvroit erre l’accord mi fol si, car la tierce d’un
mode eft une corde plus tlfentielle eue la fixte. Cependant
on a toujours regardé l’accord mineur de
la fixte , comme relatif de ’accord parfait majeur de
la tonique. Pourquoi cela? C’est qu’en effet l’accord
mineur de la fixte eft un véritable accord parfait
majeur de la tonique, duquel on a re:ranché la quinte.
Or le fon grave de la quint-; ou de la douzième eft le >
ion fondamental d’un accord parfait majeur. Donc wreft
le fon fondamental de l’accord mi la ut mi, dérivé
dç rnifql la ut mi ; donc l’accord mineur de la fixre
Mus It/ne. Tome I.
F O N 601
n eft point un accord fondamental. II en est de même
des accords la re Jv St re fa ta, 7 , g , 1 1 & 9 , 11, t 3;
tires de la progreffion impaire ut fo l mi... 1 , 3 , 5 , &c.
( V ) dont le fon fondamental eft. ut 1 ; de ces quatre
accords , la re fa ; re fa ta ; mi fol si St mi la ut ,
le dernier eft le feul qui ne renferme aucun fon diffon-
nant avec l’harmonie d'ut ; le la fai faut partie de
l’accord parfait ut mi fol la ut, 4 , 5 , 6 , 7 , 8 ;
donc on a du prendre pour relatif de l’accord de
tonique, l’accord mineur de la fixte.
A i & B î , font les formules de l’accord parfait
mineur de la fécondé note de la g;m:ne. Mais
ces deux accords n’ont pas plus de quinte que l’accord
la ut mi, puifque dans la re f a , 7 , 9 11 , &
dans re fa ta, 9 , 1 1 , i 3 ; il eft impoffible de trou-
ver le rapport de deux à trois L’accor-d mi fo l si
n’eft point un accord mineur du mode à1 ut; c’eft un
fimple dérivé de l’accord de feptième ut mi fol si.
Les accords mineurs, proprement dits, c’eft-à-dire ,
ceux delà fécondé & delà fixièmenote de là gnmme,
nont donc point de quinte; donc ils. ne méritent
point le noms d’accords parfaits.
Accords de sixte. Savoir: i° . de sixte, 2°. de sixte-
quarte ; 30. de sixte ajoutée ; 40. de petite sixte ajoutée
; 5 °. de petite sixte majeure ; 6°. de petite sixte-
mineure ; 70. de sixte sensible & faujfe- quinte ; 8°. de
sixte dijfunnante ; f . de sixte italienne ; io°. de sixte
fançoise. ■
i° . & 20. Les d^ux premiers font des faces de
1 accord parfait. ( M , H , )
3°. L’accord de sixte ajoutée eft un véritable accord
parfait, dont la fixte eft altérée par le tempéramment
moderne. (J).
40. Donc\apetite sixte ajoutée , qui eft la deuxième
face de cet accord , eft une face de l’accord parfait,
qui ne diffère de l’accord d e fixte , que par l’addition ,
ou plutôt pari alteration delà fixte mi fo l ut, mi toi
la ut. ( M ) 1
5°. Petite sixte majeure ; en ut : re fafols i, & harmoniquement
re mi * fol ta * si, ( , . ) 18 2T
2+, 27. 3° . ou 6 , 7 , 8 , 9 , 10. On en retranché
t " 5 la, P,atT e ’ * , °» U , pour évi et les
, deux fécondes çonfecutives fo l la , & la si Cet
accord a les mêmesrapponsquecelui de fixte-qûarte
JoL la ut mi, ou fo l la ut re mi, 6 , 7 8 o ’
parce que le mi-* a i , fait >e même injerv’alle’ aveô
le fol 12 , de I accord fol si re f a , que le U harmo-
nique 7 , avec lut 4 Hans l’acco d pa-fkit „ ° ;
fo l la. Lorfque dans l’accord re fa fo l U si 6
8 , 9 , 10 , on en retranche U fo l , au lieu’ du’^ -
on a X accord refa la s1 , de grande sixte, en mil
neur. ( j \ * 1Xil
6°. Petite sixte-mineure, la ut refa 7 8 Q 1T .
ti odième face de l’accord de fepr ème lut la’ fecondè