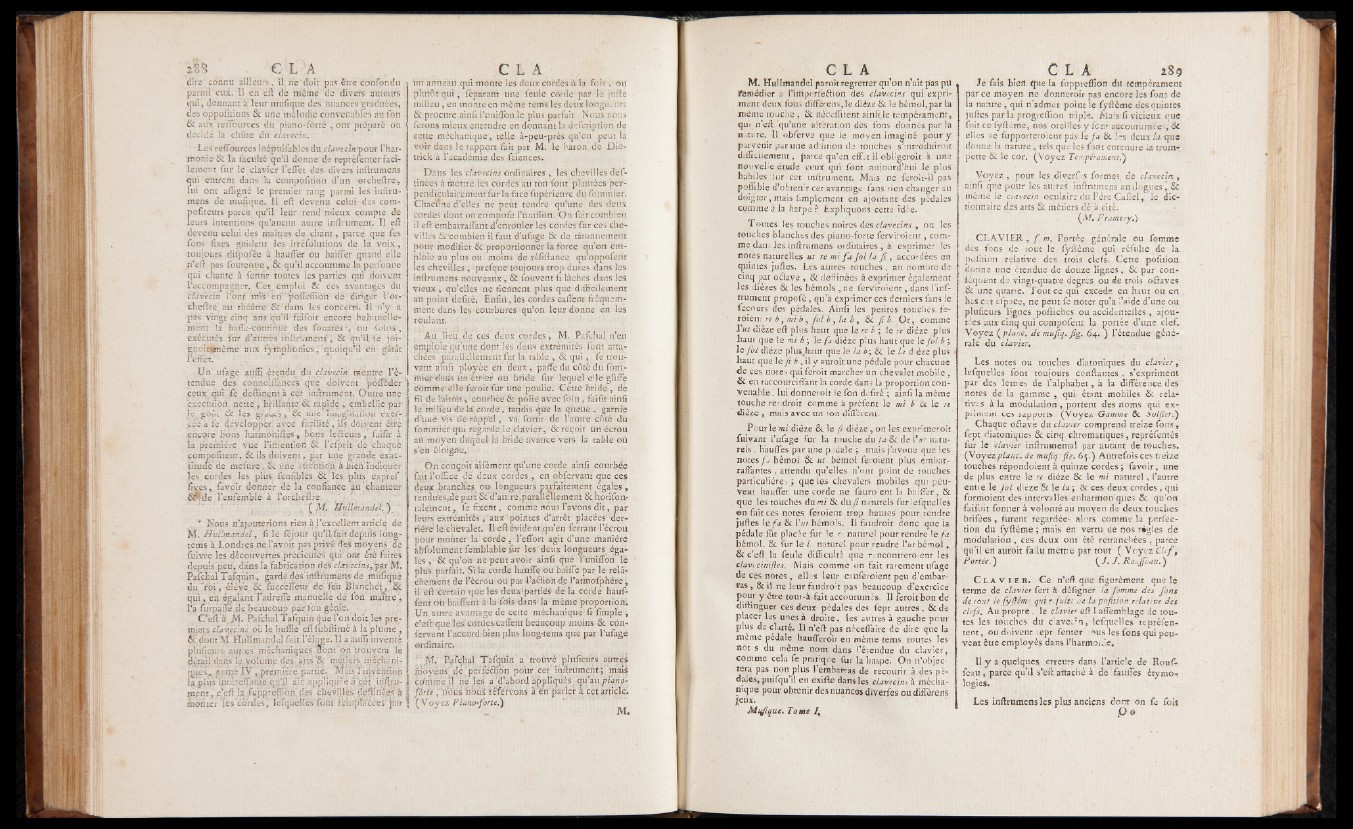
2.SS . CL'A
dire' connu ailleurs, il rie doit pas être confondu
parmi eux. Il en eft de m'ême de divers auteurs
qui, donnant à leur mufique des nuances graduées,
des oppofitions & une mélodie convenables au fon
& aux reiTources du piano-fôrté , ont préparé ou
décidé la chûte dri‘ clavecin.
Les reffources inépttifables du clavecin\>om l’harmonie
& la faculté qu’il donne de représenter facilement
fur lé clavier' l’effet des divers inftrumens
qui entrent dans la comprifitirin d’un orcheftre,
lui ont affigné le premier rang parmi les inftru-
mens de murique. Il eft devenu celui des composteurs
parce qu’il leur rend mieux compte de
leurs intentions qu’aucun autre inftrument. Il eft
devenu celui des maîtres de. chant, parce que fes
fons fixes guident les irréfôlutions de la v o ix ,
toujours difpofée à haufler ou baifler quand elle
n’eft pas foutenue , & qu’il accoutume la;perfonne
qui chante à fentir toutes les parties qui doivent
l’accompagner. Cet . emploi & ces avantages du
clavecin l’ont rins' en”*rp OfTeffioiT de diriger l ’or-'
cheftre au théâtre & !dans les concerts. Il n’y a
pas vingt cinq ans* ‘qu’il; fai foi t encore habituelle-
inënt là baffe-continue des fonaiés 'ou • -folos;,
exécutés fur d’àutrès inftrirmens , & qu’il fie jôi-
gnoit^même aux fymphôriies, qüriiqu’ il eh gâtât
l’effet.
Un ufage auffi érendq du clavepin montre l’étendue
des connoiiTance's que doivent poffèder
ceux qui fie deftinènt à cét inftrument. Outre une
execution nette', bnüaqte'6t‘ rapide', embellie pâf
je goût & les graqès, & une imagination éxef-
cée à fie développer, avec facilite , ils doivent êtfç
encore bons hafmpniftès, bons lèçléiirs faifir a
la première vue l’intention & l’efprit de/chaqüè
compofiteur, & ils doivent, par une grande exactitude
de mefùre ,'Bc une. attêriîiqn à bien indiquer
les cordes les plias fenfiblès & les plus èxprefi
fives, fâvoir donner dé la confiance âü ' chanteur
& *d e i’enfemblé à l’orchëftre.
: {M . tëilllmandel*)
Nous n’ajouterions rien à ^’excellent article de
M. Hullmandel, fi le féjour qu’ilfait depuis long-
tems à Londres ne l’avoit pas privé dés moyens'de
fuivre les découvertes, précieufês qui ont été faites
depuis.peu, dans la fabrication des clavecins,par M.
Pafchal Tafquin, garde dés'inftrumeris: de müfiqué
du “roi", élève fuccéfleiir’ dé feu Blânchéi. Î8c
q u i, en égalant.Tadreffè mariuéllè;de ion maître,
l’a furpaffé de beaucoup pârifori géçtië.
C ’ëft’a Jvf. Pafchal Tafqüin que l’on doit,les premiers
clavecins oü le buffle eft fubftitué à la plumé ,
te dont M. Uutlmandel fait l’éloge. Il aàiiffiirivenlé
plufieurs:.autres méchariiqùes Taont on trouvera le
d é c i dons le^olume dès arts*& rnetierS. medfrani-
(nipt* fô.fn,ê X V , .première partie. MaisTInÿènnoh
la plus uttejreffarite qp’il ait? appliquée a cet irîftru-
ropnt, c e ft la funpreffiori' des chevilles,deftîneés a
monter les'cordes', léfquéHes font remplacées' par
C L A
un anneau qui monte les deux cordés à la fo is , ou
plutôt q u i, féparant une feule corde par le jtïfte
milieu, en monte en même tems les deux longueurs
& procure ainfi l’unifTon le plus parfait Nous nous
ferons mieux entendre en donnant la defeription de
cette méchanique, telle à-peu-près qu’on peut la
voir dans le rapport fait par M. le baron de Die-
trick à l’académie des fciences.
Dans les clavecins ordinaires , les chevilles def-
tinées à mettre les cordes au ton font.plantées perpendiculairement
fur la face fupérieure du fommier.
Chacune-d’elles ne peut tendre qu’une des deux
cordes dont on compofe l’uniffon. On fait combien
il eft embarrafiant .d’enrouler les cordes fur ces chevilles
& ■ combien il faut d’ufage & de tâtonnement
pour modifier & proportionner la force qu’on emploie
au plus ou moins de réfiftance qu’oppofent
les chevilles , prefque toujours trop dures dans les
inftrumens nouveaux, ôfifoUvent fi lâches dans les
v ieux , qu’elles ne tiennent plus que difficilement
au point defirè, Enfin, lés cordes caftent fréquemment
dans les courbures qu’on leur donne én les
rriiilànt.
Au lieu de ces deux cordes, M. Pafchal n’en
emploie qu’une dont les .deux extrémités font attachées
-parallellement fur la table., 8c q u i, fe trouvant
ainfi ployée en deux§ paffe du côté du fom-
mi-erdfiris un étrier ou bridé fur lequel elle g lifte
cOmine-elle;feroit fur une poulie. Cette bride , de
fil de lauôri -, côufbéé & polie avec foin J fiaifit ainfi
le milieu delà corde’ , taridis que la queue , garnie
d’une vis de Fàpp'ël, va- fortiï de l’autre côté du
fommiér qui regarde fie 'clavier', ’& reçoit un écroù
au moyen duquel la bride avance vers la table oü
s’en éloigne.
On conçoit aifément qu’une corde ainfi courbée
tait l’office dé deux çordes , en ôbfervant que ce$
deux branches ou longueurs parfaitement égales,
tendues,dé part Sfid’aù.re, parallèlement 8c horifon.-
tale'ment, fe fixent, comme nous l’avons d it, par
leufs extrémités , ' aux • pointes d’arrêt placées derrière
le chèvalet. Il eft évident .qu’en ferrant l ’écroii
pour monter la corde , l’effort agit d’une maniéré
âbfolumerit femblable fur les deux longueurs^ égales
, & qu’on ne peut avoir ainfi (|Ué l’uniffori l’é
plus parfait. Si la .cordé haùffe ou baîffe par le relâchement
de l’écrou ou par 1-àéHon de l’atmofphère,
il eft certain 7qilè les deux^partidS dé la corde hauf-
fent Oiv baiffent àdàftois dans- la même proportion^
Un autre avantage de cette méchanique'fi fimplè ;
c’eft que 'les:' cordès-caffeUt beaucoup moins & crin-
fervent l’accord:bien plus long-tems que par l ’ufage
ordinaire;. ■
" M.' rfeafçhaï Tafquîil a trotivé plufièiirs autres
moyens'’d é ’pérféâiô'n pour ,cet inftrument;' mais
comme il né les; à ‘d abord appliqués qu’au pïqrio*
flriè 'l“ nous rioris réservons à ëri parier a'cét .àrpçjéi
( Vo yez Piano-forte.')
c L A
M. Hullmandel paroît regretter qu’on n’ait pas pu
femédier à l’imperfeéHon des clavecins qui expriment
deux fons différens,le dièze & le bémol,par la
même touche , & nécefîitent ainfije tempérament,
qui n’eft qu’une altération des fons donnés par la
nature. Il obferve que le moyen imaginé pour y
parvenir par une addition de touches s’mtroduiroit
difficilement, parce qu’en eft. t il obligeroic à une
nouvel-e étude ceux qui font aujourd’hui le plus
habiles 'lur cet inftrument. Mais ne feroit-il pas
poffible d’obten:r cet avantage fans rien changer au
doigter, mais Simplement en ajoutant des pédales
comme à la harpe ? Expliquons cette idée.
Toutes les touches noires des clavecins , ou les
touches blanches des piano-forte ferviroient, comme
dans les inftrumens ordinaires , à exprimer les
notes naturelles ut re mi fa fo l la f i , accordées en
quintes jnftes. Lés autres touches , au nombre de
cinq par oélave , & detfinées à exprimer également
les dièzes 8c les bémols , ne ferviroient, dans i ’inf-
trument propofé, qu’à exprimer ces derniers fans le
fecours des pédales. Ainfi les petites touches fe-
roiem re b, mi b , fo l b , la b , & f i b. O r , comme
Tut dièze eft plus haut que le re b ; le re dièze plus
haut que le mi b', le /j dièze plus haut que le fo l b ;
le fo l dièze plus, ha ut que le la b; & le la dièze plus
haut que le ÿ? b , il y auroi't une pédale pour chacune
cle ces notes qui feroit marcher un chevalet mobile ,
& en raccourciffant la corde dans la proportion convenable,
lui donneroit le fon defiré ; ainfi la même
touche ren.droiî comme à préfent le mi b <x le re
dièze , mais avec un fon différent.
Pour \e mi dièze 8i\e f i dièze, on lesexprlmeroit
fuiyant l’ufage fur la touche du fa 8c de I«/ naturels
. hàuffés par une pédale ; mais j’avoue que les
notes/é bémol & ut bémol feroient plus embar-
raflantes , attendu qu’elles n’ont point de touches
particulière> ; que les chevalets mobiles qui peuvent
haufler une corde ne fauro ent la baifler, &
que les touches du mi & du f i naturels fur lefquelles
©n fait ces notes feroient trop hautes' pour rendre
juftes le fa 8c l'ut bémols. Il faudroit donc que ia
pédale fut placée fur le r* naturel pour rendre le fa
bémol, & fur le l naturel pour reudre l'ut bémol,
& e’eft la feule difficulté que rencontrero ent les
clavtcinifles. Mais comme on fait rarement ufage
de ces notes , elles leur cauferoient peu d’embarras
, & il ne leur fàudrori pas beaucoup d’exercice
pour y ctre tout-à fait accoutumés. Il leroit bon de
diftinguer ces deux pédales des fept autres, & de
placer les unes à droite, les autres à gauche pour
plus de clamé. Il n’eft pas néceffaire de dire que la
meme pédale haufferoit en même tems toutes les
nous du même nom dans l’étendue du clavier ,
comme cela fe pratique fur la ha&pe. On n’objectera
pas non plus rembarras de recourir à des pédales,
puifqu’il en exifte dans les clavecins à mécha- ]
nique pour obtenir des nuances diverses ou différens
j(eùx.
Miffique. Tome /.
C L A 289
Je fais bien que la fuppreflîon dil tempérament
par ce moyen ne donneroit pas encore les fons de
la namre, qui n’admet point le fyftême des quintes
juftes par la progreflion triple. Mais fi vicieux que
foit ce fyftême, nos oreilles y fenr accoutumées, 8c
elles ne fupporteroient pa's le fa 8c >s deux la que
donne la nature, tels que les font entendre ia trompette
& le cor. (Voyez Tempérament.)
Voyez , pour les. diverf-s formes de clavecin
ainfi que pour les au:reS inftrumens analogues \ &
même le clavecin oculaire du Père Caftel, le dictionnaire
des arts & métiers dé;à cité.
(A/. Framery.)
CLAVIER , fi m. Portée générale ou fomme
des fons de tout le fyftême qui réfulte de la
pofition relative des trois clefs., Cette pofition
donne une étendue de douze lignes, & par con-
léquent de vingt-quatre degrés ou de trois oélaves
8c une quane. Tout ce qui excède en haut ou en
bas cet efpace, ne peut fe noter qu’à l’a «de d’une ou
plufieurs lignes poftiches ou accidentelles , ajoutées
aux cinq qui compofenr la portée d’une clef.
Voyez ( plane. de mufiq. fig. 64. ) l’étendue générale
du clavier.
Les notes ou touches diatoniques du clavier,
lefquelles font toujours confiantes , s’expriment
par des lettres de l’alphabet, à la différence des ’
notes de la gamme , qui étant mobiles & relatives
à la modulation , portent des noms qui expriment
ces rapports (Voyez Gamme 8c Solfier.)
Chaque oélave du clavier comprend treize fons,
fept diatoniques & cinq chromatiques, repréfentés
fur le clavier inftrumental par autant de touches.
(Voyezplane, de mufiq fiç. 65.) Autrefois ces treize
touches répondoient à quinze cordes; favoir, une
de plus entre le r£ dièze & le mi naturel, l’autre
entre le fo l dièze & le la ; 8t ces deux cordes , qui
formoient des intervalles enharmon ques & qu’on
faifoit fonner à volonté au moyen de deux.touclies
brifées , furent regardée*: alors comme la perfection
du fyftême ; mais en vertu de nos régies de
modulation, ces deux ont été retranchées , parce
qu'il en auroit fallu mettre par tout ( Voyez CUf,
Portée.) (J . J. Roufieau.)
C l a v i e r . Ce n’eft que figurément que le
terme de clavier fert à défigner la fomme des fons
de tout le fyftême qui r f uite de la pofition relative des
clefs. Au propre, le clavier eft 1 affemblage de toutes
les touches du c!avev;n, lefquelles repréfente
nt , ou doivent lepr fenter ^us les fons qui peuvent
être employés dans lffiarmoife.
Il y a quelques erreurs dans l’article de Roufi»
feau, parce qu’il s’eft attaché à de faufles étymo*
logies.
Les inftrumens les plus anciens dont on fe foit
P o