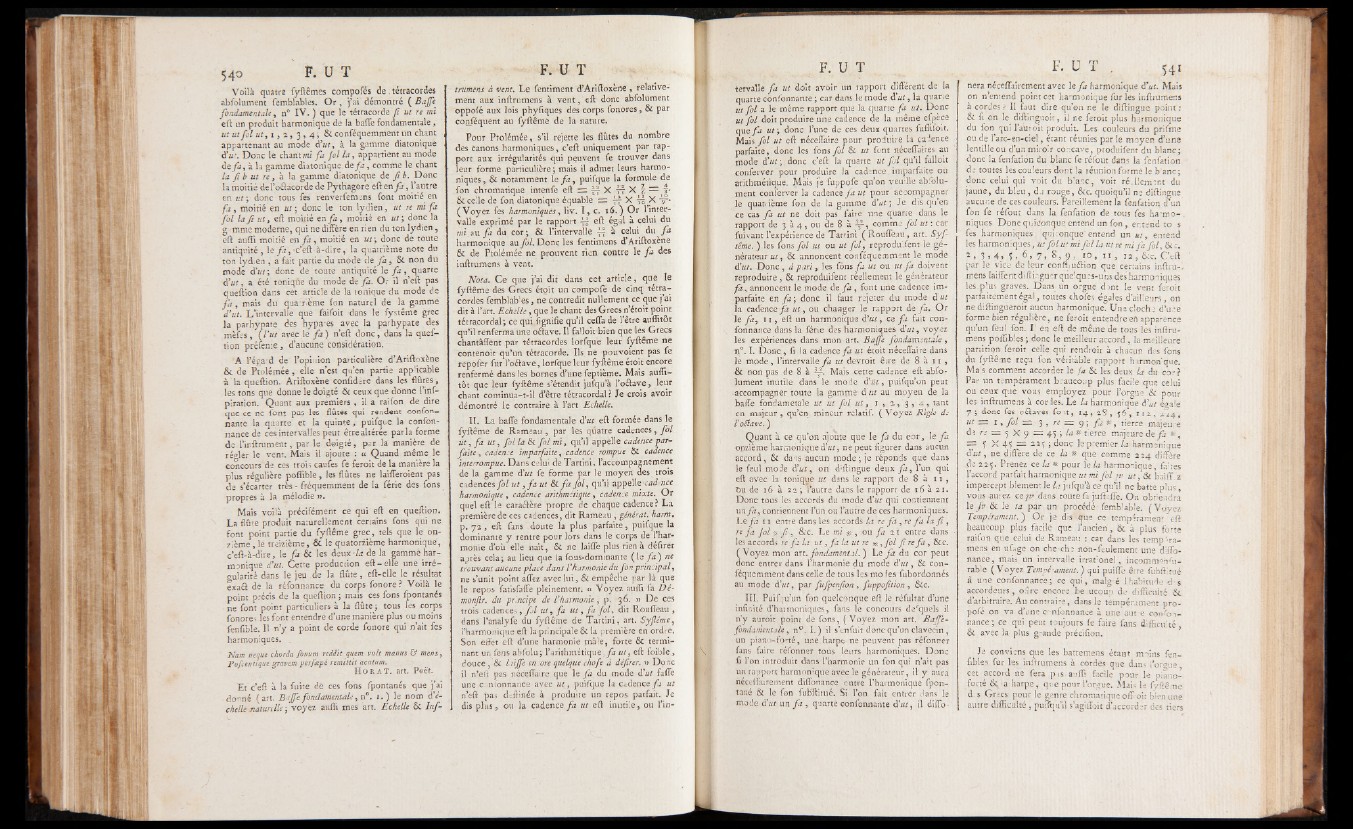
V oilà quatre fyftêmes compofés d e . tétracordes j
ablolument femblables. O r , fa i démontré ( Baffe \
fondamentale, n° IV . ) que le tétracorde f i ut re mi \
eft un produit harmonique de la baffe fondamentale,
ut ut fol ut, i j 2 , 3 , 4 ; & conféquemment un chant ,
appartenant au mode d’ut, à la gamme diatonique ,
d'ut. Donc le chant mi fa f i l la , appartient au mode
de fa , à la gamme diatonique de f a , comme le chant
la f i b ut re , à la gamme diatonique de f i b. Donc
la moitié del’oftacorde de Pythagore eft en fa , l’autre
en u f, donc tous fes renverfemens font moitié en
fa , moitié en ut ; donc le ton lyd ien , ut re mi fa
fo l la f i ut, eft moitié en f a , moitié en ut; donc la
g itnme moderne, qui ne diffère en rien du ton lyd ien ,
eft aufli moitié en f a , moitié en ut ; donc de toute
antiquité, le fa , c eft-à -d ire, la quatrième note du
ton lydien , a fait partie du mode de fa , & non du
mode d*ut ; donc de toute antiquité le fa , quarte
d'u t, a été tonique du mode de fa. O r il n’eft pas
queftion dans cet article de la tonique du mode de
f a , mais du quarrième fon naturel de la gamme
d’ ut. L ’intervalle que faifoit dans le fystême grec
la parhypate des hypa^es avec la parhypate des
m èfes, ( fu t avec.le fa ) n’eft d o n c , dans la queftion
préfente , d’aucune considération.
A l’égard de l’opinion particulière d’Ariftoxène
& de Ptolémé e, elle n’est qu’en- partie applicable
à la queftion. Ariftoxène confidere dans les flûtes,
les tons que donne le doigté & ceux que donne l’inf-
piration. Quant aux premiers , il a raifon de dire
que ce ne font pas les flûtes qui rendent confonnante
la quarte et la quin te , puifque la confon-
nance de ces intervalles peut être altérée parla forme
de l’inftrument, par le d o ig té , par la manière de
régler le vent. Mais il ajoute : a Quand même le
concours de ces trois caufes fe feroit de la manière la
plus régulière poflib le, les flûtes ne laifferoient pas
de s’écarter très - fréquemment de la férié des fons
propres à la mélodie ».
Mais voilà précifément ce qui eft en queftion.
La flûte produit naturellement certains fons qui ne
font point partie du fyftême g rec , tels que le onzièm
e , le treizième, & le quatorzième harmonique,
c’eft-à-dire, le fa & les deux -la de la gammé harmonique
(Tut. Cette production e f t - e lle une irrégularité
dans le jeu de la flû te , eft-elle le résultat
exaéf de la réfonnance du corps fonore ? V o ilà le
point précis de la queftion ; mais ces fons fpontanés
ne font point particuliers à la flûte ; tous les corps
fonores les font entendre d’une manière plus ou moins
fenfible. Il n’y a point de corde fonore qui n’ait fes
harmoniques. .
Nam neque chorda fonum reddit quem vult manns & mens,
P o Ce en tique eravejn perfeepé remittit acutum.
Ho r a t . art. Poè't.
E t c eft à la fuite dé ces fons fpontanés que j’ai
donné (art. Baffe fondamentale, n°. i . ) le nom d’é-
chelle .naturelle ; v o y e z aufli mes art. Echelle & Jnftrumens
à vent. L e fentiment d’Ariftbxène , relativement
aux inftrumens à v e n t , eft donc abfolument
oppofé aux lois phyftques des corps fonores, & par
conséquent au fyftêmè de la nature.
Pour Ptolémée, s’il rejette les flûtes du nombre
des Canons harmoniques, c’eft uniquement par rapport
aux irrégularités qui peuvent fe trouver dans
leur forme particulière; mais il admet leurs harmoniques
, & notamment le f a , puifque la formule de
fon chromatique intenfe eft := f7 X î r X « = ?
& celle de fon diatonique équable = 77 X -H X
(V o y e z fes harmoniques, liv. I , c. 16. ) O r l’intervalle
exprimé par le rapport eft égal à celui du
mi.au fa du co r ; & l’intervalle 77 à celui du fa
harmonique au f il. Donc les fentimens d’Ariftoxehe
& de Ptolémée ne prouvent rien contre le fa des
inftrumens à vent.
Nota. C e que j’ai dit dans cet article, que le
fyftême des Grecs étoit un compofé de cinq tetra-
cordes femblab’e s , ne contredit nullement ce que j’ai
dit à l’art. Echelle, que le chant des Grecs n’étoit point
tétracordal; ce qui lignifie qu’il ceffade l’être auflitot
qu’ il renferma une oftave. Il falloit bien que les Grecs
chantâffent par tétracordes lorfque leur fyftême ne
contenoit qu’un tétracorde. Ils ne pouvoient pas fe
rèpofer fur l’oélave, lorfque leur fyftême étoit encore
renfermé dans les bornes d’une feptième. Mais aufli-
tôt que leur fyftême s’étendit jufqu’à l’o é la v e , leur
chant continua-t-il d’être tétracordal ? Je crois avoir
démontré le contraire à l’art Echelle.
II. La baffe fondamentale d'ut eft formée dans le
fyftême de Rameau , par les quatre cadences, fol
ut, fa ut, fol la h fo l mi, qu’il appelle cadence parfaite
, caden:e imparfaitey cadence rompue & cadence
interrompue. D ans celui de T artini, l’accompagnement
de la gamme d'ut fe forme par le moyen des trois
cadences fol u t , fa ut & fa fo l, qu’ii appelle'cadmee
harmonique, cadence arithmétique, cadence mixte. O r
quel eft le caraélère propre cle chaque cadence? L a
première de ces cadences, dit Rameau , générât, harm.
p. 7 2 , eft fans doute la plus parfaite, puifque la
dominante y rentre pour lors dans le corps de l’harmonie
d’oii elle naît, & ne laiffe plus rien à défirer
après cela; au lieu que la fous-dominante (1 e fa ) ne
trouvant aucune place dans l’harmonie du fon principal,
ne s’unit point affez avec lu i, & empêche par là que
le repos fatisfaffe pleinement: « V o y e z aufli fa Dé-
monfir. du principe de l ’harmonie, p. 36. » D e ces
trois cadences , f i l ut, fa u t, fa fo l, dit Rouffeau ,
dans l’ analyfe du fyftême de T a r tin i, art. Syflême,
l’harmonique eft la-principale & la première en ordre.
Son effet eft d’une harmonie mâle, forte & terminant
un fens abfolu; l’arithmétique, fa ut, eft foible,
douce, & l.tiffe en :ore quelque chofe à défirer. v Donc
il n’eft pas néceffaire que lé fa du mode d’ut faffe
une conionnance avec ut, puifque la cadence f i ut
n’eft pas dsflinée à produire un repos parfait. Je
dis p lu s , ou la cadence fa ut eft inutile, ou l’iniervalle
fa ut doit avoir un rapport différent de la
quarte confonnante ; car dans le mode d’ut, la quarte
ut fo l a le même rapport que la quarte fa ut. Donc
ut fol doit produire une cadence de la même efpèce
que fa ut; donc l’une de ces deux quartes fuffifoit.
Mais fol ut eft néceffaire pour produire la cadence
parfaite, donc les fons fol & ut font néceffaires au
mode d’ut ;. donc c’eft la quarte ut f i l qu’il falloit
conferver pour produire la cadence , imparfaite où
arithmétique. Mais je fuppofe qu’on veuille abfolument
conferver la cadence fa ut pour accompagner
le quatrième fon de la gamme d’ut ; Je dis qu’en
ce cas fa ut ne doit pas faire une quarte dans le
rapport de 3 à 4 . ou de 8 à comme fol ut : car
fuivant l’expérience de Tartini (R o u ffe a u , art. Syf-
tême.') les fons fo l ut ou ut fo l, reprodu.fent le générateur
ut, & annoncent conféquemment le mode
déut. D o n c , à pari, les fôns fa ut ou ut fa doivent
reproduire, & reproduifenr réellement le générateur
fa , annoncent le mode de fa , font une cadence imparfaite
en fa ; donc il faut rejeter du mode d'ut
la cadence fa ut/9 ou changer le rapport de fa. O r
le fa , 1 1 , eft un harmonique d’ut, ce fa fait con-
fonnaoce dans la férié des harmoniques dé ut, voyez
les expériences dans mon art. Baffe fondamentale,
n°. I. D o n c , fi la cadence fa ut étoit néceffaire dans
le mode , l’in te rv a lle^ ut devroit être de 8 à n ,
& non pas de 8 à 2^. Mais ce tte cadence eft àbfo-
lument inutile dans le mode d’izt , puifqu’on peut
•accompagner toute la gamme d ut au moyen de la
baffe fondametale ut ut fol u t, 1 , 2 , ' 3 , 4 , tant
en majeur, qu’en mineur relatif. ( V o y e z Règle de
l’oClave. )
Quant à ce qu’on ajoute que le fa du c o r , le fa
onzième harmonique d’ut, ne peut figurer dans aucun
accord , & dans aucun mode ; je réponds que dans
le feul mode d’ut, on d'ftingue deux f a , l’un qui
eft avec la tonique ut dans le rapport de 8 à 1 1 ,
Ou de 16 à 22 ; l ’autre dans le rapport de 16 à 21.
Donc tous les accords du mode d’ut qui contiennent
un fa , contiennent l’un ou l’autre de ces harmoniques.
L e fa 11 entre dans les accords la re fa ,re fa la f i ,
re fa f i l n f i & c . Le mi , /ou fa 21 entre dans
les accords re fa la ut, fa la ut re x , f o l fi re fa , & c .
(V o y e z mon an. fondamental.) Le fa du cor peut
donc entrer dans l’harmonie du mode d’u t, & conféquemment
dans celle de tous les m o des fubordonnés
au mode d’ut, par fufpenfion , fuppofition , & c .
III. Puifqu’un fon quelconque eft le réfultat d’une
infinité d’haimoniques, fans le concours desquels il
n’y auroit point de fons, (V o y e z mon art. Baffe-
fondamentale, n°. I. ) il s’enfuit donc qu’un clavecin
un piano-forté, une harpe ne peuvent pas réfonner
fans faire réfonner tous leurs harmoniques. Donc
fi l’on introduit dans l’harmonie un fon qui n’ait pas
un rapport harmonique avec le générateur, il y aura
néceffairement diffonance entre l’harmonique fpon-
tané & le fon fubftitué. Si l’on fait entrer dans le
mode d’ut un fa , quarte confonnante d’///, il diffonera
néceffairement avec le fa harmonique d’ut. Mais
on n’entend point cet harmonique fur les inftrumens
à cordes ? Il faut dire qu’on ne le diftingue point :
6 fi on le diftinguoit, il ne feroit plus harmonique
du fon qui l’aüroit produit. Les couleurs du prifme
ou de l’arc-en-ciel, étant réunies par le moyen d’une
lentille ou d’un miroir concave, produifent du blanc;
donc la fenfation du blanc fe réfout dans la fenfation
de toutes les couleurs dont' la réunion forme le b'anc;
donc celui qui voit du blanc , voit réellement du
jaune, du bleu , du rouge, &c. quoiqu’il ne diftingue
aucune de ces couleurs. Pareillement la fenfation d’un
fon fe réfout dans la fenfation de tous fes ha m o - .
niques. Donc quiconque entend un fon , entend to s
fes harmoniques; quiconque"entend un ut, entend
les harmoniques, ut fo l ut mi fo l la ut re mi fa fo l, & c.
3 > 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 . 1 0 , 1 1 , 1 2 , & c . C ’eft
par le vice de leur confttuéHon que certains ir.ftuw
mens Iaiffentdiflinguerquelques-uns des harmoniques
les.plus graves. Dans un orgue d >nt le vent feroit
parfaitement égal, toutes chofes égales d’ailleurs, on
ne diftingueroit aucun harmonique. Une cloche d’une
forme bien régulière, ne feroit entendre eft apparence
qu’un feul fon. 1' en eft de même de tous les inftrumens
poflîbles; donc le meilleur accord , la meilleure
partition feroit celle qui rendroir à chacun des fons
du fyftême reçu fon véritable rapport hirmon que.
Ma s comment accorder le fa & les deux la du cor ?
Par un tempérament beaucoup plus facile que celui
ou ceux que vous employez pour l’orgue & pour
les inftrumens à cor les. Le U harmonique d’ut é<ra!e
7 ; donc fes cétaves fon t, 1 4 , 2 8 , $6, 112, 2 2 4 ,
M g 1 » f ° J- — 3 > re — 9 > f a * 9 tierce majeure
d î 5 X 9 — 45 ; * tierce majeure de fa %<,
5 X 4 5 —^ donc h premier la harmonique
d’u t , ne diffère de ce la # que comme 2 24 diffère
.de 225. Prenez ce la * pour le la harmonique , faites
l’accord parfait harmonique ut mi fo l jv ut, & baiff. z
impercept blementle la jufqu a ce qu’il ne batte p lus,
vous aurez ce/n dans toute fa juftdffe. On obtiendra
le / ff & le ta par un procédé femblable. (V o y e z
Tempérament. ) O r je dis que ce tempérament eft
beaucoup plus facile que l’ancien, & à plus forte
raifon que celui de Rameau : car dans les temp e-ra-
mens en ufage on che-che non-feulement une diffonance
, mais un intervalle irraronel , incommenfti-
rab'.e (V o y e z Tempérament.) qui puiffè êrre fubftitué
à une confonnance; ce q u i, malg'é 1 habitude d .s
accordeurs, oflre encore be ucouo de difficulté &
d’arbitraire. Au contraire, dans le tempérament pro-
pofé on va d’une c---nfonnance à une aut e confia i -
nance; ce qui peut toujours fe faire fans difficulté,
& avec la plus grande précifion.
Je conviens que les battemens étant moins fen-
fibles fur les inftrumens à cordes que dans i’orgue
cet accord ne fera p is aufli facile pour le piano-
forté & ;a harpe, que pour l’orgue. Mais le fyftême
d. s Grecs pour le genre chromatique offi oit bien une
autre difficulté , puifqu’il s’agiffait d’accorder des tiers