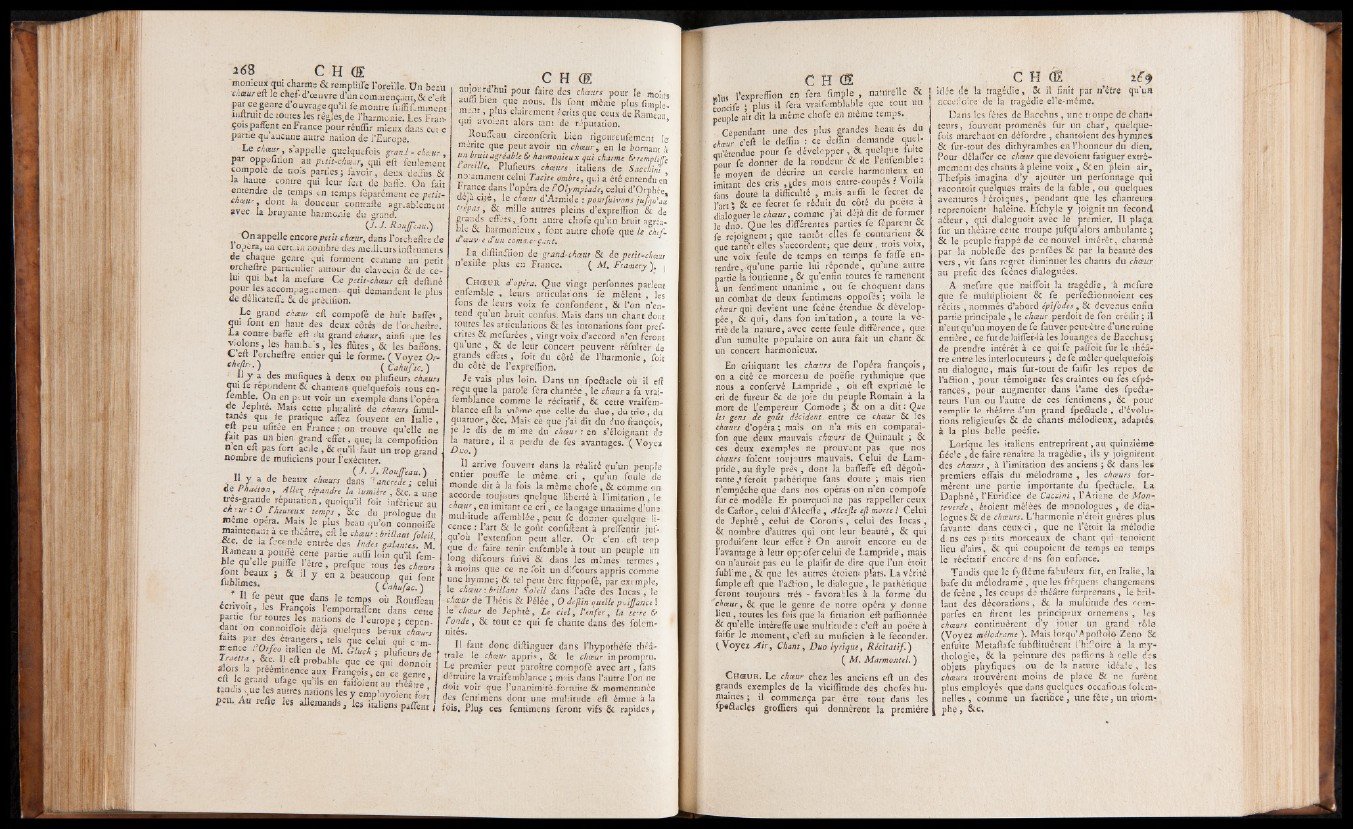
268 CH(E
momeux qui charma & rempliffe l’oreille. Un béai
ciioeur eft le chef- d’oeuvre d’un commençant, & c’eil
par ce genre d’ouvrage qu’il fe montre fuffiLimnent
tnltruit de toutes les rêgles.de l’harmonie. le s François
panent enFrance pourréulllr mieux dans cet e
parue qu’aucune autre nation de l’Europe.
Le chtttsr, s appelle quelquefois grand - chaur,
par oppofltion au pttit-choear, qui ell feulement
compofe de trois parties ; favoir, deux deuus &
la haute - contre qui leur fert de baffe. On fait
entendre de temps en temps féparément ce vetït-
ehoeur dont la douceur contraffe agr.abletnent
avec la bruyante harmonie du grand.
(y. J. Roujfeaud)
On appelle encorepetit chaut, dans l’orcheïire de
1 Opéra, un cert..in nombre des me.lii.urs inftrumer.s
de c lique genre qui forment ccmms un petit
orcheftre particulier autour du clavecin & de celui
qui bat la mefure. Ce petit-choeur eft deftiné
accom pagne mens qui demandent le plus
de delicàteffi 8c de précifion.
Le grand chaut efl compofé de huit baffes,
qui font en haut des deux côtés de l ’orchellre.
La contre-baffe eft du grand chaut, ainfi que les
Violons, les hau.b..'s , les flûtes , & les baffons.
C ell l’orcheftre entier qui le forme. ( Voyez Orm
Ê Ë Ë . ( Cahufic. )
■ il y a des mufiques à deux ou plufieur, choeurs
5U1 " repondent & chantent quelquefois tous en-
femble. On en pt ut voir un exemple dans l’opéra
ue Jephté. Mais cette pluralité de choeurs fimul-
tanes qui fe pratique affez fouyent en Italie,
eft peu ulitée en France : on trouve qu’elle ne
fatt pas un bien, grand -effet, quej la compofttion
n en ell pas fort acile , & qu’il faut un trop grand
nombre de muliciens pour l’exécuter.
( ./. J. Roujj'tau. )
y a de beaux choeurs dans * ancre rie,- celui
ue rhaétsn, Alle^ répandre la lumière , &c. a une
tres-grande réputation, quoiqu’il foit inférieur au
chiur: O [heureux temps , & c du prologue du
meme opéra. Mais le plus beau qu’on connoiffe
maintenant à ce théâtre, ell le choeur : brillant foleil,
& c . de la fécondé entrée des Indes galantes. M.'
Kameau a pouffé cette partie auûi loin qu’il fem-
ble qu elle puiffe l’être , prefque tous fes choeurs
font beaux ; & il y en a beaucoup qui font
fub!lmes- ( Cahufac. )
, . m ^ Peut fl11« dans le temps où Rouffeau
écnvoit, les François l’emportaffent dans cette
parue fur toutes les nations de l’europe : cependant
on connoiffoit déjà quelques be-,ux choeurs
laits par des étrangers, tels que celui qui c m-
mence / Or/ro italien de M. Gluck ; plulieursde
l u < \ S eft Prob‘lble i S ce qui donnoit
alors la prééminence aux François, en ce genre
eft le grand ufage qu’ils en faifoientau thlâtre ’
tenais s ue les autres nattons les y employoient forî
peu. Au relie les allemands, les italiens paffent |
C H (E
aujourd hui pour faire des choeurs pour le mob»
aiibi bien que nous. Ils font même plus 'fimple-
«liait, plus clairement écrits que ceux de Rameau
qui a voient alors tant de réputation.
Rouffeau circonfcrit bien rigeureufemenf Jç
mérité que peut avoir un choeur, en le bornant à
un bruit agréable & harmonieux qui charme &remplijre
I oreille. Plufieurs choeurs italiens de Sacchini
no:amment celui Tacite ombre, qui a été entendu en
France dans l’opéra de l’Olympiade, celui d’Orphée
déjà cité, le choeur d’Armide : poursuivons jufqu'au
t'évas, 8c mille autres pleins d’expreflion & de
grands effets ,jfont antre chofe qu’un bruit agréable
8c harmonieux, font autre chofe que le chef-
(Tçeuvie d’un comn.erç.:nt.
La diftin&ion de grand-choeur 8c de petit-chcmr
n’exifte plus en France. ( M, Framery ). j
Choeur d'opéra. Que vingt perfonnes parlent
enfemble , leurs articulat’ons fe mêlent , les
fons de leurs voix fe confondent, & l’on n’entend
qu’un bruit confus. Mais dans lin chant dont
toutes les articulations & les intonations font pref-
crites & mefurées , vingt voix d’accord n’en ferons
qü une , & de leur concert peuvent réfulter de
grands effets, foit du côté de l’harmonie, foit
du côté de l’expreffion.
Je vais plus loin. Dans un fpeétacle ou il eft
reçu que la parole fera chantée , le choeur a fa vrai-
femblance comme le récitatif, & cette vraifibm-
blance eft la inême que celle du duo, du trio,, du
quatuor, &c. Mais ce que j’ai dit du duo françois,
je le dis de m me du choeur : en s’éloignant de
la nature, il a perdu de fes avantages. ( Voyez
Duo. )
II arrive fouvent dans la réalité qu’un peuple
entier pouffe le même- cri , qu’un foule de
monde dit à la fois la même chofe, & comme on
accorde toujours qnelque liberté à l’imitation, le
choeur, en imitant ce c r i, ce langage unanime d’uns,
muhitude affemblée, peut fe donner quelque licence
: l’art & le goût conftftent à preffentir juf-
qu’oii l’extenfion peut aller. Or c’en , eft trop
que de faire tenir enfemble à tout un peuple un
long difeours fuivi & dans les mêmes termes,
à moins que ce ne foit un difeours appris comme
une hymne; & tel peut être fuppofé, par exemple,
le choeur : brillant Soleil dans l’afte des Incas , le
choeur de Thétis & Pélée, O deflin quelle p/siffance 1
\e~:choeur de Jephté, Le ciel, l'enfer, la tc-re 6*
l’onde, & tout ce qui fe chante dans des folcm-
nités.
Il faut donc diftinguer dans l’hypothèfe théâtrale
le choeur appris , 8t le choeur in prompt».
Le premier peut paroître compofé avec a r t, fans
détruire la vraifemblance ; mais dans l’autre l’on ne
doit voir que l’unanimité fortuite & momentanée
des fentimens dont une multitude eft émue à la
fois, Plu$ ces fentimens feront vifs & rapides,
„i.Æ l’expreflion en fera Ample , naftlrêlle & ]
coiicife ; plus il fera vraifemblable que tout un
peuple ait dit la même chofe en même temps.
Cependant une des plus grandes beau és du i
choeur c’eft le deffin : ce deiîm demande quel-
mi’étendue pour fe développer, & quelque fuite
pour fe donner de la rondeur & de 1 enfemble:
le moyen de décrire un cercle harmonieux en
imitant des cris ,^des^mots entre-coupés ? Voilà
fans doute la difficulté , nuis auffi le fecret de
l’art \ & ce fecret fe réduit du côté du pcëte à
dialoguer le choeur, comme j’ai déjà dit de former
le duo. Que les différentes parties fe féparcnr &
(e rejoignent; que tantôt’elles fe contrarient S I
que tantôt elles s’accordent; que deux , trois voix,
une voix feule de temps en temps fe faffe entendre
, Qu’une partie lui réponde , qu’une autre
partie la foutienne , & qu’enfin toutes fe ramènent
à un fentiment unanime , ou fe choquent dans
un combat de deux fentimens oppofés ; voila le
choeur qui devient une fcène étendue 8c développée,
& qui, dans fon imitation, a toute la vérité
de la nature, avec cette feule différence, que
»Tnn tumulte DODulaire on aura fait un chant &
En critiquant les choeurs de l’opéra françois,
on a cité ce morceau de poëfte rythmique que
nous a confeivé Lampride , où eft exprimé le
cri de fureur & de joie du peuple Romain à la
mort de l’empereur Comodo ; & on a dit : Que
les gens de goût décident, entre ce choeur 8c les
choeurs d’opéra ; mais on n’a mis en comparai-
fon que deux mauvais choeurs de Quinault ; 8c
ces deux exemples ne prouvent pas que nos
choeurs foient toujours mauvais. Celui de Lampride
, au flyle près , dont la baffeffe eft dégoûtante
» feroit pathétique fans doute ; mais rien
n’empêche que dans nos opéras on n’en compofe
fur ce modèle. Et pourquoi ne pas rappeller ceux
de Caftor, celui d’Alcefte , Alcefle ejl morte ! Celui
de Jephté , celui de Coroms , celui des Incas ,
& nombre d’autres qui ont leur beauté, & qui
produifent leur effet ? On auroit encore eu de
l’avantage à leur opr.ofercelui de Lampride, mais
on n’auroit pas eu le plaifir de dire que l’un étoit
fubfme , & que les autres étoiem plats. La vérité
ftmple eft que t’a&ion, le dialogue, le pathétique
feront toujours très - favorables à la forme du
choeur, & que le genre de notre opéra y donne
lieu, toutes les fois que la fituation eft paffionnée
& qu’elle intéreffe use multitude : c’eft au poëte à
faiftr le moment, c’eft au mufteien à le. féconder.
( Voyez A ir , Chant, Duo lyrique, Récitatif')
( M. Marmontel. )
C hoeur. Le choeur chez les anciens eft un des
grands exemples de la viciffitude des chofes humaines
; il commença par être tout dans les
*p«éUcles greffiers qui donnèrent la première
C H (E i<?>
idée dé la tragédie, 8c il finit par n’être qu’un
accelïoire de la tragédie elle-même.
Dans les fêtes de Bacchus, une troupe de chân-*
teurs, fouvent promenés fur un char, quelquefois
marchant en défordre , chantoient des nyn;nes
8c fur-tout des dithyrambes en l’honneur du dieu.
Pour délaffer ce choeur que dévoient fatiguei1 extrêmement
des chants à pleine voix , 8c en plein air,
Thefpis imagina d’y ajouter un perfonriage qui
racontoit quelques traits de la fable , oii quelques
aventures héroïques, pendant que les chanteurs
reprenoient haleine. Efchyle y joignit un fécond
aa cur, qui dialoguait avec le premier. Il plaça,
fur un théâtre cette troupe jufqii alors ambulante ;
8c le peuple frappé de ce nouvel intérêt, charmé
par la nobleffe des penfées & par la beauté des
vers , vit fans regret diminuer les chants du choeur
au profit des fçènes dialoguées.
A mefure que "naHfoit la tragédie, 'à mefure
que fe multiplioient & fe perte&ionnoient ces
récits , nommés d’abord épifodes, 8c devenus enfin
partie principale , le choeur perdoit de fon crédit ; il
n’eut qu’un moyen de fe fauver peut-être d’une ruine
entière, ce futdelaiffer-là les louanges de Bacchus;
de prendre intérêt à ce qui fe paffoit fur le théâtre
entre les interlocuteurs ; de fe mêler quelquefois
au dialogue, mais fur-tout de faifir les repos de
l’aftion , pour témoigner fes craintes ou fes efpé-*
rances, pour augmenter dans l’ame des fpeéia-
teurs l’un ou l’autre de ces fentimens, 8c pour
remplir le théâtre d’un grand fpeâacle , d’évolutions
religieufes 8c de chants mélodieux, adaptés
à la plus -belle poéfie.
Lorfque les italiens entreprirent, au quinzième
fiècle , de faire renaître la tragédie, ils y joignirent
des choeurs, à l’imitation des anciens ; & dans les
premiers effais du mélodrame , les choeurs formèrent
une partie importante du fpeâacle., La
Daphné, î’Eùridice de C a c c in i, l’Ariane de M o n -
te v e rd e , étoient mêlées de monologues , de dialogues
8c de choeurs. L’harmonie n’éteit guêres plus
favante dans ceux-ci, que ne l’étoit la mélodie
d=ns ces petits morceaux de chant qui tenoient
lieu d’airs, & qui coupoicnt de temps en temps
le récitatif encore d^ns fon enfance.
Tandis oue le fyftême fabuleux fut, en Italie, la
bafe du mélodrame , que les fréquens changemens
de fcène , les coups de théâtre furprenans , le brillant
des décorations, & la multitude des ccm-
parfes en firent les principaux ornemens , les
choeurs continuèrent d’y jouer tin grand ' rôle
(Voyez mélodrame ). Mais lorqu’Apoftolô Zeno 8c
enfuite Metaftafe fubftituèrent l’hifîoire à la mythologie,
& la peinture des paffirns à celle des
objets phyfiques ou de la nature idéale, les
choeurs trouvèrent moins de place & ne furênt
plus employés que dans quelques occafions fokm-
nelîes , comme un facrifice, une fête, un triom-
! p h e , &c.