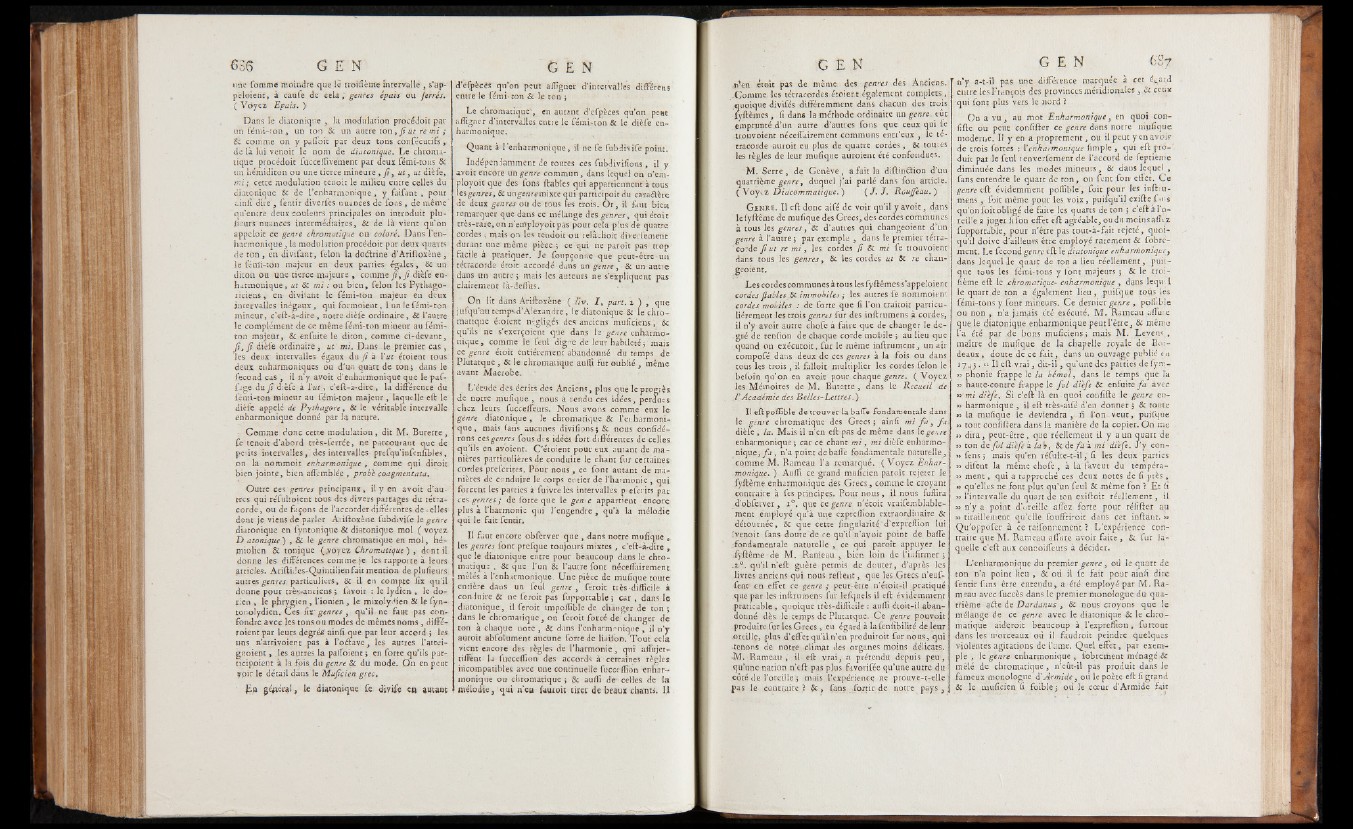
une fomme moindre que lè troifîème intervalle , s’àp-
peloient, à caufe de c e la , genres épais ou Jerrés.
( V o y e z Epais. )
Dans le diatonique , la modulation procédoic par
un féro-i-con , un ton 6é un autre t o n , fi ur re mi ;
5c comme on y palîoit par deux tons cônfécutifs »
de là lui venoit le nom de diatonique. L e chromatique
procédoit fûcceffivément par deux fémi-tons &
un hémiditon ou une tierce m ineure, f i 3 ut , ut dièfe,
mi ; cette modulation tenoit le milieu entre celles du
diatonique & de l’enharmonique, y faifant , pour
ainfi dire , fentir diverfes nuances de Tons , de même
qu’entre deux couleurs principales on introduit plu-
iisurs nuances intermédiaires, & de là vient qu’on
appeloit ce genre chromatique ou coloré. Dans l ’enharmonique
, la modulation procédoit par deux quarts
de ton , en divifant, félon la doétrine d’Ariftoxène ,
le fémi-ton majeur en deux parties égales , & un
diton ou une tierce majeure , comme f i , fi dièfe enharmonique,
ut & mi : ou bien, félon les Pythagoriciens,
en divilaht le fémi-tôn majeur en deux
intervalles inégaux, qui formoient, 1 un le fémi-ton
mineur, c’eft-à-dire-, notre dièfe ordinaire, 8c l’autre
le complément de ce même fémi-ton mineur au fémi-
ton majeur, & enfuite le diton, comme ci-devant,
f i y f i dièfe ordinaire, ut' mi. Dans le premier cas ,
les deux intervalles égaux du fi à Vut étoient tous
deux enharmoniques ou d’un quart de ton 5 dans le
fécond cas , il n’y avoir d’enharmonique que le paf-
foge du f i dièfe à l'ut, c’eft-à-dire , la difteren.ee du
fémi-ton mineur au fémi-ton majeur , laquelle eft le
dièfe appelé de Pythagore, & le véritable intervalle
enharmonique donné par la nature.
• Comme donc cette modulation, dit M . Burette ,
Çe tenoit d’abord très-ferrée, ne parcourant que de
petits intervalles,! des intervalles prefqu’mfenfibles,
,on la nommoit enharmonique , comme qui diroir
bien jointe, bien aflcmblég , probe çoagmentata.
Outre ces genres principaux, il y en avoit d’auprès
qui réfühoient tous des divers partages du tétra-
cord e, ou de façons de l’accorder différentes de telles
dont je viens de parler A.'i iftoxène fubdivife le genre
(diatonique en fyntonique & diatonique mol ( voyez
D atoruque) , & le genre chromatique en mol, hé-
rniolien & tonique ( .voyez Chromatique ) , dent il
donne les différences comme.je les rapporte à leurs
articles. Ariftides-Qumtiiien fait mention de plusieurs
autres genres, particuliers, & il en compte fix qu’il
donne pour très^-anciens ; lavoir : le lyd ien , le dor
tien , le phrygien, l’ionien, le mixolydien & le fyn-
tonolydien. Ces f i x genres , qu’il ne faut pas confondre
avec les tons ou modes de mêmes noms, diffé-
roient par leurs degrés ainfi que par leur accord i les
uns n!amvoient pas à Toétave, les autres l’attei-
gnoient, les autres la paffoienc ; en forte qu’ ils parti
cippient à la fois du genre & du mode. On en peut
yoir le détail dans le Mufiçien grec,
Lu général, le diatonique fe divife en autant
d’efpècêS' qu’on peut affigner d’intervalles différons
entre le fémi-ton & le ton ;
Le chromatique'', en autant d’efpèces qu’on peut,
affigner d’intervalles entre le fémi-ton & le dièfe enharmonique.
Quant à l ’enharmonique, il ne fe fubdivife point.
Indépendamment de toutes ces ftibdivifîons, il y
avoit encore un genre commun, dans lequel on n’em-
ployoit que des fons ftables qui appartiennent à tous
les genres y & un genre mixte qui participoitdu caraâère
de deux genres oa de tous les trois. O r , il faut bien
remarquer que dans ce mélange des genres| qüi écoic
très-rare, on n’erïîployoit pas pour cela plus de quatre
cordes ; mais on les tèndoit ou relâ-.hoit diverfement
durant une même pièce.; ce qui ne paroît pas trop
facile à pratiquer. Je foupçonne que peut-être un.
tétracorde étoit accordé dans un genre s & un autre
dans un autre ; mais les auteurs ne s’expliquent pas
clairement là-deffus. ...................
On lit dans Ariftoxëne; ( Tiv. / , part, t ) ,* que
jufqu'au temps d'Alexandre, le diatonique & le chromatique
écoient négligés des anciens muficiéns, 8c
qu’ils ne s’exerçoient que dan.s le genre enharmonique,
comme le feul digne de leur habileté; mais
ce genre étoit entièrement abandonné du temps de
Plutarque, & le chromatique auffi fut o ub lié , même
avant Maerobe.
L’ étude “des écrits des Anciens, plus que le progrès
de notre mufique , nous à rendu ces idées , perdues
chez leurs fucceffeurs. Nous avons comme eux le
\ genre diatonique, le chromatique & l’euharmoni-
fq u e , mais fans aucunes divifions; & nous confidé-
i rons ccsgenres fous de s idées fort différentes de celles
i. qu’ ils en avoient. C ’étoient pour eux autant de ma-
! nières particulières de conduire le chant fur certaines
| cordes preferites. Pour n ou s , ce font autant de ma*
i nières de conduire le corps entier de l’harmonie, qui
; forcent les parties à fuivrelcs intervalles p eferits par
ces genres, de forte que le geme appartient eticorç
plus à l’harmonie qui l ’engçndre , qu’à la mélodie
i qui le fait fentir.
Il faut encore obfërver q u e , dans notre mufique,
les genres font prefque toujours mixtes , c’eft-àrdire ,
que le diatonique entre pour beaucoup dans le chromatique
, & que l’un & l’autre font néceffairement
mêlés à l’enharmonique Une pièce de mufique toute
entière dans un feul genre , feroit très-difficile à
conduire & ne feroit pas fupportable ; car , dans le
diatonique, il feroit impoffible de changer de ton ;
dans le chromatique, on feroit forcé de changer de
ton à chaque note , 8c dans l’ enharmonique , il n’y
auroit abfolument aucune forre de liaifon. Tout cela
vient encore des règles de l’harmonie, qui: adujet-r
tiffent: ja fucceffion des accords à certaines règles
incompatibles avec une continuelle fucceffion enharmonique
ou chromatique ; 8c auffi de- celles de la
mélodie, qui n’ea fauioit tirer de beaux chants. U
Ti-en étoit pas de même des genres des Anciens.
.Comme les tétracordes étoient également complets ,
quoique divifés différemment dans chacun des trois
iyftêmes, fi dans la méthode ordinaire un genre, eût
emprunté d ’un autre d’autres fons que ceux qui fe
tr.ouvoient néceffairement communs entr’eux , le tétracorde
auroit eu plus de quatre cordes, & tomes
les règles de leur mufique auroienc été confondues.
M. Serre , de Genève , a fait la diftin&ion d’un
quatrième genre, duquel j’ai parlé dans fon article.
(V o y e z Diacommatique.) {J. J. Roujfeau.')
Gjn r e . Il cft donc aifé de voir qu’il y a vo it, dans;
lefyftême de mufique des G recs, des cordes communes
à tous les genrest 8c d’autres qui changeoient d’un
genre à l’autre; par exemple , dans le premier técra-
’ corde f i ut re mi, les cordes (i 8c mi fe trouvoient
dans tous les genres, & les cordes ut 8c re changeoient.
Les cordes communes à tous les fyftêmes s*appeloient
cordes fiables £c immobiles ,* les autres fe nommoient
cordes mobiles : de forte que fi l’on traitoic particuliérement
les trois genres fur des inft rumens à cordes,
il n’y avoit autre chofe à faire que de changer le degré
de tenfion de chaque corde mobile ; au lieu que
quand on exécutoit, fur le même inftrument, un air
compofé dans deux de ces genres à la fois ou dans^
tous les trois , i! falloit multiplier les cordes félon le
befoin qu’ on en avoit pour chaque genre. ( V o y e z
les Mémoires de M . Burette , dans le Recueil de
VAcadémie des Belles-Lettres. )
Il eftpoffible de trouver la baffe fondamentale dans!
le genre chromatique des Grecs ; ainfi mi fa , H
dièfe , la. Mais il n'en eft pas de même dans le genre-,
enharmonique ; car ce chant mi, mi dièfe enharmo-fj
nique, f a , n’a point déballé fondamentale naturelle,:
comme M . Rameau l’a remarqué. ( V o y e z Enhar-\
monique. ) Auffi ce grand muncien paroît rejeter le ;
fyftême enharmonique des G re c s , comme le croyant
contraire à fes principes. Pour nous, il nous fuffira
d’obferver , J ° . que ee genre n’ étoit vrâifemblable-
ment employé qu’à une cxpreflïon extraordinaire &
détournée, 8c que cette fingularité/d’expreffion lui
; venoit fans doute de ce qu’il n’avoit point de baffe
fondamentale naturelle , ce qui paroît appuyer le
■ jfyjftême de M. Rameau , bien loin de l’infirmer ;
,x°. qu’il n’eft guère permis de douter, d’après les
livres anciens qui nous refteut, que les Grecs n’euf-
fenc en .effet ce genre ; peut-être n’écoit-il pratiqué
que par les inftrurnens fur lefquels il eft évidemment
praticable , qvioique très-difficile : auffi étoit-il abandonné
dès le temps de Plutarque. Ge genre pouvoir
produire fijr les G recs , eu égard à lafenfibilité de leur
x>rei)lç, plus d’effet qu’il n’en produiroic fur nous, qui
-tenons de notre climat d.es organes moins délicats.
-M. Rameau , il eft v rai, a prétendu depuis peu,
qu’une nation n’eft pas pjus favprifée qu’une autre du
côté de l’oreille ; mais l’expérience ne prouve-t-elle
pas le contraire ? , fans Tortir.de notre pays ,
n’y a-t-ïl pas une différence marquée à cet égard
entre les François des provinces méridionales , ,2c ceux
qui font plus vers le nord ?
On a vu , au mot Enharmonique, en quoi con-
fifte ou peut cpnfifter ce genre dans notre niufique
moderne. II y en a proprement, ou il peut y en avoir
de trois fortes : K enharmonique fimple , qui eft produit
par le feul îenverfement de l’accord de feptième
diminuée dans les modes mineurs, & dans lequel ,
fans entendre le quart de ton , on font fon effet. C e
genre cft évidemment poflïble , foit pour les inftiu-
mens , foit même pour les. v o ix , puifqu’il exifte f u s
qu’on foit obligé de faire les quarts de ton ; c’e f tà l’o-
reiüe a juger fi fon effet eft agréable, ou du moins alle z
fupporta*ble, pour n’être pas tout-à-faic rejeté, quoiqu’il
doive d'ailleurs être employé rarement & fobre-
ment. Le fécond genre eft le diatonique enharmonique,
dans lequel ,1e quart de ton a lieu réellement, puil—
que tous les fémi-tpns y font majeurs ; & le troi-
fième eft le chromatique- enharmonique , dans lequ' L
le quart de ton a également lieu , puifque tous les
fémi-ton s y font mineurs. C e dernier genre , polhble
ou n o n , n’a jçimais été exécuté. M . Rameau affur-e
que le diatonique eiiharmonique peut l’être, 8c même
l’a été par de bons muficiéns; mais M . L e v en s ,
maître de mufique de la chapelle royale de B o î-
deaux, doute de ce fa it , dans un ouvrage publié eu
1743 • “ ^ eft-vrai, d it- il, qu’une des parties de fymphonie
frappe le la bémol, dans le temps que la
>9 haute-contre frappe le fo l dièfe 8c enfuite fa avec
*9 mi dièfe. Si c’eft là en quoi confifte le genre cn-
33 harmonique , il eft très-aifé d’en donner ; & toute
» la mufique le deviendra, fi l’on v eu t, puifque
33 tout confiftera dans la manière de la copier. On me
33 dira, peut-être , que réellement il y a un quart de
33 ton de fo l dièfe à la b, & de fa à mi dièfe. J’y con-
3» fens ; mais qu’eh r é fu lte - t - ilf i les deux parties
33 difent la même ch o fe , à là faveur du tempéra-
33 ment, qui a rapproché ces deux notes de fi près ,
» qu’elles ne font plus qu’un feul & meme fon ? Et fi
33 l’intervalle du quart de ton exiftoit réellement, il
33 n’y a point d’oieiile allez forte pour réfifter au
33 tiraillement qu’elle fouffriroit dans cet inftànt. ?=
Qu ’o f pofèr à ce raifonnemerit ? L ’expérience contraire
que M . Rameau allure avoir faite , 8c fur la quelle
c’cft aux connoiffeurs à décider.
L ’enharmonique du premier genre, où le quart de
ton n’a poinc lieu , & où il fe fait pour ainfi dire
fentir fans être entendu, a été employé par M . R a meau
avec fuccès dans le premier monologue du quatrième
atfte de Dardanus , & nous croyons que le
mélange de ce genre avec le diatonique & le chromatique
aideroit beaucoup à l’expreffion, furtout
dans les morceaux où il faudroit peindre quelques
violentes agitations de famé. Quel effet, par exemple
, le genre enharmonique , fobremenr me'nagé &
mêlé de chromatique, n’eût-il pas produit dans le
fameux monologue d’Armide , où le poète eft fi grand
& le îmifi.cien fi. foible ; où le coeur d’Armide fait