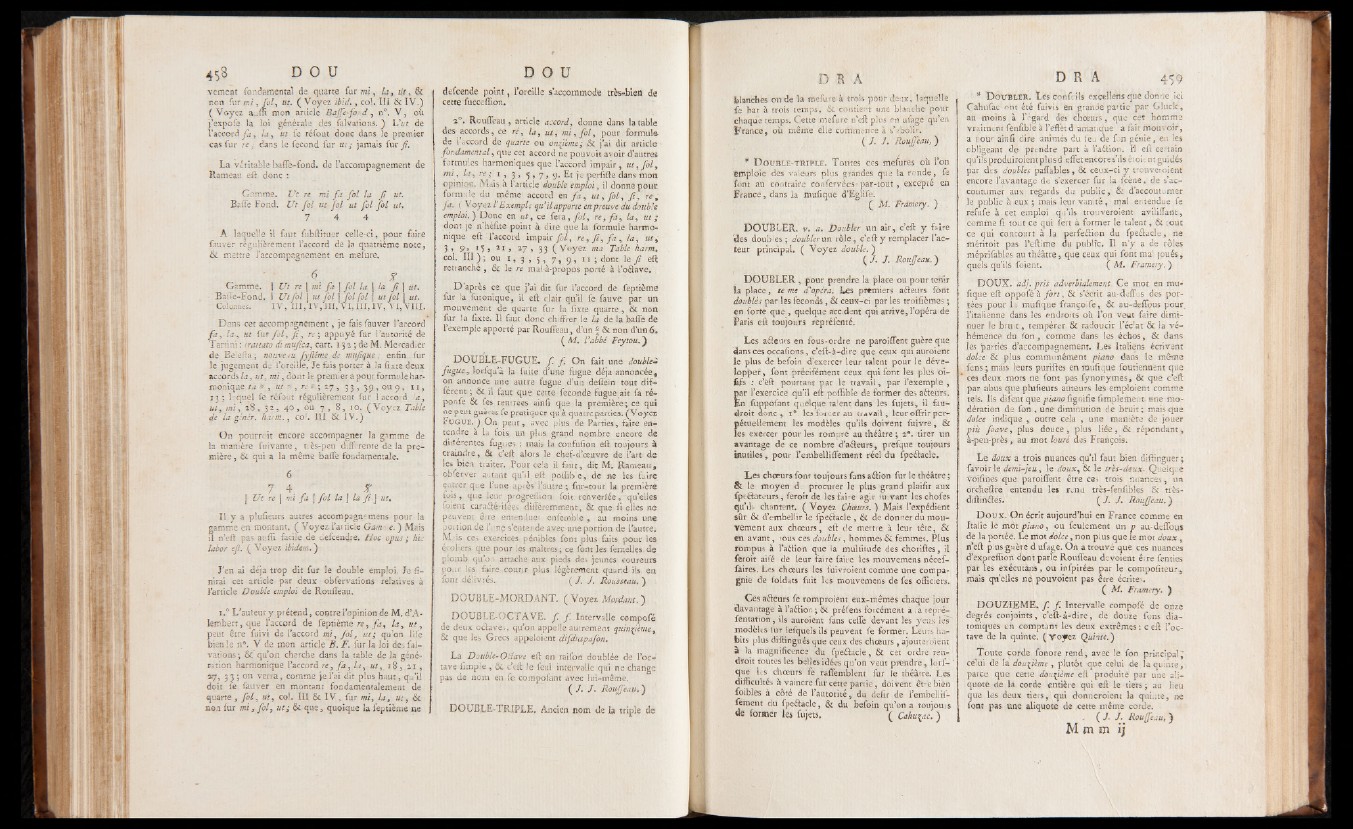
4 ç8 D O U
veinent fondamental de quarte fur mi, la, ü t, &
non fur mi, fol, ut. ( Voyez ibid., col. III & IV.)
(V o y e z auffi mon article Baffe-foi d , n°. V , où
j’expofe la loi générale des falvations. ) L'ut de
l’accord fit, la, ut fe réfout donc dans le premier
cas fur re ; dans le fécond fur ut; jamais fur fi.
La véritable baffe-fond, de l’accompagnement de
Rameau eft donc :
Gamme. Ut re mi fa fo l la f i ut.
Baffe Fond. Ut fol ut fo l ut fol fo l ut.
7 4 4
A laquelle il faut fubftituer celle-ci, pour faire
fauver régulièrement l’accord de la quatrième note,
& mettre l’accompagnement en meîure.
6 %
Gamme. 1 Ut re J mi fa J fol la j la f i | ut.
Baffe-Fond. I Ut fol J ut fol j fol fol J ut fol j ut.
Colonnes. IV , I I I , IV, III, VI, III, IV, VI, VIII.
Dans cet accompagnement, je fais fauver l’accord
f a , la-, ut fur fo l, f i , re ; appuyé fur l’autorité de
Tartini : trattato dï mu fie a, cart. 13 2 ; de M. Mercadier
de Belefta ; nouveau fyfiême de mufique ; enfin - fur
le jugement de l’oreille. Je fais porter à la fixte deux
accords la, ut, mi, dont le premier a pour formule harmonique
ta # , ut r e *m9 2.7, 33, 39 , ou 9 , 1 1 ,
13 : lequel fe réfout régulièrement fur 1 accord 'a ,
üt, mi, 28, 32, 40, ou 7 , 8, 10. (V o y e z Table
de la gêner, harm. , col. III & IV .)
On pourreit encore accompagner la gamme de
la manière fuivante, t: ès-peu différente de la première,
& qui a la même baffe fondamentale.
6
7 4. ~ Jf
J Ut re j mi fa \ fo l la J la f i J ut.
I l y a pîufieurs autres accompsgnemens pour la
gamme en montant. ( Voyez l’article Gain a e. ) Mais
il n’eft pas auffi facile de defeendre. Hoc opus ; hic
labor ejl. (V o y e z ibidem.')
J’en ai déjà trop dit fur le double emploi. Je finirai
cet article par deux obfervations relatives à
l’article Double emploi de Rouffeau.
i.° L ’auteur y prétend, contre l’opinion de M. d’A-
Iembert, que l’accord de feptième re, fa , la, u t ,
peut être fuivi de l’accord mi, fo l, ut; qu’on life
bien le n®. V de mon article B. F. fur la loi des falvations
; & qu’on cherche dans la table de la génération
harmonique l’accord re, f a , la, ut,. 18 , 21 ,
%7, 3 3 ; on verra, comme je l’ai dit plus haut, qu’il
doit fe fauver en montant fondamentalement de
quarte, fo l, uï, col. III & IV , fur mi, la, ut, &
non fur m i fo l, ut; & que, quoique la feptième ne
d o u
defeende point, l’oreille s’accommode très-bien de
cette fucceffion.
2.0. Rouffeau , article accord, donne dans la table
des accords, ce ré, la, ut, mi, fo l, pour formule
de 1 accord de quarte ou onzième; .& j’ai dit article
fondamental, que cet accord ne pouvoit avoir d’autres
formules harmoniques que l’accord impair, ut, fo l,
m i, la, re ; 1 , 3 , 5 , 7 , 9. Et je perfifte dans mon
opinion. Mais a 1 article double emploi, il donne pour
formule du même accord en f a , ut, fo l, f i , re ;
fa. ( V oyez V Exemple qu’il apporte en preuve du double
emploi.) Donc en ut, ce fera, fo l, re, fa, la, u t;
dont je n’héfite point à dire que la formule harmonique
eft l’accord impair fo l, r e , f i , f a , la, ut;
3 » 9 » 21 » 27 ? 33 ( Voyez ma Table harm.
col. III ) ; ou 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 ; dont le f i eft
retranché, & le re mal-à-propos porté à l’oâave.
D ’après ce que j’ai dit fur l’accord de feptième
fur la futonique, il eft clair qu’il fe fauve par un
mouvement de quarte fur là fixte quarte, & non
fur la fixte. Il faut donc chiffrer le la de la baffe de
l’exemple apporté par Rouffeau ^ d’un | & non d’un 6•
( M. T abbé Feytou. )
DOUBLE-FUGUE, fi f i On fait une double-
fv-guer lorfqu’à la fuite d’une fugue déjà annoncée,
on annonce une autre fugue d’un deffein tout different
; & il faut que cette fécondé fugue ait fa ré-
ponfe & fes rentrées ainfi que la première; ce qui
ne peut guères fe pratiquer qu’à quatre parties. (Voyez
Fugue. ) On peut, avec plus de Parties, faire env
tendre à la fois un plus grand nombre encore de
differentes fugues : mais la confufion eft toujours à
craindre, èk c’eft alors le chef-d’oeuvre de l’art de
les bien traiter. Pour cela il faut, dit M„ Rameau,
ob fer ver autant qu’il eft poffib e , de ne les faire
entrer que l’une après l’autre; fur-tout la première
tyis, que leur progrefiion foie renverlée, qu’elles
(oient earaâérifées différemment, & que fi elles ne
peuvent être entendues enfemme , au moins une
portion de l’une s’entende avec une portion de l’autre.
M:is ces exercices pénibles font plus faits pour les
ecohers que pour les maîtres; ce font les femelles, de
plomb qu’on attache aux pieds des jeunes coureurs
pour les faire courir plus légèrement quand ils en
font délivrés. ( ƒ. J. Rousseau. )
DOUBLE-MORDANT. ( Voyez Mordant. )
DOUBLE-OCTAVE, f . f Intervalle compofé
de deux octave-, qu’on appelle autrement quinzième,
& que les Grecs appeloient difdiapafon.
La Double-O étave eft en raifon doublée de l’octave
fimple , & c’eft le feul intervalle qui ne change
pas de nom en fe compofant avec lui-même.
( J. J. Rouffeau. )
DOUBLE-TRIPLE. Ancien nom de la triple de
D R A
blanches onde la mefure à trois pour deux, laquelle
fe bar à trois temps, & contient une blanche pour
chaque temps. Cette mefure n’eft plus en ufage qu’en
France, où même elle commence à sVbolir.
( J. J. Rouffeau. )
* D ouble-triple. Tomes ces melures où l’on
femploie des valeurs plus grandes que la rende, fe
font au contraire conferve.es-par-tout, excepté en
France, dans la fnufique d’Eglife.
( M. Frdmery. )
DOUBLER, v. a. Doubler un air, c’eft y faire
des doubles ; doubler un rôle, c’eft y remplacer l’acteur
principal. ( Voyez double.)
( J. J. Rouffeau. )
DOUBLER , pour prendre la place ou pour tenir
la place, te me d'opéra. Les premiers aâeurs font
doublés par les féconds, & ceux-ci par les t-roifièmes ;
en forte que , quelque accident qui arrive, l’opéra de
Paris eft toujours repréfenté.
Les aâeurs en fous-ordre ne paroiffent guère que
dans ces occafions, c’eft-à-dire que ceux qui auroient
le plus de befoin d'exercer leur talent pour le développer
, font précisément ceux qui font les plus oi-
fifs ; c’èft pourtant par le travail, par l’exemple ,
par l’exercice qu’il eft poffible déformer desaâeurs.
En fuppofant quelque talent dans les fujets, il fau-
droit donc , 1®. les forcer au travail, leur offrir perpétuellement
les modèles qu’ils doivent fuivre, &
les exercer pour les rompre au théâtre ; 2®. tirer un
avantage de ce nombre d’aâeurs, prefque toujours
inutiles, pour l’embelliffement réel du fpeâaclê.
Des choeurs font toujours fans aâion fur le théâtre ;
& le moyen d procurer le plus grand plaifir aux
fpeâatcurs, feroit de les faire agir tu vant les chofes
quMs chantent. ( Voyez Choeurs. ) Mais l’expédient
sûr & d’embellir le fpeâacle , & de donner du mouvement
aux choeurs, eft de mettre à leur tête, &
en avant, tous ces doubles, hommes & femmes. Plus
rompus à l’aâion que la multitude des choriftes, il
feroit aifé de leur faire faire les mouvemens nécef-
faires. Les choeurs les fuivroient comme une compagnie
de foldats fuit les mouvemens de fes officiers.
Ces aâeurs fe romproient eux-mêmes chaque jour
davantage à l’aâior, ; & préfens forcément à ja tepré-
fèntation, ils auroient fans ceffe devant les yeux les'
modèles lur lefquels ils peuvent fe former. Leurs habits
plus diftingués que ceux des choeurs, ajouterbient
a la magnificence du fpeâacle, & cet ordre ren-
droit toutes les belles idées qu’on veut prendre, lorf-
que Us choeurs fe rafl'emblent fur le théâtre. Les
difficultés a vaincre fur cette partie, doivent être bien
foibles à côté de l’autorité, du defir de l’embelliffement
du fpeâacie, & du befoin qu’on a toujouis
de former les fujets. ( Cahurie. )
D R A 459
* D oubler. Lesconfiils excellens que donne ici
Cahufac ont été fuivis en grande partie par Gluck,
au moins à l’égard des choeurs, que cet homme
vraiment fenfible à l’effet d arriaticjue a fait mouvoir,
a pour ainfi dire animés du fèu de fon génie, en les
obligeant de prendre part à l’aétion. 1*1 eft certain
qu’il s produiroient pl u s d effet encore s’ils èt oient guidés
par des doubles pafîables, & ceux-ci y trouver oient
encore l’avantage de s’exercer fur la fcène, de s’accoutumer
aux regards du public, & d’accoutumer
le public à eux ; mais leur vanité, mal entendue fe
refufe à cet emploi qu’ils trouveroient aviliffant,
comme fi tout ce qui fert à former le talent, & tout
ce qui concourt à la perfeâion du fpeâacie, ne
méritoit pas l’eftime du public. Il n’y a de rôles
méprifables au théâtre, que ceux qui font ma’ joués,
quels qu’ils fojent. ( M. Framery. )
DOUX. adj. pris adverbialement. Ce mot en mufique
eft oppofé à fort, & s’écrit au-deffus des portées
pour lu mufique françolfe, & au-deffous pour,
l’italienne dans les endroits où l’on veut faire diminuer
le bruit, tempérer & radoucir l’éc'at & la véhémence
du fon, comme dans les échos, & dans
les parties d’accompagnement. Les Italiens écrivent
dolce & plus communément piano dans le même
fens ; mais leurs purifies en mufique foutiennent que
ces deux mots ne font pas fynohymes, & que c’eft
par abus que plufieurs auteurs les emploient comme
tels. Us difent que piano fignifie fimplement une modération
de fon, une diminution de bruit ; mais que
dolce indique , outre cela , une manière de jouer
piii foave, plus douce, plus liée, & répondant,
à-peu-près, au mot louré des François.
Le doux a trois nuances qu’il faut bien diftinguer ;
favoir le demi-jeu, le doux, & le très-deux. Quelque
voifines que paroiffent être ces trois nuances, un
ôrcheftre entendu les rend très-fenfibles & très-
diftinâës. ( J. J. Rouffeau.)
D o u x . On écrit aujourd’hui en France comme en
Italie le mot piano, ou feulement un p au-deffous
de la portée. Le mot dolce, non plus que le mot doux ,
n’eft p:us guère d ufage. On a trouvé que ces nuances
d’expreffion dont parle Rouffeau dévoient erre fenties
par les exécutans, ou infpirées par le compofiteur5
mais qu’elles nè pouvoient pas être écrite*.
( M. Framery. )
DOUZIEME, f . f . Intervalle compofé de onze
degrés conjoints, c’eft-à-dire, de douze fons diatoniques
en comptant les deux extrêmes : c eft l’octave
de la quinte. (V oy e z Quinte.)
Toute corde fonore rend, avec le fon principal,’
celui de la douzième , plutôt que celui de la quinte,
parce que cette douzième eft produite par une ali—
quote de là corde ‘entière qui e ft le tiers ; au lieu
que les deux tiers, qui donneroient la quinte, ne
font pas une aliquote de cette même corde.
- ( J. J. Rouffeau, )
Mm m ij