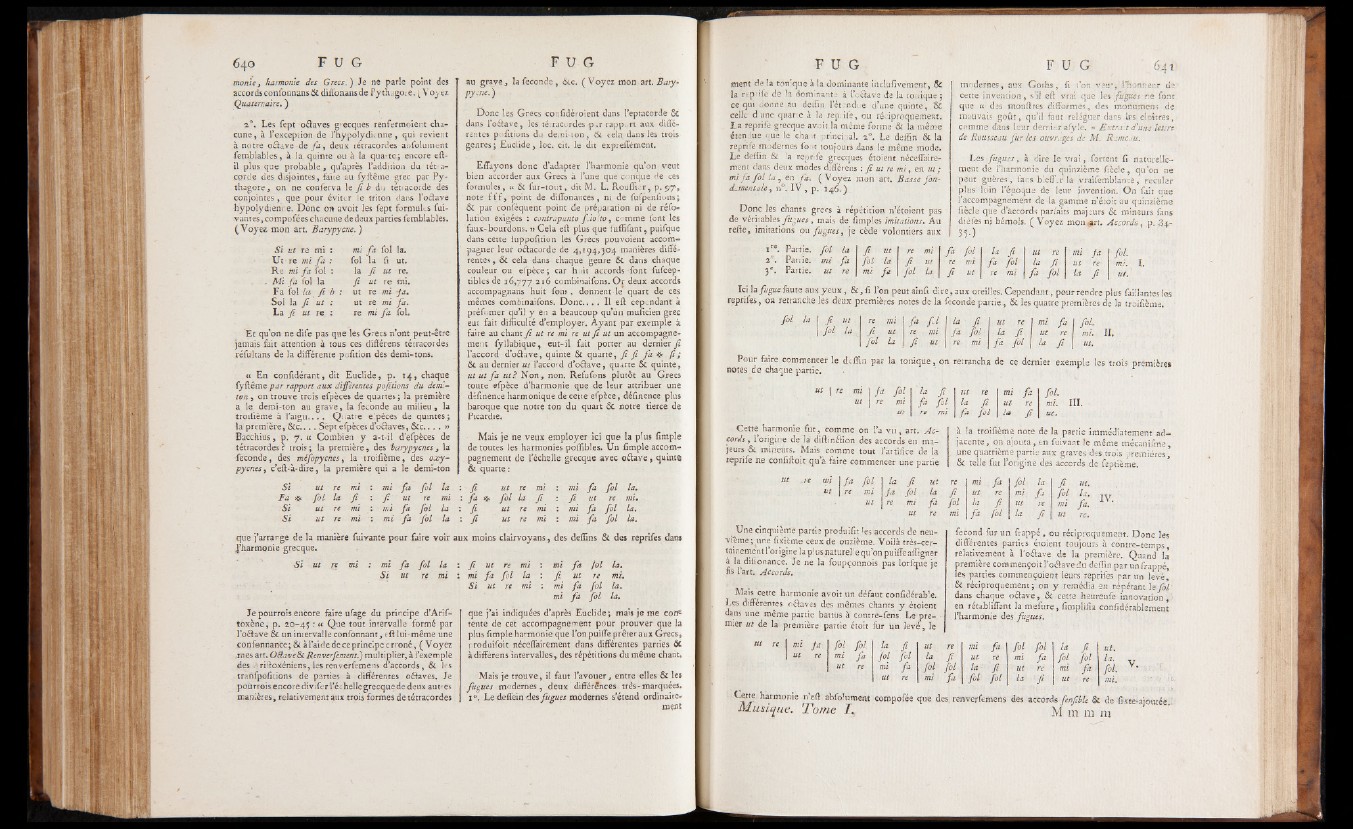
monte, harmonie des Grecs.} .le ne parle point des
accords confonnans& difîonansde Pythagoie. ^ Voyez
Quaternaire. )
2°. Les fept -o&aves grecques renfermoient chacune
, à l’exception de l’hypolydicnne, qui revient
à notre oâave de f a , deux tétracordes abfolument
femblables, à la quinte ou à la quarte; encore eft-
il plus que probable, qu’après l’addition du tétta-
eprde des disjointes, faite au fyftême grec par Py-
thagore, on ne conlerva le Ji b du tetracorde des
conjointes, que pour éviter le triton dans l’oâave
hypolydienne. Donc on avoit les fept formuks V ivantes
, compofées chacune de deux parties femblables.
(V oy e z mon art. Barypycne.)
Si ut rë mi î
Ut re mi fa :
Re mi fa fol :
Mi fa fol la
Fa fol la f i b
Sol la f i ut :
La f i ut re ;
mi fa fol la*
fol la fi ut.
la f i ut re.
f i ut re mi.
ut re mi -fa.
ut re mi fa.
re mi fa fol.
Et qu’on ne dife pas que les Grecs n’ont peut-être
jamais fait attention à tous ces différens tétracordes
réfultans de la différente pefition des demi-tons.
« En confidérant, dit Euclide, p. 14 , chaque
fyftême par rapport aux differentes positions du demi-
ton , on trouve trois efpèces de quartes ; la première
a le demi-ton au grave, la fécondé au milieu, la
troifième à l’a ig u .... Quatre efpèces de quintes;
la première, & c . . . . Sept efpèces d’oéfaves, & c .. . . »
Bacchius, p. y. « Combien y a-t-il d’efpèces de
tétracordes ? trois ; la première, des harypyenes, la
fécondé, des méfopyenes, la troifième, des oxy-
pyenes, c’eft-à-dire, la première qui a le demi-ton
au grave, la fécondé, &c. ( Voyez mon art. Bary-
pyene. )
Donc les Grecs confidéroierit dans l’eptacorde &
dans i’o â av e, les tétracordes p ,r rapport aux différentes
pofitions du demi-ton. & cela dans-les trois
genres ; Euclide 5 loc. cit. le dit expreffément.
Effayons donc d’adapter l’harmonie qu’on veut
bien accorder aux Grecs à l’une que connue de ces
formules, « & fur-tóut, dit M. L. Rouflkr, p. 97-9
note f f f , point de diflonànces, ni de fufpenfions;
& par conféquent point de préparation ni de réfo-
lution exigées : contrapunto f.io 'to, comme font les
faux-bourdons. » Cela eft plus que fuffifant, puifque
dans cette luppofition les Grecs pouvoient accompagner
leur oéfacorde de 4,194,304 manières différentes,
& cela dans chaque genre & dans chaque
couleur ou efpèce ; car huit accords'font fufeep-
tibles de 16,777.216 combinaifons. Or deux accords
accompagnans huit fons, donnent-le quart de ces
mêmes combinaifons. D o n c .... Il eft cependant à
préfumer qu’il y en a beaucoup qu’un muficien grec
eut fait difficulté d’employer. Ayant par exemple à
faire au chant f i ut re mi re ut f i ut un accompagnement
fyllabique, eut-il fait porter au dernier fi
l’accord d’oéfave, quinte & quarte, f i f i f i t# fi;
& au dernier ut l’accord d’oâave, quarte &. quinte,
ut ut fa u tî Non, non. Refufons plutôt au Grecs
toute efpèce d’harmonie que de leur attribuer une
définence harmonique de cette efpèce, définençe plus
baroque que notre ton du quart 6c notre tierce de
Picardie.
Mais je ne veux employér ici que la plus (impie
de toutes les harmonies poffibles. Un (impie accompagnement
de l’échelle grecque avec o&ave, quinte
& quarte:
Si ut re mi : mi fa fo l la
Fa >$c fo l la f i : f i ut re mi
Si ut re mi : mi fa fol la
Si ut re mi : mi fa fo l la
que j’arrarge de la manière fuivante pour faire voir
l ’harmonie grecque.
S i ut re mi : mi fa fo l la
S i ut re mi
Je pour roi s encore faire ufage du principe d’A rif-
toxène, p. 20-45 : “ Q ue tout intervalle formé par
l’oâave & un intervalle confonnant, eft lui-même une
confennance ; & à l’aid e de ce principe e rroné, ( Voyez
,mes art. O&ave&t Renvcrfementl) multiplier, à l’exemple
des riftoxéniens, les renverfemens d’accords, & les
trarifpofitions de parties à différentes oétaves. Je
pourrois encore divifer l’échelle grecque de deux autres
manières, relativement aux trois formes de tétracordes
: f i ut re mi : mi fa fo l la.
: fa # fôl la . f i '. f i ut re mi,
: f i ut re mi : mi fa fol la.
• f i ut re mi : mi fa fo l la.
au x moins d a i r v o y a n s , de s deffins & des reprifes dans
: f i ut re mi : mi fa jol la.
z mi fa fol la : f i ut re mi.
Si ut re mi : mi fa fol la.
mi fa fol la.
que j’ai indiquées d ’après E u c l id e ; mais je me con*
tente de ce t ac compagnement p o u r p ro u v e r que la
plus ftmple h a rmonie que l ’on puiffe prêter au x G r e c s ,
p rodu ifoit néceffairement dans différentes parties &
à différens in te rv a lle s , des répétitions du m êm e chant.
M ais je t ro u v e , il fau t l’a v o u e r , entre elles & les
fugues m o d e rn e s , d e u x différences trés - marquées.
i ° . L e deffein des fugues modernes s’éten d ordinairement
ment de la tonique à la dominante inclufivement, 5c
la rep ife de la dominante à l’o&ave de la tonique;
ce qui donne au deffin fétendue d’une quinte, &
celle dune quane à la repaie, ou réciproquement.
La reprife grecque avoit la même forme & la même
étendue que le chaor principal. %°. Le deffin & la
reprife modernes (o;<t toujours dans le même mode.
Le deffin & la reprife grecques étoient néceffairement
dans deux modes différens : f i ut re mi, en Ut;
mi fa fol la , en fa. ( V oyez mon art. Basse fondamentale,
n°. IV , p. 146. V
Donc les chants grecs à répétition n’étoient pas
de véritables fugues, mais de (impies imitations. Au
rêfte, imitations ou fugues, je cède volontiers aux
modernes, aux Gotns, fi l’on yen-, l’honneur de
cette invention, s’il eft vrai que les fugues ne font
que « des monftres difformes, des monument de
mauvais goût, qu’il faut reléguer dans les cloîtres,
comme dans leur dernier afyie. >♦ Extrait d'une lettre
de Rousseau fur les ouvrages de M. Rameau.
Les fugues, à dire le vrai, fortent fi naturellement
de l’harmonie du quinzième fiècle, qu’on ne
peut guères, fans bleff.r la vraifemblance, reculer
plus loin l’époque de leur invention. On fait que
l’accompagnement de la gamme n’étoit au quinzième
fiècle que d’âccords par/aits majeurs & mineurs fans
dièfes ni bémols. (V o y e z monfart. Aeçords, p. 34-
35-)
fo l la f i ut re mi fa fo l • la f i ut re ' mi fa
mi -fa fol la f i ut re mi fa fol la fi- ut re
ut re mi fa fo l la, f i ut re mi fa fol la f i
Ici la fugue faute aux y eu x , & , ( i l’on peut ainfi dire, aux oreilles. Cependant, pour rendre plus faillantes les
reprifes, o h retranche les deux premières notes de la féconde partie, & les quatre premières de la troifième.
I f i ut re mi m ü la f i ! ut re mi fa fol.
■ fo l la , f i ut re mi fa fo l la fi ut re mi. II
fo l la fi ut re mi i f ° ‘ la f i ut.
Pour faire commencer le deffin par la tonique, on retrancha de ce dernier exemple les trois premières
notes de chaque partie. • ■ r
ut 1 re mi 1 fa fol la f i ut re mi fa
ut re mi fa fol la f i ut re
ut re mi fa fo l la f i
Cette harmonie fut, comme on l’a v.11, art. Accords
, l’origine delà diftin&ion des accords en majeurs
& mineurs. Mais comme tout l’artifice de la
reprife ne confiftoit qu’à faire commencer une partie
à la troifième note de la partie immédiatement adjacente,
on ajouta, en Vivant te même mécariifme,
une quatrième partie aux graves des trois premières,
& telle fut l’origine des accords de feptième.
\ fa fol la fi ut re mi fa fol la
J re mi fa fol la fi ut re mi fa ut re mi fa fol la fi ut re
ut re mi fa fol la fi
Une cinquième partie produifit les accords de neuvième;
une fixième ceux de onzième. Voilà très-certainement
l’origine la plus naturelle qu’on puiffeaffigner
à la diffonance. Je ne la foupçonnois pas lorfque je
fis l’art. Accords.
Mais cette harmonie avoit un défaut confie!érable.
Les differentes oéfaves des mêmes chants y étoient
dans une même partie battus à contre-fens Le premier
ut de la première partie étoit fur un levé, le
fécond fur un frappé , ou réciproquement. Donc les
différentes parties étoient toujours à contre-temps,
relativement à l’oâave de la première. Quand la
première conamençoit l’o&ave du deffin par un frappé,
les parties commençoient leurs reprifes par un levé
& réciproquement; on y remédia en répétant le fo l
dans chaque oélave, & cette heureufe innovation ; 1
en rétabliffant la mefure, fimplifia confidérablement
l’harmonie des fugues.
1 mi fa fol fol la .fi ut Tt mi fa fo l fol la fi J ut re mi fa fol fo l la fi ut rè mi
, f a fol fol
ut re mi fa fol fol la • > f i ut mi f a ut
re mi fa ‘ fol fol la fi ut re
Ufitte harmonie n’eft abfolument compofée que des, renverfemens des accords fenfible & de fixte-ajoutéè.i
Musique. Tome T M m m m