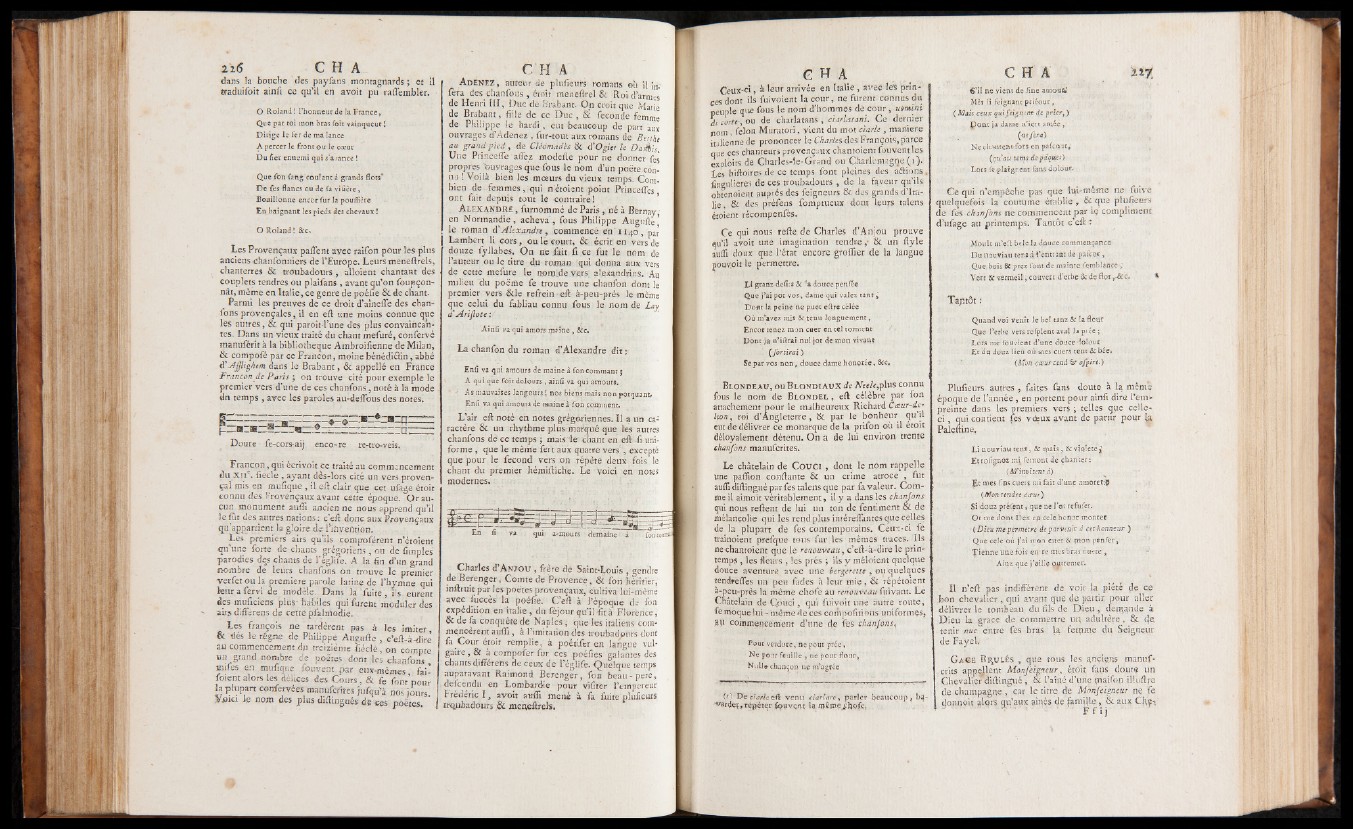
2 z6 C H A
dans la bouche des payfans montagnards ; et il
traduifoit ainfi ce qu’il en avoit pu raflèmbler.
O. Roland ! l’honneur de la France,
Que par roi mon bras foie vainqueur £
Dirige le fer de ma lance
A percer le front ou le coeur
Du fier ennemi qui s'a/ance !
Que fon fang coulant à grands flots*
De fies flancs gu de fa vilïère,
Bouillonne encor fur là poulGère
En baignant les pieds des chevaux £
O Roland ! &c.
Les Provençaux paient ayec raifon pour les plus
anciens chanfonniers de l’Europe. Leurs meneftrels,
chanterres & troubadours , alloient chantant des
couplets tendres ou plaifans , avant qu’on foupçon-
nât, même en Italie, ce genre de poéfie & de chant.
Parmi les preuves de ce droit d’aîneffe des chansons
provençales, il en eft une moins connue que
les autres, & qui paroît-l’une des plus convaincantes.
Dans un vieux traité du chant mefuré, confervé
manuférit à la bibliothèque Ambroifienne de Milan,
& compofé par ce Francon, moine bénédiélin, abbé
d'Afflighem dans le Brabant, & appellé en France
Francon de Paris ; on trouve cité pour exemple le
premier vers d’une de ces chanfons, noté à la mode
dn temps , avec les paroles au-deffous des notes.
-------— rr -------
Doure fer-cors-aij enco-re re-tro-veis.
Francon, qui écrivoit ce traité au commencement
du Xii . fiecle , ayant dès-lors cité un vers provençal
mis en mufique , il efl; clair que cet ufage étoit
connu des Provençaux avant cette époque. O r aucun
monument aufli ancien ne nous apprend qu’il
le fût des autres nations: c’eft donc aux Provençaux
qu’appartient la gloire de ^invention.
Les premiers airs qu’ils composèrent n’étoient
qu’une forte de chants grégoriens, ou de Simples
parodies.des chants de leglife. A la fin d’un grand
nombre de leurs chanfons ôn trouve le premier
-verfet ou la première parole latine de l’hymne qui
leur a Servi de modèle.. Dans la ‘fuite , ils. eurent
des muficiens plus-habiles qui furent moduler des
airs différens de cette pfalnlodie.
Les françois ne tardèrent pas à les imiter,
de dès le règne de Philippe Augufte g c’eft-à-dire
an commencement du treizième fièd é , on compte
un grand nombre de poètes dont les chanfons
rnifes en mufîque Souvent par eux-mêmes fai-
foient alors les, délices des Coms , & Se Sont’pour
la plupart confervéès manuferites jufqifà nos jours
Vfiici te nom des plus diftingués ds ces poètes
' A d en e z , auteur de plufieurs romans où il
féra des' chanfons , étoit meneftrel & Roi d’armes
de Henri 111, Duc de Brabant. On croit que Marie
de Brabant, fille de ce Duc , & Seconde femme
de Philippe le hardi, eut beaucoup de part aux
ouvrages d’Adenez , fur-tout aux romans de Bsrihe
au grand pied , de Cleomadès & d'O gier le DarÈis.
Une Prince fie affez modefte pour ne donner fes
propres 'ouvrages que fous le nôm d’un poète connu
S Voilà bien les moeurs du vieux temps. Combien
de femmes, qui nétoient point Princefles
ont fait depuis tout le contraire !
A l e x a n d r e , furnommé de Par i sné à Bernay,
en Normandie, acheva, fous Philippe Augufte
le roman d'Alexandre, commencé en 1140, par
Lambert li cors, ou lé court, écrit en vers de
douze lyllabes. On ne .fait fi ce fut le nom de
l’auteur ou le titre du roman qui donna aux vers
de cette mefure le nomade vers, alexandrins. Au
milæu du poème fe trouve une chanfon dont le
premier vers &le refrein - eft à-peu-près le même
que celui du fabliau connu fous le nom de Lay
d* Arijlo te :
Ainfi va qui amors-msine , &c.
La chanfon du roman d’Alexandre dit :
Enû va qui amours de mairie à foncommant ;
A qui que foie dolours , ainfi va qui amours,
■ As mauvaises langours ! nos biens mais non porquant»
En fi va qui amours de maine à- fon comment..
L’air eft noté en notes grégoriennes. Il a un caractère
& un rhythme plus marqué que les autres
chanfons de ce temps ; mais de chant en eft fi uniforme
, que le même fert aux quatre vers , excepté
que pour le fécond vers on répète deux fois le
chant du premier hémiftiche* Le voici en notes
modernes, g
En fi va qui' armoûts demàine< à : »Ifon'com
Charles d’A njou , ftèra de Saint-Louis ,-gendre
de Berenger, Comte de Provence, & fon héritier,
inffruit par les poètes provençaux, cultiva lui-même
avec fuccès' 'la poéfie. C ’eft à l’époque de fon
expédition, en Italie, dn féjotir qu’il fit à Florence,
& de fa conquête de Naples; que les italiens commencèrent
auffi, à l’imitation des troubadours dont
fa Cour étoit remplie,’ à poétifer en langue vulgaire
, & a cojnpofer fur’ ces poéfies galantes des
chants différens de ceux de l ’églife. Quelque temps
auparavant Raimond Berenger, fon beau-pere,
defeendu en Lombardie pour vîfiter l’empereur
1 Frédéric I , avoit anffi mené à fa fuite plufieurs
I troubadours ;& meqêffrels.
G H A
Ceux-ci, à leur arrivée en Italie, avec Ie$ princes
dont ils fuivoient la cour, ne furent connus du
peuple que fous le nom d’hommes dè cour , uomini
di corte-, ou de charlatans , ciarlatani. Ce dernier
nom, félon Muratori, vient du mot ciarle , maniéré
italienne de prononcer le Charles des François, parce
que ces chanteurs provençaux chantoienr fouventles
exploits de Charles-le-Grand ou Charlemagne (1).
Les hiftoires de ce temps font pleines des aélions,
fingulieres de ces troubadours , de la faveur qu’ils
obtenoient auprès des feigneurs & des grands d’Italie,
& des préfens fomptueux dont leuj-s talens
étoient récompenfés.
Ce qui nous rèfte. de Charles d*Anjou prouve
qu’il avoit une imagination tendre ,* & un ftyle
aufli doux que l’état encore groflier de la langue
pouv.oit le permettre.
Li granz defiis & 'a douce penfee
Que j’aipor vos, dame qui valez tant i
Dont la peine ne puet eftre célée
Où m’avez mis & tenu longuement,
Encor tenez mon cuer en tel torment
Dont ja n’iftrai nul jot de won yivant
Z (for tir ai )
Se par vos non, douce darne honorée, 8cC.
B lo n d e a u , ou B l o n d i a u x de Ncele,p\us connu
fous le nom de B lo n d e l , eft célèbre par fon
attachement pour le malheureux Richard Cæur-de-
lion9 roi d’Angleterre, & par le bonheur quil
eut de délivrer ce monarque de la prifon où il etoit
déloyalement détenu. On a de lui environ trente
chanfons manuferites.
Le châtelain de C o u c i , dont le nom rappelle
une paflion confiante & un crime atroce , fut
aufli diftingué par fes talens que par fa valeur. Comme
il aimoit véritablement, il y a dans les chanfons
qui nous relient de lui un ton de fentiment & de
mélancolie qui les rend plus inréreflantes que celles
de la plupart de fes contemporains. Ceux-ci fé
traînoient prefque tous fur les mêmes traces. Ils
nechantoient que le renouveau, c’eft-à-dire le printemps
: les fleurs , les prés ; ils y mêloient quelque
douce aventure avec une bergerette , ou quelques
tendrefles un peu fades à leur mie, & répétoient
à-peu-près la même chofe au renouveau finvant. Lé
Châtelain de Qouci, qui fuivOit une autre route,
fe moque lui - même de ces compofiriôns uniformes,,
commencement d’une de fes chanfons»
Pour verdure, ne pour pfée,
Ne pour feuille , ne pour flour.
Nulle chançon ne m’agrée
' (-0 De ciarle eft venu ciarlaré, parler beaucoup , ba-
^vardeçirépéter fpuvqnt la même
<S’il ne vient de fine amouBJ
Mèr li feignant pçiéour,
( Mais ceux quiféignatt de prier, )
Dont ja dame n’iert aînée ,
(■ ne fer 4)
Ne chantent*fors en pafeour;
(qu’au tems dé piqués)
■ . Lors fe plaigrcnt fans dolôur.
Ce qui n’empêche pas que lui-meme ne fuivé
quelquefois la coutume établie, & que plufieurs
de fes chanfons ne commencent par lç compliment
d’ufage au printemps. Tantôt c’eft :
Moule m’efl bele la douce commençance
Du nouviau cens à Centrant de pafeoe,
Que bois & prez font de mainte femblance ;
Vert & vermeil, couvert d’erbe 8c de flor ,-8cc. %
Tantôt î
Quand voi venir le bel tanz 8c la floqr
Que l’erbe vers refpfen.t aval la pi ée ;,
Lors me fouvient d’une douce dolour
Et dq douz lieu où mes cuers tenc & bee»
(Mon coeur tend & afpirt.)
Plufieurs autres , faites fans doute à la même
époque de l’année , en portent pour ainfi dire l’empreinte
dans les premiers vers ; telles que cèlle-*
c i , qui contient fes vdsux avant de partir pour
Paleftine.
Li nouviau tens, & mais, 8ç vigie te j.
Etrofignoz mi femont de çhancer :
.r, , (M’invitent à)
£t mes fins cuers mi fait d’une amoreKÿ
(Mon tendre coeur)
Si douz préfent, que ne l’os refufer.
Or me dont Dex ep cele henor monter
( Dieu mqpermetn de parvenir d cet honneur )
Que ceje où j’ai mon çueï & mon penfér,
Tienne une fois en--re mes bras nuete
Ainz que j’^iliç outremer.
Il n’eft pas indifférent de voir- la piété de ce
bon chevalier , qui avant que de partir, pour aller
délivrer le tombeau du fils de Dieu , demande à
Dieu la grâce de.commettre un adultère, & c l - e
tenir nue entre fes bras la femme du Seigneur
de Fayel,
G age B seules , que tous les anciens manuf-
crits appellent Mon feigne ur, étoit fans doute un
Chevaliçr diftingiié , & l’aîné d’une maifon illuftre
de champagne , car le titre de Monfeigneur ne fe
donnoit alors qu’aux aînçs de famille , &. aux Chçi
i’ ’ ■ ' t ; - ir c : :