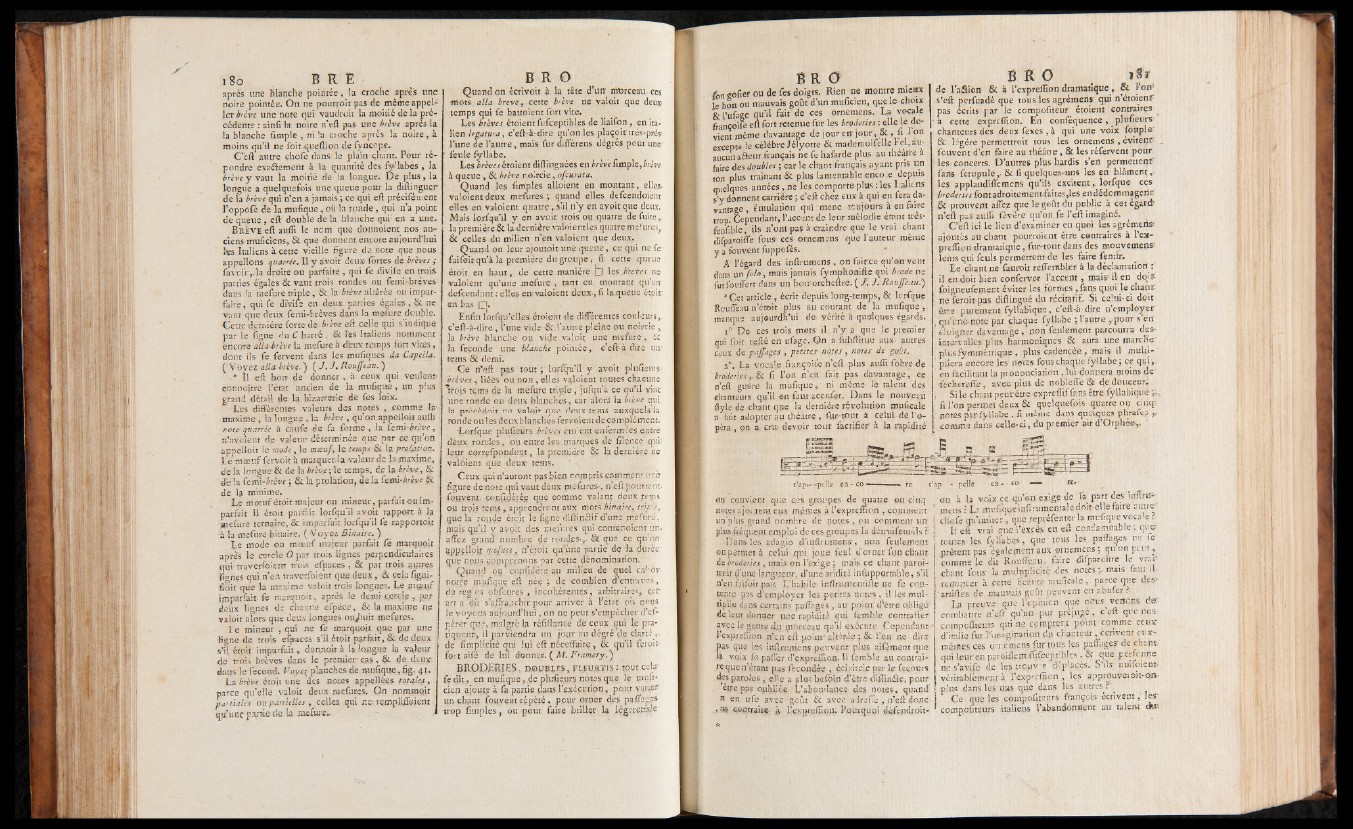
180 B R E
après une Blanche pointée, la croche après une
noire pointée. On ne pourvoir pas de mêmeappei-
le rbrève une note qui- vaudroit la moitié delà précédente
: ainfi la noire n’eft pas une brève apres la
la blanche fiinple, ni !a cioche après la noire, à
moins qu’il ne foit queftion de fyneope..
C ’êft autre, çhofe dans le plain chant. Pour répondre
exactement à la quantité des fplàbes , la
brève y vaut la moitié de la longue. De plus, la
longue a quelquefois une queue pour la diftinguer
de la brève qui n’en a jamais ; ce qui eft préciféiuent
l’oppofé de la mufique, où la ronde , qui n’a point
de queue, eft double de la blanche qui: en a une.
B r è v e eft a u ffi le nom que donnoient nos anciens
muficiens, & que donnent encore aujourd’hui
les Italiens à cette vieille figure de. note que nous
appelions quarrèe. Il y avoit deux fortes de brèves ;
favoiryla droite ou parfaite , qui fe divife en trois
parties égales & vaut trois rondes ou femi-brçves-
dans la mefure triple , & Ja brève altérée ou impar- ;
faite, qui fe divife en deux parues égales , & ne.'
vaut que deux femi-brèves dans la mesure double, j
Cette dernière forte de brève eft celle qui s’iqdiqne
par le ligne du C barré , & lès Italiens nomment •
encore alla-brève la mefure à deux temps fort vîtes , !
donr ils fe fervent dans les mufiques da Capella. ;
(. Vo yez alla brève. ) ( J. J» Rouffeau. )
* Il eft bon de donner , à ceux qui veulent'
çonnojtre Pétât ancien de la mufique, un plus
grand détail de. la bizarrerie de fes loix.
Les.différentes valeurs des not.es , comme la-.’
maxime , la longue , la brève , qu’on appelloit auffi
■ r.otp quarrèe à caufe de fa forme, la {cmi-brève, ■
n’avcient de-valeur déterminée que par ee qu’on 1
appelloit \emode,\c moeuf, le temps & la proljtiçn.
Le moeuf fervoit à marquer la valeur de la maxime, s
de là longue & de la brève ; \e temps, de la brève, & .
dé la femi-brève ; & la prolktion, d elà femi-£rè*re §c
de fa minime.
Le moeuf étoit majeur ou mineur, parfait o.u.im-
parfait I;1 étoit partit, lorfqu'il avoit rapport à lg
mefure ternaire, & imparfait lorfqu’il fe rapportoit
à la mefure binaire. ( Voyez Binaire. )
Le mode ou moeuf majeur parfait fë marquoit
après le cercle O par trois lignes perpendiculaires
qui traverfoient trois efpaces , & par trois autres
lignes qui n’en traverfoient que deux , & cela %ni-
fioit que la maxime valoit trois longues. Le mgzii.f .
imparfait, fe marquoit, après le demLçerxde , par
deux lignes de chaque efpèce, & la maxime ne
valoit alors que deux longues o.ujiuit meffires.
Le mineur , qui ne fe marquoit que par une
ligne de trois efpaces s’il étpit parfait, & de deux
sril étoit imparfait, donnoit à là longue lg valeur
ffe trois brèves dans le premier' ça§, & de detry.
dans le fécond. Foye^ planches dé mufique, fig. 41.
La brè ve étojt une des notes appelées totalef y
parce qu’elle valoit deux rnefures. On nommait
partiales ou pariîelles , .celles qui ne. rçmplifteient
qu’une partie de la mefure...
b R o
Quand on écrivoit à la tête d’un nforceau ces
mots alla brevey cette brève ne valoit que deux
temps qui fe battoient fort vite.
Les brèves étoient fufceptibles de liaifon , en italien
legatura, c’eft-à-dire qu’on les plaçoff très-près1
Tune de l’autre, mais fur différens dégrés pour une1
‘ feule fyllabe.
Les brèves étoient diftinguées en brève fimple,£n;ve
à queue, & brève noircie, ofcurata.
Quand les fimples alloient en montant, elles*
vaîbient deux mefures ;; quand elles defcendoieîit
elles en valoient quatre y slil n’y en ayoitque deux.
Mais lorfqu’il y en avoir trois ou quatre de fuite,,
la première & la dernière valaient les quatre mefures^
& celles du milieu n’en valoient que deux.
Quand on leur ajoutoitune queue, ce qui ne fe'
faifoif qu’à la première du groupe y fi? cette queue
étoit en haut, de cette manière Q 1qs,brèves ne
valoient qu’une mefure , tant en montant qu’en
defcendant : elles en?val©iènt deux, fi laquelle étpir
en. bas |jt.
Enfin lorCqu’elles^étoient de différentes couleurs,,
c’eft-à-dire, l’une vide & .l’autre pleine ou noircie ,
]a brève blanche ou vide valoit une msfûre , &
la fe.conde une blanche pointée, c’eft-à dire lia-
tems & demi.
Ce n’eft pas tout ; lorfqu’il y avoit pîufieiiis-
brèves , liées ou non, elles valoient toutes chacune
trois tems de la mefure triple, jufqu’à ce qu’ il vint
une ronde ou deux blanches, car alors la brève qui
la précédoit ne valgit que deux tems auxquels la
ronde ou les deux blanches fervoiemde complément.
Lorfque piufieurs brèves éto’erit enfermées entre
deux,. rondes, ou entre Les jp arques de .filencç .qitb
leur çorrf fpondegt, la première & la derrière ne
valoient que deux' tems. ' x
Ceux qui n’auront pas |ien ton?pris comment une
figure de note qui vaut deux mefures-, n’eft pourtant*
foijyenjt. çopfidérég que comme valant deux feçîs
ou trgis tems, apprendront aux mots binaire, triple,
que là roji.de ércit le figne diftinélif d’une mefure,
mais qu’i i y avoit des me fi’.res qui conteroient un*
affez grand' nombre de rondes*,, & que ce qu’çin
appelloit mefure, n’ètoij qu’une partie dç la durée
que nous comprenons par cette dénomination.
Quand on cpnfidère au milieu de quel cabos'-
npîfe mu/ique eft péé' ; de combien d’entraves,
de reg es obfèures , incohérentes, arbitraire-;, çctT
art a dû s’affranchirpour arriver à l’état où-noys
le voyons aujourd’hui, on ne petit s’empêcher d’ef-
pérer qitç, malgré l,a réfiftance de ceux qui lé pratiquent,
il parviendra un jôu,r au degré çle clarté ,
de fîmplicité qui lui eft néce{faire, 6c qu’il férpit;
foit aifé de lui donner. ( M. Frameryf)
BRODERIES, doubles , FLyURTis iront cela-
fç dît, en mufique, de pliffienrç notes que le muf1'
cien ajoute à fa partie çjans l'ejtéçuti.oq, po.ur varier
un chant fouyent répété, pour orner des p,aff?-g£s
trop fimples, ou pour faire briller la légcrçtéde
B R 0
(ott eofiet ou de fes doigts. Rien ne montre mieux
Je bon ou mauvais goût d’un muficien, que le-choix
& l ’ufage qu’il fait'de ces ornemens. La vocale
françoife eft fort retenue fur les hroderits : elle le devient
même davantage de jour en jour, & , h 1 on
excepte le célèbre Jélyorte & mademoifelle bel, au-
aucun affceur.français ne fe hafarde plus au théâtre a
faire des doubles ; car le chant français ayant pris un
ton plus traînant & plus lamentable enco-e depuis
quelques années, ne lès comporte-plus îles Lalitns
s’ydonnent carrière ; c’eft chez eux à qui en fera davantage
, émulation qui mene tcujours a en faire
trop. Cependant, l’accent de leur mélodie étant très-
fenfble, ils n’ont pas à craindre que le vrai chant
difparoifle fous- ces ornemens que 1 auteur , même
y a fouvent fuppofés.
A l’ égard des inftrumens , on fairce qu’on vent
dans un foie, mais jamais fymplionifte qui brode ne
futfouffert dans un borf orcheftre. ( f . J. Rouffeau.)
* Cet article, écrit depuis long-temps, & lcrfqne
Rouffeau n’étoit pins au courant de la mufique,
manque aujsurdh’ui de vérité à queèques égards.
i° D e ces trois mot? il n’y a que le premier
api (pit refté en ufage. On a fubftifué aux- autres
Ceux de'f’ujfuges , petites^ notes , notes de goût.
a‘ . La vocalp françoife n’eft plus auffi fofcre de
broderiesr&L ft l’on n’en fait pas davantage, ce
n’eft guère la mufique, ni même l’e talent des
chanteurs qu’il e-n fout sectffor. Dans le nouveau
ftyle de chant qpe la dernière révolution muficalc
a fait adopter au théâtre , fur-tout à celui de l’o-
géra, çn a crm devoir tout fâcrifier à la rapidité'
t’a.pï—.pelle ea r co — re t’
OB' convient que ces groupes de quatre ou cinq
nçues r.jai tent eux mêmes à l’expreflîon . .çommtnt
un'pliis grand nombre de notes , pu conimeji; lin
plus fréquent emploi de ces groupes la détruifent-ils |
Dans les. adagio d’inftriunens’ , non feulement
on permet à celui .qui joue feul d’orner fon chant
de broderies , mais- on l’exige ; mais ce chant paroi--
tr.oit d’une langueur, d’une aridité infupportable , s’il
n’en faifoit pas’. L’habile inftmmentifte ne fe çojc-
tç.nte pas d’employer les petites notes , il les multiplie
chas certains paftrges ,.au point d'être obligé'
de.leur donner une rapidité qui fen?ble contrafter
avec k genre morceau qu’il exécute Cependant
Fexpreffion n’en eft point' altérée ; & l’on' ne dira-
pas que les inftruniens peuvent plus aifément que
k vojx fe pafier d’expreffioa. Il femble au contraire
que n’étant pas ftcondée | éclaircie par le fecours
des paroles , elle a plus befbin d’çlrè cKftinâe, pour
etre pas oubjÿée. L’abondance des notes, quand
H en ufe avec goût & avec aireffe , n’eft donc-
contraire. l’cxpreffioA* Pourquoi dé/tndroit-'
B R 0 . if*
de l ’aSion & à l’expreffion dramatique, & P««**
s’eft perfeadé que tous les agrémens1 qui n etoienf
pas écrits par le compofiteur étoient contraires
à cette exprrfïion. En conféquence, pliifieurs
chanteurs des deux fexes , à qui une voix fouple’
& légère permettrait tous les ornemens , évitent? .
fouvent d’en faire au théâtre, & les réfervent pour
les- concerts. D’autres plus hardis s’en permettent"
fans fcrupule,. & fi quelques-uns les en- blâment,,
les applaudiftèmens qu’ils excitent, îorfq-ue ces
; broderies font adroitement-faites,les en dédommagent?
& prouvent affez que le goût du public a cet égard?
ffeft pas auffi févère qu’on fe l’eft imaginé.
C ’eft ici le lieu d’examiner en quoi les agrémetisP
ajoutés ail chant pourroient être contraires à l’ex-
preffiûn dramatique, fur-tout dans des mouvement
lents qui feuls permettent de les faire feniir.
Le chant ne fauroil reffembler à la déclamation'
il en doit bien conferyer l’accent, mais il en do.it?
foigne ufe ment éviter les formes ,fans quoi le chante
ne ferait.pas diftine-ué du récitatif. Si celni-ci doit
êt.’« purement fyllaSique, c’eft-à-dire n’employer
, qu'bne-note par chaque fyllabe ; l'autre ,ponr s’en
' é!oi»ner davantage, non feulement parcourra des-
intea-alles plus harmoniques 5c aura une marcha1
plusfymmérriqne , plus cadencée, mais il muUi-
I pilera encore les nêtès fous chaque fyHabe; ce qui,,
e-n^'-facilitant la prononciation , lui donnera moins de
fèchereffe, a v * plus dé neblèffe S de douceur.'
, Si le cüant'peorêtre- expreffîf (ans être fyllabiqne j .,
fi l’on permet deux & quelquefois quatre oi-i cinq?
notes parifyllabe. fi même dam quelques phrafes »,
cornais dans celle-ci, du premier air d’Orphéeç,
ap - pelle ea - £0 •_ii— 1
on a U voix çç Qii’ôn exige dé là pàrr des inftrit»'
mens ? La unifiqyeiaftruraemaledoit-elle faife.siitre'
cHg.fe qu iwmr , q.u.e repréfenter la mufique vocale ?-
L! eft vrai que l’excès en eft condamnable ; que;
tcute.s les fyllabçs, que tous les paftages ne fe
prêtent pas éga.leînenf aux ornemens; qu’on peut ,
comme le dit Bo.uffe.au , faire difparoître le vrai’
chant (bus- La multipU-oite .des notes. mais faut-il-
; ren'oncçr à cette' beauté ni un cale, parce que des-’
’ artiftes de mauvais gçyt peuvent en abufer ?-
La preuve qtfe l’opinion qqe nCiis^ venons
combattre ff<ft qu’un pur préjuge, c eft que nos -
compofiteurs qui ne'comptent point comme'ceux*
d’iraüe fur l’irp^ination dp chanteur ^écrivent çux-
mêifies ces orr.emens furtous les paftages' de clianf
qui leur en paroiftem ffifcepf.bles, & que perfe une
ne s’aviie de les trpyv t déplacés. S’ils1- nuifoient-
véritablement à ' l’expfeffion , les approuveroit- qix-
plus dans les ü»s que dans les autres?’^
Ce que les compofiteurs françois' écrivent, les
co-mp.ofiteurs italiens l’abandonnent au talent ckp