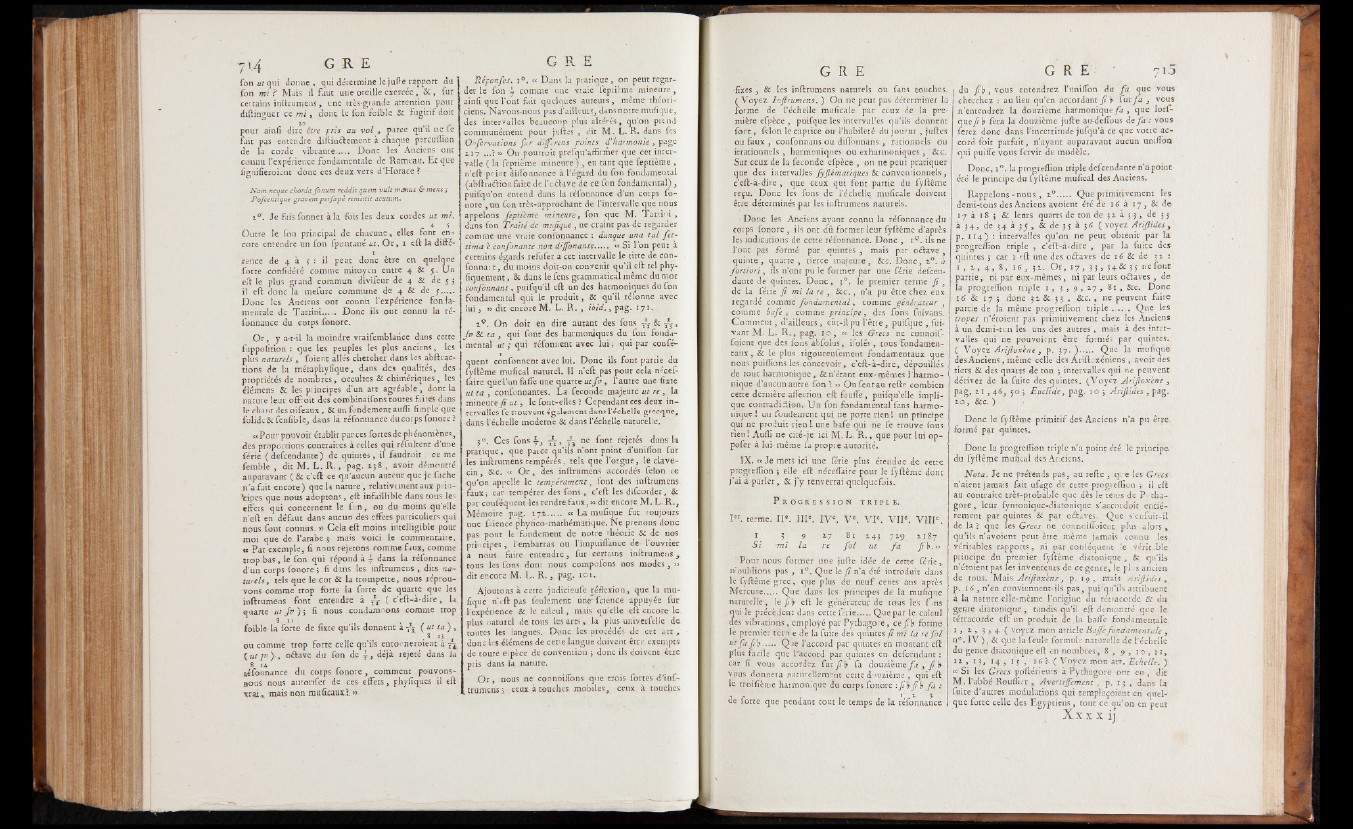
fon a; qui donne , qui détermine le jufle rapport du
Ton mi? Mais il faut une oreille exercée, 8c, fur
certains inltrumens, une très-grande attention pour
diûinguer ce m i, dont le fon foible & fugitif doit
pour ainfî dire être pris au vol > parce qu il ne le
fait pas entendre diftiuétement à chaque per eu filon
de la corde vibrante...... Donc les Anciens ont
connu l’expérience fondamentale de Rameau. Et que
fignifieroient donc ces deux vers d’Horace?
Nam n.eque chorda fonum rtdd.it quem vult mdnus & mens ;
Pofcentique gravem perftepè remiitit acutum.
i ° . Je fais fonner à la fois les deux cordes ut mi.
Outre le fou principal de chacune, elles font encore
entendre un fon fpentané ut. O r , i eft la différence
de 4 à y : il peut donc être en quelque ;
forte confîdéré comme mitoyen entre 4 & 5. Un j
eft le plus grand commun divifeur de 4 & de 5 5 !
il eft donc la mefure commune de 4 & de 5 ...... .<
Donc les Anciens ont connu l'expérience fon.la- j
mentale de Tartini..... Donc ils ont connu la ré-
ionnance du corps fonore.
O r , y a-t-il la moindre vraifemblaiice dans cette
fuppofition : que les peuples les plus anciens, les
plus naturels , foient allés chercher dans les abftrac- j
tions de la mécaphyfîque, dans des qualités, des ;
propriétés de nombres, occultes 8c chimériques, les ]
élémens & les piincipes d'un art agréable, dont la
nature leur offroit des combinaifons toutes faires dans
le chant des o ifeaux, & un fondement aufïi fimpleque
folide 8c fenfïble, dans là réfonnance du corps fonore ? ,
«Pour pouvoir établir par ces fortes de phénomènes,
des proportions contraires à celles qui réfultent d’une
férié ( defeendante) de quintes, il faudroit , ce me
femble , dit M . L . R . , pag. 2 5 8 , avoir démontré
auparavant ( & c’cft ce qu'aucun auteur que je fâche
n ’a fait encore) que.la nature, relativement aux principes
que nous adoptons, eft infaillible dans. tous.les
effets qui concernent le fo n , ou du moins qu’elle
n’eft en défaut dans aucun des effets particuliers qui
nous font connus.» C e la eft moins intelligible pour
moi que de l’arabe ? mais voici le commentaire.
« Par exemple, fi nous rejetons comme faux, comme
trop bas , le fon qui répond à dans la réfonnance
d’un corps fonore ; fi dans les inftrumens , dits naturels,
tels que le cor & la trompette, nous réprouvons
comme trop forte la forte de quarte que les
inftrumens font entendre à ( c’ eft-à-dire,, la,
quarte ut J v j i fi nous condamnons comme trop
foible la forte de fixte qu’ils donnent à ~ (ut ta ) , .
. 8 'XV Z
©u comme trop forte celle qu’ils entocneroient à 7^
{u t jv y , oébave du fon de | j | déjà rejeté dans la
téfonnance du corps fon ore , comment pouvons-
sous nous autorifer de ces effe ts , phyfîques il eft
vrai ». mais non njuficauxJ. »
Réponfcs. i° . ec Dans la pratique, on peut regarder
le fon ~ comme une vraie feptième mineure,
ainfî que l’ont fait quelques auteurs, même théoriciens.
Navons-nous pas d’ailleurs, dans notre mufique,
des intervalles beaucoup plus altérés, qu’on prend
communément pour juftes , dit M. L. R. dans les
| Obfervations fur dijfzrens points d’harmonie , page
217 ...? » On pourroit prefqu’alfirmer que cet intervalle
( la feptième mineure) , en tant que feptième ,
n’eft peint dilîonnance à l’égard du fon fondamental
(abftraélion faite de i’cétave de ce fon fondamental) ,
puifqu’on entend dans la réfonnance d’un corps fonore
, un fon très-approchant de l’intervalle que nous
appelons feptième mineure, fon que M. Tartini,
; dans fon Traité de mufique, ne craint pas de regarder
| comme une vraie conlonnance : dunque una tal fetï
tima è confondnte non diffonante...... ce Si 1 on peut à
certains égards refufer à cet intervalle le titre de con-
fonnai.t, du moins doit-on convenir qu’il eft tel phy-
fiquement, & dans lefens grammatical même dumoc
confondant, puifqu’il eft un des harmoniques du fon
fondamental qui le produit, 8c qu’il réfonne avec
lu i, »3 dit encore M . L. R . , ibid. , pag. 171.
20. On doit en dire autant des fons ~ ~ ,
Jv 8c ta , qui font des harmoniques du fon fondamental
ut} qui réfonnent avec lui ; qui par conféquent
confonnent avec lui. Donc ils font partie du
fyftême mufîcal naturel. Il n’eft pas pour cela nécef-
faire que l’un faffe une quarte ut fa , l’autre une fixte
ut ta , confonnantes. La fécondé majeure ut re, la
mineure fi u t , le font-elles ? Cependant ces deux intervalles
fe trouvent également dans l’échelle grecque >
dans l’échelle moderne & dans l’échelle naturelle.
3 °. Ces fons 7 , 77 » r% ne font rejetés dans la
pratique, que parce qu’ils n’ont point d’uniffon fur
les inftrumens tempérés, tels que l’orgue, le clavecin,
&c. « O r , des inftrumens accordés-félon ce
qu’on appelle le tempérament, font des inftrumens
faux; car tempérer des fons , c’eft les difeorder, &
par conféqucnt les rendre faux, 33 dit encore M. L. R .,
Mémoire pag. 172..... « La mufique fut toujours
une feience phyfico-mathématique. Ne prenons donc
pas pour le fondement de notre théorie & de nos
principes, l’embarras ou l’impuiffance de l’ouvrier
à nous faire entendre, fur certains inftrumens,
tous les fons dont nous compofons nos modes, 39
dit encore M. L. R . , pag. 101.
Ajoutons à cette judicieufe réflexion, que la mufique
n’eft pas feulement une' fcience appuyée fur
Inexpérience & le calcul, mais qu’elle eft encore le
plus naturel de tous les arts,; la plus univerfelle de
toutes les langues. Donc les procédés de cet art ,
donc les élémens de cette langue doivent être exempts
de toure elpèce de convention j donc ils,doivent être
pris dans la naturei
O r , nous ne connoiffons que trois fortes d’inf-
.tr.umcns 5, ceux. à.touches mobiles,, ceux, à toucha
•fixes, & les inftrumens naturels ou fans touches.
( V o y e z Inftrumens. ) On ne peut pas déterminer la
forme de l’échelle muficale par ceux de la première
efpèce , puifque les intervalles qu’ils donnent
fo n t , félon le caprice ou l’habileté du jou eur, juftes
ou faux , confonnans ou diffonnans , rationnels ou
irrationnels , harmoniques ou exharmoniques, &c.
Sur ceux de la fécondé elpèce , on ne peut pratiquer
que des intervalles fyftématiques 8c conventionnels,
c’eft-à-dire, que ceux qui font partie du fyftême
reçu. Donc les fons de l’échelle muficale doivent
être déterminés par les inftrumens naturels.
•Donc les Anciens ayant, connu la réfonnance du
corps fon ore , ils ont dû former leur fyftême d’après
les indications de cette réfonnance. Donc , i Q. ils ne
l ’ont pas formé par quintes , mais par oéfave y ,
quinte , quarte , tierce majeme , &c. D on c, 20. à
fortiori, ils n’ont pu le former par une férié defeendante
de quintes. Donc , 30. le premier terme f i 3
de la férié f i mi la re , Sec., n’a pu être chez eux
regardé comme fondamental» comme générateur ,
comme bafe , comme principe, dis fons fuivans.
Commenti d’ailleurs, eûc-ilpu l’ê tre, puifque , fui-
vant M. L . R . , pag. 1 0 , « les Grecs ne connoif-
foient que des fons abfolus, if oies, tous Fondamentaux
, & le plus rigoureufement fondamentaux que
nous puiffions les concevoir , c’eft-à-dire, dépouillés
de tout harmonique, & n'étant eux-mêmes l ’harmonique
d’aucun autre fon ? 33 On fent au refte combien
cette dernière aflèreion e f tfa u ffe , puifqu’elle implique
contradiffion. U n fon fondamental fans harmonique
! un fondement qui he porte rien 1 un principe
qui ne produit rien!.une bafe qui ne fe trouve fous
rien 1 Aufii ne eicé-je ici M . L. R . , que pour lui op-
pofer à lui même fa propre autorité.
IX. « Je mets ici une férié plus étendue de cette
progreffion } elle eft néceflaire pour le fyftême dont
j’ai à parler, & j’y renverrai quelquefois.
P r o g r e s s i o n t r i p l e .
Ier. terme. I I e. I IIe. I V e. V e. V I e. V I I e. V I I I e.
1 5 9 2 - 7 8 1 243 729 2187
S i -mi la re fo l ut fa fi\y. n
Pour nous former une jufte idée de cette férié,,
troublions pas , i ° . Que le fi n’a été introduit dans
le fyftême g re c , que plus de neuf cents ans après
Mercure...... Que dans les principes de la mufique
naturelle', le fi]) eft le générateur de tous les fons
qui le précèdent dans cette férié.,... Que par le calcul
des vibrations, employé par Pythagore, ce fi [> forme
le premier terme de la fuite des quintes fi mi ta re fo l
ui fa fi]y...... Que l’accord par quintes eh montant eft
plus facile que l’accord par quintes en defcéndant :
car fi vous accordez fur fi\> fa douzième fa ' , f i b-
vous donnera naturellement cette douzième , qui eft
le troifîème harmonique du corps fonore : fi k fi b fa :■
de forte que pendant tout le temps de la réfonnance
du fi]> j vous entendrez l’uniffon du fa que vous
cherchez : au lieu qu’en accordant fi b- fur fa , vous
n’entendrez la douzième harmonique fa , que lo rsque
fi \> fera la douzième jufte au-deffous de fa : vous
ferez donc dans ^incertitude jufqu’à ce que votre accord
foit parfait, n’ayant auparavant aucun unifloa
qui puiffe vous fervir de modèle.
Donc, i ° . la progieftion triple defeendante n’a point
été le principe du lyftême mufîcal des Anciens.
Rappelons - nous, 20...... Que primitivement les
demi-tons des Anciens avoient été de 1 6 à 1 7 , & de
>17 à 18 ; & leurs quarts de ton de 32 à 3 3, de 33
à 34, de 34 à 3y , & de 35 à 36 ( voyez Ariftides,
p. 114) : intervalles qu’on ne peut obtenir par la
progrelïïon triple , c’eft-à-dire , par la fuite des
quintes 5 car 1 eft une des oétaves de 16 & de 3 2 :
1 , 2 , 4 , 8, 16 , 32. O r , 17 , '3-3, 3 4 & 5 y. ne font
partie, ni par eux-mêmes, ni par leurs odaves , de
la progreffion triple 1 , 3 , 9 , 1 7 , 81, &c. Donc
1 6 8c 17 j donc 3 2 8g 3 3 , & c ., ne peuvent faire
partie de la même progreffion triple ...... Que les
tropes n’étoient pas primitivement chez les Anciens
à un demi-ten les uns dès autres , mais à des intervalles
qui ne pouvpient être formés par quintes.
( V o y e z Ariftoxène, p. 3 7 . ) ...... Que la mufique
des Anciens, même celle des Ariftoxeniens , avoit des
tiers & des quarts de ton 5 Intervalles qui rie peuvent
dériver de la fuite des quintes. (Voyez Ariftoxène ,
pag. 21 , 46, 50 5 Euclide, pag. 10 } Ariftides , pag.
20 , 6cc. )
Donc le fyftême primitif des Anciens n’a pu être
formé par quintes.
Donc la progreffion triple n’a point été le principe
du fyftême mufical des Anciens.
Nota. Je ne prétends pas , au refte , qi-e les Grecs
n’aient jamais fait ufage de cette progreffion ; il eft
au contraire très-probable que dès le teins de P' tha-
gore, leur fynronique-diaroniquc s’accordoit entièrement
par quintes 8c par oéfoves. Que s’enfuit-il
de là 1 que les Grecs ne connoiuoient plus alors ,
qu*ils n’avoient peut être même jamais connu les
véritables rapports, ni par conféquenc le véritable
principe du premier fyftême diatonique, & qu’ils
n’étoient pas les inventeurs de ce genre, le plof, ancien
de tous. Mais Ariftoxène, p. 19 , mais Ariftides,
p. 16 , n’en conviennent-ils pas, puirqu’ils attribuent
à la nature elle-même l’origine du tétr-acorde & du
genre diatonique, tandis qu’il eft démontré que le
tétracorde eft un produit de .la baffe fondamentale
1 , 2 , 3 ,4 ( voyez mon article Baffe fondamentale ,
n°. IV ), & que la feule formule naturelle de l’échelle
du genre diatonique eft en nombres, 8 , 5 , 10, 11,
1 2 , 1 3 , 1 4 , 1 5 , r 6 1 ( Voyez mon art. Echelle. )
cc Si les Grecs poftérieurs à Pythagore ont eu, dit
M. l’abbé Rouflicr , Avertiffement , p. 13•, dans la
fuite d’autres modulations qui remplaçoient en quelque
forte celle des Egyptiens, tout ce qu’on en peu?