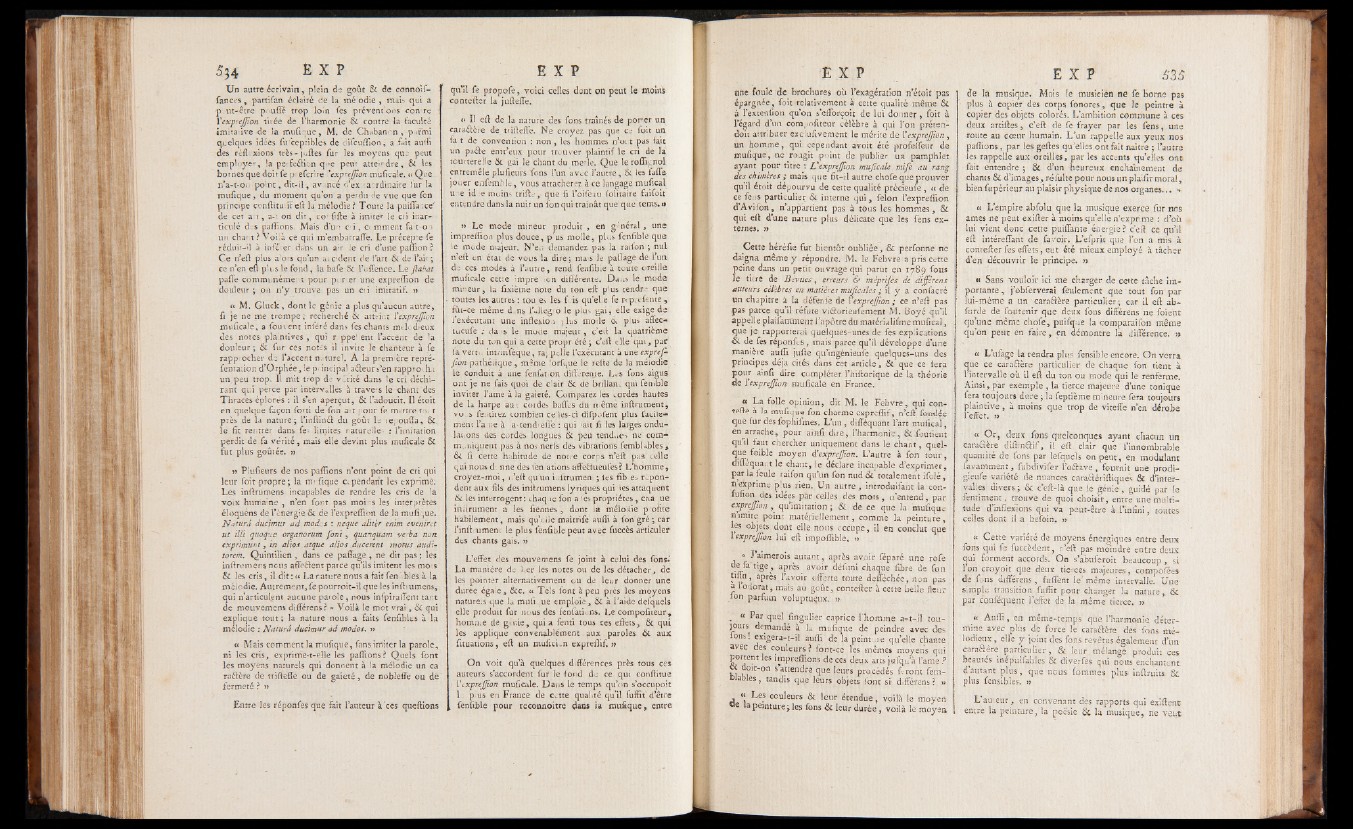
Un autre écrivain, plein de goût & de connoif-
fan ce s, partifan éclairé de la mé'odie , mais qui a
■ p ut-être pouffé trop loin fes préventions con re •
YexpreJJîon tirée de l’harmonie & contre la faculté
imitative de la m u fin ie , M. de Chabanrn , p-irmi
quelques idées fu'cepribles de difcuffioo 3 a fait aufft
des réflexions très-juftes fur les moyens que peut
emp loye r, la perfeéiion q<»e peut atteindre, & les
bornes que doit fe pi eferire ’exprejfion.muficale. « Que
n’a-t-on poin t, dit- il, av.n cé d’ex atrdinaire fur la
mufique, du moment qu’on a perdu de vue que fon
principe conflitu iïe ft la mélodie? Toute la puiffa-.ce'
de cet a r t , a-t ort d i t , c e f fte à imite»- le cri inarticulé
d-s pallions. Mais d’un-c i , et minent r a t -o i
un chant ? V o u a ce qui m’embarraffe. Le précepte fe
réduit-il à inférer da’ns un air le cri d’une paflion ?
C e n’eft plus a’ors qu’un a ce; dent de l’art & de l’air ;
ce n’en eft plus le fon d, la bafe &C l’e.ffence. Le Jlabat
paffe communément pour por er une expreflion de
douleur ; on n’y trouve pas un ci i imitatif. ?>
a M. G lu ck , dont le génie a plus qu’aucun autre,
fi je ne rue tromp e; recherché & atteint Yexprejfion
muficale, a fouvent inféré dans fes chants mélodieux
des notes plaintives, qui r ppe1 ent l’accent de la
douleur ; &. fur ces notes il invite le chanteur à fe
rapprocher dè l’accent naturel. A la première repré-
féntaiion d ’Orp hée, le p incipal aéleurs’en rapprocha
un peu trop. Il mit trop de vérité dans le cri déchirant
qui perce par intervalles à travers le chant des
Thraces éplorés : il s’en aperçut, & l’adoucit. Il étoit
en quelque façon forti de fon art pour fe mettre toi t
près de la nature; i’inftinél du goût le lepouflâ, & .
le fit rentrer dans fes linjites naturelles : l’imitation
perdit de fa v é r ité , mais elle devint plus muficale &
fut plus goûtée. »
» Plufieurs de nos pallions n’ont point de cri qui
leur foit-propre; la m; fique cependant les exprimé;
Les inftrumens incapables de rendre les cris de la
vo ix humaine , n’en font pas moins les interprètes
éloquéns de l’énergie & de l’exprefîion de la mufique.
N attira ducimur ad modes : neque aliter enim eveniret
ut illi quoque organorum font, quanquam ve ba non
exprïmunt, in altos atque altos durèrent motus atidi-
torem. Quintilien , dans ce paffage, ne dit pas ; les
inftrumens nous affeélent parce qu’ils imitent les mots
& les cris, il dit : u La rature nous a fait fen -blés à la
mélodie. Autrement, fe pourroit-il que les inftrumens,
qui n’articulent aucune parole, nous infpiraffent tant
de mouvemens différens? » Voilà le mot v ra i, & qui
explique tout ; la nature nous a faits fenfibles à la
mélodie : Naturâ ducimur ad modos. »
« Mais comment la mufique, fans imiter la parole,
ni les cris, exprime-t-elle les pallions? Quels font
les moyens naturels qui donnent à la mélodie un ca
raélère de trifteffe ou de g a ie té , de nobieffe ou dé
fermeté ? n
Entre les réponfes que fait l’auteur à'ces queftions
qu’ il fe propofe, voici celles dont on peut le moins
contefter la jufteffe.
« Il eft de la nature des fons traînés de porter un
caractère de tiifteffe. Ne croyez pas que ce foit un
fa t de convention : non , les hommes n*ot t pas fait
un paéle entr’eux pour trouver plaintif le cri d e là
tourterelle &L gai le chant du merle. Qu e le roflignol
entremêle plufieurs fons l’un avec l’autre, & les faffe
jouer enfemblè, vous attacherez à ce langage mufical
u -e id e moins t r ille , que fi l’oifeau folitaire faifoit
entendre dans la nuit un fonquitrainât que'que tems.i»
» L e mode mineur p ro d u it , en g 'n é r a l, une
imprefiion plus douce, p us molle, plus fenfible que
le mode majeur. N ’en demandez pas la raifon ; nul
n’eft en état de vous la dire ; m a s le pallage de l’un
de ces modes à l’autre, rend fenfible à toute oreille
muficale cette împre on différente. Daus le mode
mineur, la fixième note du ton eft p'us tendre que
toutes les autres : tou es les f .is qu’elle fe r-.pr«.fente ,
fût-ce même d^ns l’<dlegro le plus g a i, elle exige de
l’exécutant une inflexion j lus mode d plus affec-
tueufe ; da is le mode majeur, c’eft la quatrième
note du ton qui a cette propr été ; c’eft elle qm , par
fa vert», intrinfèque, ra;. pelle l’exécutant à une exprefi
Jïon-pathétique, même lorfque le relie de la mélodie
le conduit à une l’enfat.on différence. Les fons aigus
ont je ne fais quoi de clair 8c de brillam qui femble
inviter l’ame à la gaieté. Comparez les cordes hautes
de la harpe au>: cordes baffes du n ême inftrument,
vous fentirez combien ce les-ci difpofent plus facilement
l’ame à a-tend.-elfe : qui \ait fi les larges ondulations
des cordes longues & peu tend.ie> ne com-î
m..niquent pas à nos nerfs des vibrations femblables ,
8c fi cette habitude de notre corps n’eft pas celle
qui nous d nne des fen ations affeétueufeis? L ’homme,
croyez-moi, u’eft qu'un L.ftrumen:.; les fib e» répon-
denr aux fils des inftrumens lyriques qui les attaquent
& les interrogent: chaq je fon a les propriétés, ena ue
inilrument a les fiennes , dont ‘a mélodie p ofite
habilement, mais qu’elle maîtrife aulîi à Ion gré ; car
l’inft: umeni le plus fenfible peut avec fuccès articuler
des chants gais, ??
L’effet, des mouvemens fe joint à celui des fbns^
La manière de f e r les notes ou de les détacher, de
: les pointer alternativement ou de leur donner une
durée éga le, & c . « Tels font à peu près les moyens
nature;s que la muii ue emploie, 8c à l ’aide defquels
elle produit fur nous des fenfatiuns. Le compofiteur-*
homme de génie, qui a fenti tous ces effets, & qui
les applique convenablement .^ux paroles 8c aux
fituations, eft un muficLn exprellif. »
O n vo it qu’à quelques différences près tous ces
auteurs s’accordent fuir le fond do ce qui conftitue
/ YexpreJJîon muficale. Dans le temps qu’on s’occupoit
1 p us en France de cette qualité qu’il fuffit d’être
i fenfible pour reconnoître dans ia mufique, entre
une foule de brochures ou l’exagération n'étoit pas
épargnée, foit relativement a cette qualité même &
à l’extenfion qu’on s’efforçoit de lui donner, foit à
l’égard d’un corapofiteur célèbre à qui l’on préten-
doit attribuer exclufivement le mérite de l'exprejfion,
un homme, qui cependant avoit été nrofeffeur de
mufique, ne rougit point de publier un pamphlet
ayant pour titre : L ’exprejfion muficale mifie au rang
des chimères ; mais que fit-il autre chofe que p rouver
qu’il étoit dépourvu de cette qualité précieufe , « de
ce fens particulier & interne q u i, félon l’exprefiion
d’A v ifon , n’appàrtient pas à tous les hommes , &
qui ell d’une nature plus délicate que les fens externes.
?>
Cette héréfie fut bientôt oub lié e , & perfonne ne
daigna même y répondre. M. le Febvre a pris cette
peine dans un petit ouvrage qui parut en 1789 fous
le titre de JBevues, erreurs & méprijes de différens
auteurs célèbres en matières muficdles ; il y a confaçré
un chapitre à la défenfe de YexpreJJîon ; ce n’eft pas
pas parce qu’il réfute viélorieufement M. Boy é qu’ il
appelle plaifam'ment l’apôtre du matérialifme mufical,
que je rapporterai quelques-unes de fes explications
& de fes reponfts , mais parce qu’il développe d’une
manière aulîi jufte qu’ingénieufe quelques-uns des
principes déjà cités dans cet artic le , & que ce fera
pour ainft dire compléter l’hiftorique de la théorie
de YexpreJJîon muficale en France.
u L a folle opinion, dit M . le F eb v re , qui con-
tefte à la mufique fon charme expreffif, n’eft fondée
que fur des fophifmes. L ’un , difféquant l’art mufical,
en arrache, pour ainfi dire, l’harmonie, & io u tien t
quil faut chercher uniquement dans le ch an t, quel-
que foible moyen d’exprejfion. L ’autre à fon tou r ,
difféquant le chant, le déclare incapable d’exprimer,
par la feule raifon qu’un fon nud 8c totalement ifo lé ,
n exprime p'us rien. Un au tre , introduifant la con-
fufion d,es idées par celles des mots , n’entend, par
exprejfion ^ qu’imitation ; & de ce que la mufique
n imite point matériellement, comme la peinture,
les objets dont elle nous cc cu pe, il en conclut que
\ exprejfion lui eft impoflible, »
« J aimerois autant, après avoir féparé une rofe
de fa t ig e , après avoir défuni chaque fibre de fon
tiffu , après l’avoir offerte toute defféchée, non pas
a 1 odorat, mais au g oû t, contefter à cette belle fleur
fon parfum voluptueux.: »
. “ Par J|t|î fingulier caprice l'homme a - t- il toujours
demandé à la mufique de peindre avec des
Ions! exigera-t-il aulîi de la peint ue q u e lle chante
avec des couleurs ? font-ce les mêmes moyens qui
portent les impreflions de ces deux arts julqu’à l’arne ?\
doit-on s attendre que leurs procédés f ront fem-
olables, tandis que leurs objets font si différens? »
« Les couleurs & leur étendue, voilà le moyen
c e la peinture ÿ les fons & leur du rée, voilà le moyen
de la musique. Mais le musicien ne fe borne pas
plus à copier des corps fonores, que le peintre à
copier des objets colorés. L’ambition commune à ces
deux artiftes, c’eft de fe frayer par les fen s, une
route au coeur humain. L ’un rappelle aux y e u x nos
pallions, par les geftes qu’elles ont fait naître ; l’autre
les rappelle aux oreilles, par les accents qu’elles ont
fait entendre ; & d’un heureux enchaînement de
chants & d’images, réfulte pour nous un plaifir moral,
bien fupérieur au plaisir physique de nos organes... »
« L ’empire abfolu que la musique exerce fur nos
âmes ne peut exifter à moins qu’elle n’exprime : d’où
lui vient donc cette puiffante énergie ? c’eft ce qu’ il
eft intéreffant de fa voir. L ’efprk que l’on a mis à
contefter fes effets, eut été mieux employé à tâcher
d’en découvrir le principe, n
« Sans vouloir ici me charger de cette tâche importante,
j’obferverai feulement que tout fon par
lui-même a un carqélère particulier ; car il eft ab-
furde de fou tenir que deux fons différens ne foiertt
qu’une même ch ofe, puifque la comparai fon même
qu’on peut en fa ire , en démontre la différence.
« L ’tifage la rendra plus fensible encore. On verra
que ce cara&ère particulier de chaque fon tient à
l’intervalle où il eft du ton ou mode qui le renferme.
Ains i, par exemple , la tierce majeure d’une tonique
fera toujours dure ; la feptième mineure fera toujours
plain tive, à moins que trop de vîteffe n’en dérobe
l’effet. »
u O r , deux fons quelconques ayant chacun un
caractère diftin&if, il eft clair que l'innombrable'
quaniite de fons par lefquels on peu t, en modulant
favamment, fu bdivife rToé là ve, fournit une prodi-
gieufe variété de nuances caraétériftiques & d’intervalles
divers ; & c’eft-là que le g én ie , guidé par le
fentiment, trouve de quoi choisir, entre une multitude
d’inflexions qui v a peut-être à l’infini, toutes
celles dont il a befoin. »
a Ce tte variété de moyens énergiques entre deux
fons qui le fuccèdent, n’eft pas moindre entre deux
qui forment accords. On s’abuferoit beaucoup , si
Ion croyoit que deux tierces majeures, compoféts
de fons différens, fuffent le^ même intervalle. Une
simple transition fuffit pour changer la nature, &
par conféquent l’effet de la même tierce, n
« Auffi,. en même-temps que l’harmonie détermine
avec plus de force le caraélëre des fons mélodieux
, elle y joint des fons revêtus également d’un
caraâere particulier, & leur mélange produit ces
beautés inepui labiés & d'i ver fes qui nous enchantent:
dautant p lu s , que nous fommes plus inftruits 8c
plus fensibles. »?
L ’auieur, en convenant des rapports qui exiftent-
entre la peinture, la peësie 8c la musique, ne v eu t