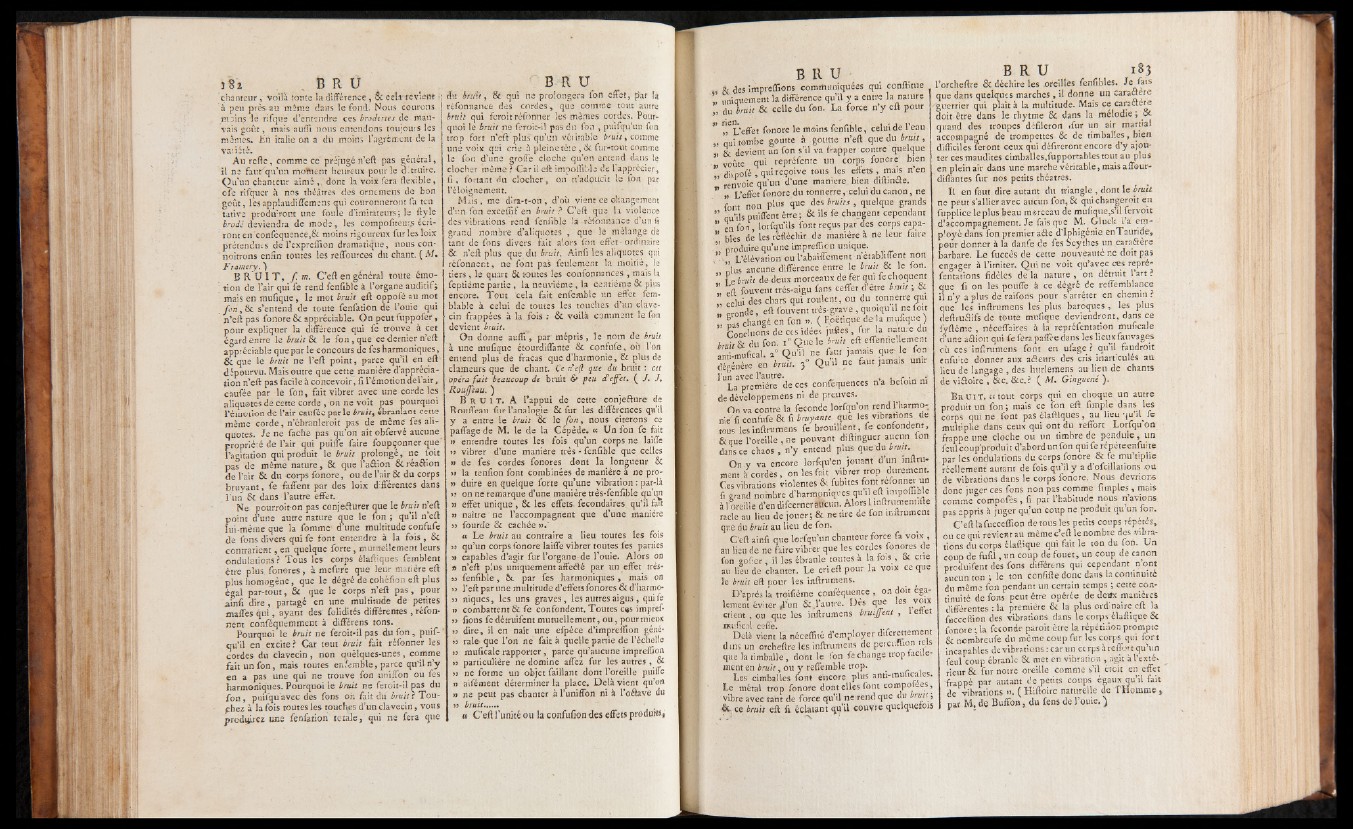
j 81 . B R U
chanteur, voilà toute la différence, êc cela- revient <;
à peu près au même dans le fond. Nous courons
mnins le rifque d’entendre ces broderies de mauvais
goût, mais suffi nous entendons tou?ours; les
mêmes. Ën italiè on a du moins l’agrément de la
va!iété. ' ; . I \ .
Au relie, comme ce préjugé n’eft pas général,
il ne faut'qu’un moîlient heureux pour le d.truire.
Q u ’un chanteur aimé ,, dont la voix fera flexible,
ofe rifqucr à nos théâtres des orne mens de bon
goût, lesapplaudiffemens qui couronneront fa ten
tative prodivront une foule d’imitateurs; le flyle
brodé deviendra de mode, les compofiteur^s écriront
eii'confèquence,& moins rigoureux fur les loix
prétendues de l’expréffion dramatique, nous con-
noîtrons enfin toutes les reffources du chant. ( M.
Framery.}
B R U I T , f . m. C ’eft en général toute émotion
de l’air qui fe rend fenfible à l’organe auditif;
mais en mufique, le mot bruit eft oppofé au mot
[on, & s’entend de toute fenfatiOn de l’ouie qui
n’eft pas fonore & appréciable. On peut fuppofer,
pour expliquer la différence qui fe trouve à cet
égard entre le bruit 8c le fo n , que ce dernier n’eft
appréciable que par le concours de fes harmoniques,
& que le bruit ne l’eft point, parce qu’il en eft
dépourvu. Mais outre que cette manière d’appréciation
n’eft pas facile à concevoir, fi l’émotion de l’air,
cftufée par le fon, fait vibrer avec une corde les
aliquotes dé cette corde , on ne voit pas pourquoi
l’émotion de l’air caufée par le bruit, ébranlant cette
même corde, n’ébranleroit pas de même' fes ali-
qubtes. Je ne fâche pas qu’on ait obfervé aucune^
proprié:é de l’air qui puiffe faire foupçonner que
l’agitation qui produit le bruit prolongé, ne foit
pas de même nature, & que l’aftion & réaâion
de l’air & du corps fonore, ou de l’air & du corps
bruvant, fe faffent par des loix différentes dans
Tun & dans l ’autre effet.
Ne pourroit-on pas conjeélurer qùe le bruit n’eft
point d’une autre nature que le fon ; qu’il n’eft
lui-même que la fomme d’une multitude confufe
de fons divers qui fe font entendre à la fo is , &
contrarient, en quelque forte, mutuellement leurs
ondulations? Tous les corps élaftiques femblent
être plus fonores, à mefurè que leur matière eft
plus homogène, que le dégré de cohéfion eft plus
égal par-tout, & que le corps n’eft p as , pour
afnfi dire, partagé en une multitude de petites
maffes q u i, ayant des folidités différentes , réfon-
nent conféquemment à différens tons.
Pourquoi le bruit ne feroit-il pas du fon , puif-
qu’il en excite? Car tout bruit fait réfonner les
cordes du clavecin, non quèlqués-unes, comme
fait un fon, mais toutes en/emble, parce qu’il n’y
en a pas une qui ne trouve fon uniffon ou fes
harmoniques. Pourquoi le bruit ne feroit-il pas du
fo n , puifqu avec des fons oh fait dtf bruit ? Touchez
à la fois toutes les touches d’un clavecin, vous
produirez une fenfimon totale, qui ne fera que
B R U
du bruit, & qui ne prolongera fon effet, p\*ir la
rèfonnance des cordes, que comme tout autre
bruit qui feroit réfonner les mêmes cordes. Pourquoi
le bruit ne feroit-il pas du fon , puifqu’im fon
trop fort n’eft plus qu’un véritable bruit * comme
une voix qui crie à pleine tète, 6c fur-tout comme
le fon d’une groffe cloche qu’on entend dans le
clocher même ? Car il eft impoffible de 1 apprécier,
f i , fortant du clocher, on nadçucit le ton par
l’éloignement.
Mais , me dira-t-on , d’où vient ce changement
d’urt Ton exceffif en bruit? C ’eft que l.i violence
des vibrations rend fenfible la rèfonnance d’un fi
grand nombre d’aliquotes , que le mélange de
tant de fons divers fait alors fort effet-ordinaire
& n’eft plus que du bruit. Ainfi les aliquotes qui
réfonnent, ne font pas feulement la moitié, le
tiers , le quart & toutes les confonnances , mais la
feptième partie , la neuvième, la centième & plus
encore. Tout cela fait enfemble un effet fem*
blable à celui de toutes les touches d’un clavecin
frappées à la fois : & voilà comment le fon
devient bruit.
On donne auffi, par mépris, le nom de bruit
à une mufique étourdiffante & confufe, où l’on
entend plus de fracas que d’harmonie, & plus de
clameurs que de chant. Ce rïefl que du bruit : cet
opéra fait beaucoup de bruit 6* peu d'effet. ( /. J.
Rouffeau. )
B r u i t . A l’appui de Cette conjeélure de
Rouffeau fur l’analogie & fur les différences qu’il
y a entre le bruit & le fon , nous citerons ce
i paffage de M. le de la Cépède. « Un fon fe fait
» entendre toutes les fois qu’un corps ne laiffe
« vibrer d’une maniéré très - fenfible que celles
»» de fes cordes fonores dent la longueur &
>» la tenfion font combinées de manière à ne pro-
» duire en quelque forte qu’une vibration : par-là
y} on ne remarque d’une manière très-fenfible qu’im
» effet unique, & les effets fecondaires qu’il fait
» naître ne l’accompagnent que d’une manière
33 fourde & cachée
« Le bruit au contraire a lieu toutes les fois
93 qu’un corps fonore laiffe vibrer toutes les parties
>» capables d’agir fur l’organe-de fouie. Alors on
r> n’eft plus uniquement affeélé par un effet très-
93 fenfible, &. par fes harmoniques, mais,on
99 l’eft par une multitude d’effets fonores & d’harmo*
99 niques, les uns graves, les autres aigus , qui fe
» combattent & fe confondent. Toutes c«s impref-
>5 fions fe détruifent mutuellement, o u , pour mieux
99 dire, il en naît une efpéce d’impreffion eéné-
93 raie que l ’on né fait à quelle partie de l’écnelle
>j muficale rapporter, parce qu’aucune impreifion
93 particulière ne domine affez fur les autres » &
9i ne forme un objet faillant dont l’oreille puiffe
» aifément déterminer la place. Delà vient qu’on
» ne peut pas chanter à l’uniffon ni à l’oélave du
93 bruit......
ii C’eft l’unité ou la confufion des effets produits,
»>
V
33
B R U
& des impreflions communiquées qui conftitue
uniquement la différence qu’il y a entre la nature
du Irait & celle du fon. La force n’y eft pour
” ^,Cp’etïet fonore le moins fenfible, celui de l’eau
„ q u i tombe goutte à i goutte n’eft que d u bruit,
& devient un fon s’il va frapper contre quelque
voûte qui repréfente un corps fonore' bien
dhpofé, qui reçoive tous les effets, mais n’en
” renvoie qu’un d’une maniéré bien dtftinâe.
* | L’egèt fonore du tonnerre,-celui du canon, r.e
font non plus que des bruits , quelque grands
I au’ils puiffentêtre; & ils fe changent cependant
1 ’ n {<„, lorfqu’ils font reçus par des corps capa-
” ÿ es 6e fes réfléchir, de manière à ne leur faire
!’ produire.qu’une impreffiçn unique.
*1 j L’élévation ou l’abaiffement netabhffent non
„lus aucune différence entre le bruit & le fon.
” ü bru U de-deux morceaux de fer qui fe choquent
* Prt fouvent très-aigu fans ceffer d’être bruit ; &
celui des chars qui roulent, ou du tonnerre qui 1 „ronde, eft fouvent très-grave , quoiqu’il ne foit i L changé en fon | ( Rpëtique de' a mufique )
Concluons de ces idées jufies, fur la nature du
bruit & du fon. i ” Que le bruit .eft effenrie. ement
anti-mufical. a° Q u’il ne faut jama.s que le fon
dégénère en huit. 3“ Qu’il ne faut jamais untr
l'un avec l’autre. , , r : . .
La première de ces confluences na betoin m
de développemëns ni de preuves.
On va contre la fécondé lorfqu’on rend l’harmo-.
nitffi confufe & fi bruyant! que les vibranbns de
tous lesinftrumens fe brouillent, fe confondent,
& que l’oreille , ne pouvant diftinguer aucun fon
dans ce chaos , n’y entend plus que du bruit.
On y va encore lorfqu’en jouant d’un infiniment
à cordés, on les fait vibrer trop durement.
Ces vibrations violentes &. fubites font refonner un
fi grand nombre d’harmoniques qui eft mipoffible
à l'oreille d’en difcernerâïfcun. Alors 1inftrumentifte
racle au lieu de jouer; & ne tire de fon mftrument
que du bruit au lieu de fon.
C'eft ainfi que lorfqu’un chanteur force fa voix ,
au lieu de ne faire vibrer que les cordes fonores de
fon goder , il les ébranle toutes à la fois , & crie
au lieu de chanter. Le cri eft pour la voix ce que
le bruit eft pour les inftrumens.
D’après ik.troifième conféquence , on doit également
éviter *l’un & . l’autre. Dès que les voix
crient , ou que les inftrumens bruiffent , 1 etiet
iKufical ceffe.
Delà vient la néceffité d’employer dtferettement
d ins un orcheftre les inftrumens de percumon tels
que la timballe, dont le Ion fe change trop facne-
inent en bruit, ou y reffemble trop.
Les cimballes (ont encore plus anti-mulicaies.
Le métal trop fonore dont elles font compolees,
vibre avec tant de force qu’il ne rend que du bruit ;
fk-.ce bruit eft fi éclatant qu’il couvre quelqueiois
B R U 1 8 3
l’orcheftre 8c déchire les -oreilles fenfibles. Je (ais
que dans quelques marches , il donne un caraélere
'"guerrier qui plaît à la multitude. Mais ce caractère
doit être dans le rhytme 8c dans la mélodie ; &
quand des troupes défileron ifur un air martial
accompagné de trompettes & de timballes, bien
difficiles feront ceux qui défireront encore d’ÿ ajouter
ces maudites cimballes,fupportables tout au plus
en plein air dans une marche véritable, mais affour-
diflantes fur nos petits théâtres.
Il en faut dire autant du triangle , dont le bruit
ne peut s’allier avec aucun fon,& quichangeroit en
fupplice le plus beau m®rceau de mufique,s’il fervoit
d’ accompagnement. Je fais que M. Gluck l’a employé
dans fon premier aéle d’Iphigénie enTauride,
pour donner à la danfe de fes Scythes un caraâere
barbare. Le fuccès de cette nouveauté ne doit pas
engager à l’imiter. Qui ne voit qu’avec ces repré-
fentations fidèles de la nature , on détruit l’art ?
que fi on les pouffe à ce dégré de reffemblance
il n’y a plus de raifons pour s’arrêter en chemin ?
que les inftrumens les plus baroques , les plus
deftruSifs de toute mufique deviendront, dans ce
fyftême , néceffaires à la repréfentation muficale
d’une a&ion qui fe ferapaffée dans les lieux fauvages
où ces inftrumens font en ufage ? qu’il faudroit
cnfu’te donner aux aélewrs des cris inarticulés au
lieu de langage , des hurlemens au lieu de chants
de vi&oire s &c. &c. ? ( M. Ginguené ).
B r u i t . c< tout corps qui en choque, un autre
produit un fon; mais ce fon eft (impie dans les
corps qui ne font pas élaftiques , au lieu qu il^ fe
multiplie dans ceux qui ont du reffort Lorfqu on
frappe une cloche ou tin timbre de pendule, un
feulcoup’produit d’abord un fon quife répeteenfuite
par les ondulations du ccrps fonore 8c fe mu’tiplie
réellement autant de fois qu’il y a d’ofcillations .où
de vibrations dans le corps fonore. Nous devricDS
donc juger ces fons non pas comme fimples , mais
comme compofés , fi par l’habitude nous n’avions
pas appris à juger qu’un coup ne produit qu’un fon.
C ’eft ha fucceffion de tous les petits coups répétés,
ou ce qui revient au même c’eft le nombre des vibrations
du corps êlafiique qui fait le ton du fon. Un
coup de füfil, un coup de fouet, un coup de canon
preduifent des fons différens qui cependant n’ont
aucun ton ; le ton ccnfifte donc dans la continuité
du même fon pendant un certain temps ; cette continuité
de fons peut être opérée de detfx manières
différentes : la première & la plus ordinaire eft la
fucceffion des vibrations dans le corps élaftique Sc
fonore ; la feeonde paroît être la répétition prompte
& nombfeufe du même coup fur les corps qui fort
incapables de vibrations : car un ccrps à reffort qu’un
i feul coup ébranle & met en vibration , agit à l’exté*
rieur 8c fur notre oreille comme s’il éroit en effet
frappé par autant de petits coups égaux qu’il fait
de vibrations ». ( Hiftoire naturelle de f Homme,
par M, de Buffon, du fens de l’ouie.)