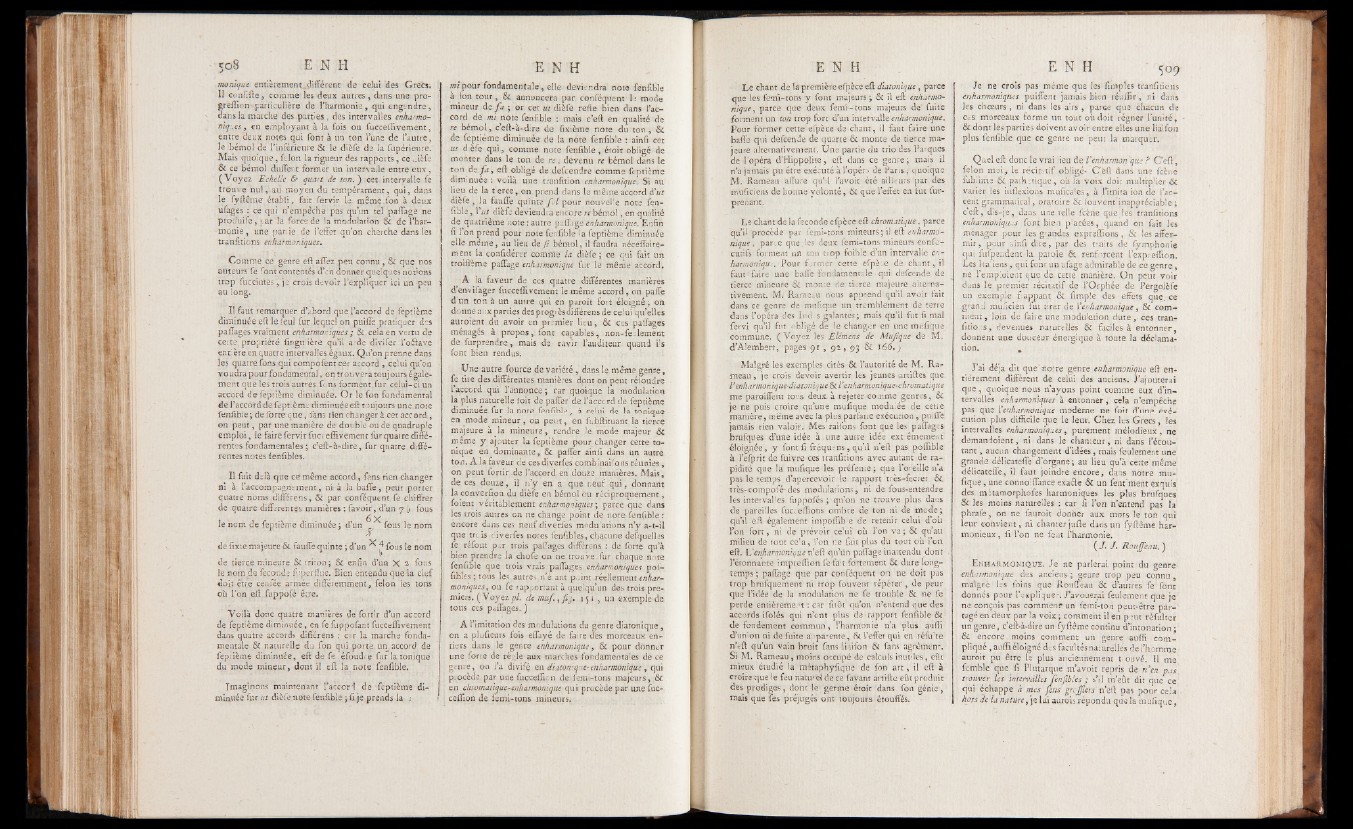
monique entièrement^différent de celui des Grecs*
Il confifte, comme les deux autres, dans une pro-
greffion-particulière de l’harmonie, qui engendre,
dans la marche des parties| des intervalles enharmoniques
, en employant à la fois ou fücceflivement,
entre deux notes qui font à un ton l’une de l’autre,
le bémol de l’ inférieure & le dièfe de la fupérieuref
Mais quoique, félon la rigueur des rapports, ce dièfe
& ce bémol duffent former un intervalle entre eu x ,
(V o y e z Echelle & quart de ton. ) ce t ■ intervalle fe
trouve n u l, au moyen du tempérament, qui, dans
le fyftême établi, fait fervir le. même . fon à deux
ufages : ce qui n’empêche pas qu’un tel paffage ne
prodüife, par la force de la modulation & de l’harmonie
, une parue de l’effet qu’on cherche dans les
tranfiticns enharmoniques.
Comme ce genre eft allez peu connu, & que nos
auteurs fe font contentés d’en donner quelques not'cms
trop fuccintësf je crois devoir l’expliquer ici un peu
au long.
Il faut remarquer d’abord que l ’accord de feptième
diminuée eft le feul fur lequel on puiffe pratiquer des
paflages vraiment enharmoniques ; & cela en vertu de
cette propriété fingulière qu’il a de divifer l’oftave
entière en quatre intervalles égaux. Qu ’on prenne dans
les quatre fons qui compofent cer accord , celui qu’on
voudra pour fondamental, on trouvera toujours; également
que les trois autres fons forment .fur celui-ci un
accord d e feptième diminuée. O r lè fon fondamental
dé l’accôrd de feptième diminuée eft toujours une note
fenfibie ; de forte q u e , fans rien changer à cet accord ,
on peut, par une manière de double ou de quadruple
emp loi, le fàiré fervir fucc effivement fur quatre différentes
fondamentales ; c’eft-à-dire, fur quatre différentes
notes fenfibles.
Il fuit delà que c e même accord, fans rien changer
ni à l’accompagnement, ni à la baffe , peut porter
quatre noms différens, & par conféquent fe chiffrer
de quatre différentes manières : favoir, d’un 7 |> fous
\ • 6 X
le nom de feptième diminuée; d’un ^ fous le nom
de fixte majeure &. fauffe quinte ; d’un ^ % fous le nom
de tierce mineure & triton; & enfin d’un X 2 fous
le nom „de fecor.de fùperflue. Bien entendu que la c lef
doit être cenféè armée différemment, félon les tons
où l.'qn eft fuppofé erre.
V o ilà donc quatre manières de fortir d’un accord
de feptième diminuée, en fefuppofant fücceflivement
dans quatre accords différens : car la marche fondamentale
& naturelle du fon qui porte un accord de
feptième diminuée, eft de fe éfoudre fur la tonique
du mode mineur, dont il eft la note fenfibie.
Imaginons maintenant raccord de feptième diminuée
fur ut dièfe note fenfibie ; f l je prends la ;
mi pour fondamentale , elle deviendra note fenfibie
à fon to u r , & annoncera par conféquent 1 î mode
mineur âe fa • or cet ut dièfe refte bien dans l’accord
de mi note fenfibie : mais c’eft en qualité de
re b émol, c’eft-à-dire de fixième note du to n , &
de feptième diminuée de la note fenfibie : ainfi cet
ut d.èfe q u i, comme note fenfibie, étoit obligé de
monter dans le ton de re, devenu re bémol dans le
ton àît 'fa, eft obligé de defcendre comme feptième
diminuée : voilà une tranfition enharmonique, Si au
lieu de la teree ,. on prend dans le même accord d’//£
dièfe , la fauffe quinte fo l pour nouvelle note fen-
ftble, Y ut dièfe deviendra encore re b émo l, en qualité
de quatrième note : autre paffage enharmonique. Enfin
fi 1 on prend pour note fenfibie !a feptième diminuée
elle même, au lieu de f i bémol, il faudra néceffaire-
ment la confidérer comme la dièfe ; ce qui fait un
troifîeme paffage enharmonique fur le même accord.
A la faveur de ces quatre différentes manières
d’envifager fücceflivement le même accord, on paffe
d u n ton à un autre qui en paroît fort éloigné ; on
donne aux parties des progrès différens de celui qu’elles
auroient du avoir en premier lieu , & ces paflages
ménagés à propos, font capables, non-feulement
de fur prendre, mais de ravir l’auditeur quand ils
font bien rendus.
Une autre fource de v ariété, dans le même genre,
fe tire des différentes manières dont on peut réfoudrè
l’accord qui l’annonce ; car quoique la modulation
la plus naturelle foit de palier de l’ acccrd de feptième
diminuée fur la note fenfibie, à celui de la tonique
en mode mineur, oa p eu t , en fubftituant la tierce
majeure à la mineure, rendre le mode majeur &
même y ajouter la feptième pour_ changer cette tonique
en dominante, & palier ainfi dans un autre
ton. A la faveur ce ces diverfes combinai fons réunies,
on peut fortir de l’accord en douze manières. Mais,
de ces douze, il n’y en a que neuf q u i, donnant
la converfion du dièfe en bémol ou réciproquement,
foient véritablement enharmoniques ; parce que dans
les trois autres on ne change point de note-fenfibie :
encore dans ces neuf diverfes modu'ations n’y a-t-il
que tri.is diverfes notes fenfibles, chacune defquelles
fe réfout p :r trois paflages différens : de forte qu’à
bien prendre la chofe on ne trouve fur chaque note
fenfibie que trois vrais paflages enharmoniquet pof-
fibles ; tous les.autres n’é.ant point réellement enharmoniques,
ou fe rapportant à quelqu’un des trois premiers.
(V o y e z pl. de muf., fi g. 151 , un exemple de
tous ces paflages. )
A l’imitation des modulations du genre diatonique,
on a plufieurs fois efîayé de faire dés morceaux entiers
dans le genre enharmonique, & pour donner
une forte de règle aux marches fondamentales dé ce
genre, on i’a divifé en diatonique-enharmonique, qui
procède par une fuccefficn de .femi-tons majeurs, &
en chromatique-enharmonique qui procède par une fuc-
ceflion de femi-tons mineurs.
L e chant de la première efpèce eft diatonique, parce
que les femi-tons y font majeurs ; & il eft enharmonique,
parce que deux femi-tons majeurs de' fuite
forment un ton trop fort d’un intervalle enharmonique.
Pour former cette efpèce de chant, il faut faire une
baffe qui defeende de quarte-& monte de tierce majeure
alternativement. Une partie du trio des Parques
de l'opéra d’Hippolite, eft dans ce genre; mais il
n’a jamais pu être exécuté à l’opér:« de Paris, quoique
M. Rameau allure quM l’avoit été ailleurs par des
muficiens de bonne v o lon té , & que l’effet en tut fur-
prenant.
Le chant de la fécondé efpèce eft chromatique, parce
qu’il procède par femi-tons mineurs ; il eft enharmonique,
parce que.les deux femi-tons mineurs eonfé-
cutifs forment un ton trop foiblè d’un intervalle enharmonique.
Pour former cette efpèce de ch ant, il
faut faire une baffe Fondamentale qui defeende de
tierce mineure & morne de tierce majeure alternativement.
M.' Rameau nous apprend qu'il avoit fait
dans ce genre de mtifique un tremblement de terre
dans l’opéra des Irrd s galantes; mais qu’il fut fi mal
fervi qu’il fut obligé de le changer en une mufique
commune. ( V o y e z les Elèméns de Mufique de M.
d’A lembert, pages 91 , 9 2 ,9 3 & 166, )
Malgré les exemples cités & l’autorité de M. Rameau
, je crois devoir avertir les jeunes artiftes que
Venharmonique-diatonique & / ’enharmonique-chromatique
me paroiffent tous deux à rejeter comme genres, &
je ne puis croire qu’une mufique modulée de cette
manière, même avec la plus parfaite exécution, puifle
jamais rien valoir. Mes raifons font que les paflages
brufques d’une idée à .une autre idée ext êmemenf
éloignée, y font fi fréquens , qu’il n’eft pas poflible
à l’efprit de fuivre ces tranfirions avec autant de rapidité
que la mufique les préfente; que l’oreille n’a
pas le temps d’apercevoir le rapport très-fecret
très-compofé-des modulations, ni de fous^entendre
les intervalles fuppofés ; qu’on ne trouve plus dans
de pareilles fucceffions ombre de ton ni de mode;
qu’il eft également impoflib'e de retenir celui d’où
l’on fo r t , ni de prévoir celui où l’on v a ; & qu’au
milieu de tout ce’a , l’on ne fait plus du tout où l’on
eft. L ’enharmonique n’eft qu’un paffage inattendu dont
l’étonnante impreffion fê lait fortement & dure longtemps;
paffage que par conféquent on ne doit pas
trop brufquement ni trop fouvent répé te r, de peur
que l’idée de la modulation ne fe trouble & ne fe
perde entièrement : car fitôt qu’on n’entend que des
accords ifolés qui n’ent plus de rapport fenfibie Ô£
de fondement commun, l’harmonie n’a plus auffi
d’union ni de fuite arparente, & l’effet qui en réfu’te
n’eft qu’un vain bruit fans liaifon & fans agrément.
Si M. Rameau, moins occupé de calculs inutiles, eût
mieux étudié la métaphyfique de fon a r t , il eft à
croire que le feu naturel de ce favant artifte eût produit
des prodiges, dont le germe étoit dans fon génie,
mais que les préjugés ont toujours étouffés.
Je ne crois pas même que les fimples tranfiticns
enharmoniques puiflent jamais bien réuifir, ni dans
les choeurs, ni dans les a;.rs , parce que chacun de
ce s morceaux forme un tout où doit régner l’unité,
& dont les parties doivent avoir entre elles une liaifon
plus fenfibie que ce genre ne peut la marquer.
Qu el eft donc le vrai lieu de Venharmon que ? C ’eft,
félon m o i, le récitatif obligé- C ’èft dans une fcène
fubiime & pathétique, où la vo ix doit multiplier &
varier les inflexions muficales, à limita ion de l’accent
grammatical, oratoire ôt fouvent inappréciable ;
c’e f t , dis-je, da ns une telle fcène que des tranfitions
enharmoniques font bien placées, quand on fait les
ménager pour les grandes expreffions , & les affermir
, pour ainfi dire, par des traits de fymphonie
qui fufpendent la parole & renforcent l’expreftion.
Les lta’ie-ns, qui font un ufage admirable de ce g en re,
ne l’emploient que de cette manière. O n peut voir
dans lè premier récitatif de l’Orphée de Pergolèfe
un exemple fiappant & ftmp’e des effets que. ce
grand muficien fut tirer de Ven harmonique, & commen
t,'loin de faire une modulation d u re , ces tran-
f it io ts , devenues naturelles & faciles à entonner,
do nnent une douceur énergique à toute la déclamation.
.
J’ai déjà dit que'notre genre enharmonique eft entièrement
différent de celui des anciens. J’ajouterai
q u e , quoique nous n’ayons point comme eux d’intervalles
enharmoniques à entonner, cela n’empêchp
pas que Y enharmonique moderne ne foit d’une exécution
plus difficile que le leur. Chez les G re c s, les
intervalles enharmoniques, purement mélodieux, ne
demandoient, ni dans le chanteur, ni dans l’écoutant
, aucun changement d’idées, mais feulement une
grande délicatefle d ’organe; au lieu qu’à cette même
délicateffe, il faut joindre encore, dans notre mufique
, une connoiffance exaéle & un fen f ment exquis
des métamorphofes harmoniques les plus brufques
& les moins naturelles : car fi l’on n’entend pas la
phrafe^ on ne fauroit donner aux mots le ton qui
leur coh vient, ni chanter jufte dans un fyftême harmonieux
, fi l’on ne feut l’harmonie.
( J. J. RouJJeau. )
Enharmonique. Je ne parlerai, point du genre
enharmonique des anciens ; genre trop peu connu a
malgré les foins que Rondeau & d’autres fe font
donnés pour l’explique.-. J’avouerai feulement que je
ne conçois pas comment un femi-ton peut-être partagé
en deux par la voix ; comment il en peut réfulter
un genre, c’eft-à-dire un fyftême continu a intonation *
& encore. moins comment un genre auffi compliqué
, auffi éloigné des facultés naturelles de l’homme
auroit pu être le plus anciennement t-ouvé. Il me
femble que fi Plutarque m’avoit repris de nen pas
trouver les intervalles fenfibles ; s’il m’eût dit que ce
qui échappe à mes fens greffiers n’eft pas pour cela
hors de la nature, je lui aurois répondu que la mufique,