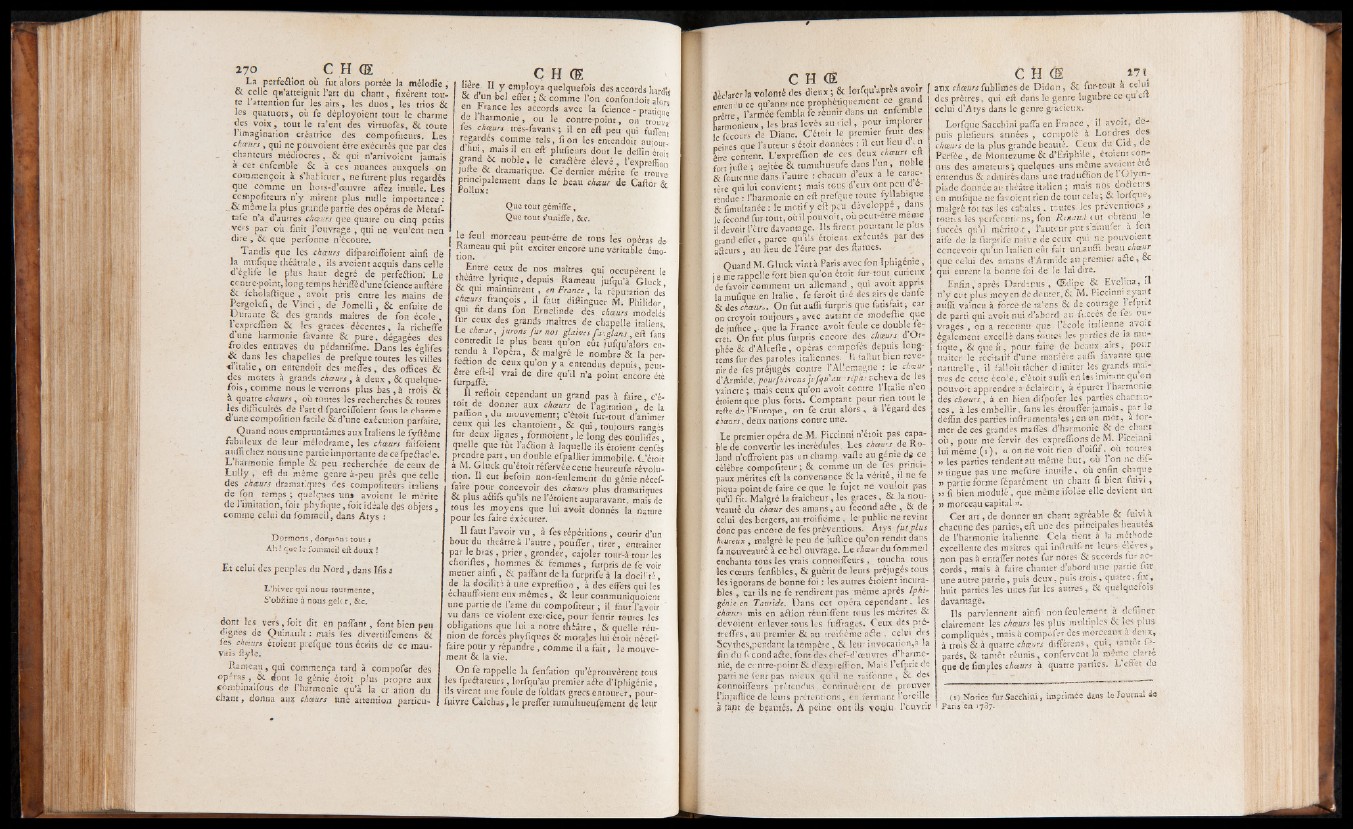
270 C H OE
La perfe&îon où fut alors portée la mélodie
Si celle qu’atteignit l’art du chant, fixèrent toute
l'attention fur les airs, les duos, les trios &
les quatuors, où fe déployoient tout le charme
des v o ix , tout le talent des virtuofes, & toute
l’imagination créatrice des compofiteurs. Les
choeurs, qui ne pouvoient être exécutés que par des
- chanteurs médiocres, & qui n’arrivoient jamais
à cet enfemble 8c à ces nuances auxquels on
coramençoit a s’habituer, ne furent plus regardes
que comme un hors-d’oeuvre affez inutile. Les
compofiteurs n’y mirent plus nulle importance :
. même la plus grande partie^ des opéras de Metaf-
tafe n \ d'autres choeurs que Quatre ou cinq petits
vers par où finit l’ouvrage , qui ne veulent rien
d ire, 8c que personne n’écoute.
Tandis que^ les choeurs difparoifloient ainfi dé
la mufique théâtrale , ils aveient acquis dans celle
d eglife lé plus haut degré de pêrfeéfioni Le
contre-point, long-temps hériffé d’une fcience auftère
& fcholaftique , avoit pris entre les mains de
Pergolefi, de V in ci, de Jomelli, & enfuite de
Durante & des grands maîtres de fon école,
l’expreffion & les -grâces décentes, la richeffe
d’une harmonie favante & pure, dégagées des
froides entraves du pédantifme. Dans les églifes
& dans les chapelles de prefque toutes les villes
-d’italie, on entendoit des mettes, des offices &
clcs motets à grands choeurs , à deux , & quelquefois
, comme nous le verrons plus bas , à trois &
à quatre choeurs, où toutes'les recherches & toutes
• les difficultés de l’art d fparciflbient fous le charme
d’une compofition facile & d’une exécution parfaite.
Quand nous empruntâmes aux Italiens le fyflême
fabuleux de leur mélodrame, les choeurs faifoient
auffichez nous une partie importante de ce fpeélac'e.
L ’harmonie fimple 8c peu recherchée de ceux de
L u l ly , eft du même genre à-peu prés que celle
des choeurs dramatiques des compofiteurs italiens
de fon temps ; quelques uns avoient le mérite
de limitation, foit p b y fi que, fôit idéale dçs objets,
comme, eelpi du fpmmeil, dans Àtys :
Dprmons, dorpion: tout x
Ali! Coq le fommei! eft doux !
Et celui des peuples du Nord, dans Ifis a
L ’hiver qui nous tourmente,
S’obfîine à nous geler, &c.
dont les vers, loit dit en pafiant, font bien peu
chgnes de Quinault : mais fes divertiffemens &
fes choeurs étoient prefque tous écrits de ce mauvais
ftyle, v-
Rameau, qui commença tard à compofer des
opéras , & ©ont le génie étoit plus propre aux
CÔmbmaifous de l’harmonie qu’à la cr ation du
chant , donna atij£ çhoeurs iuie attention particu- j
ÇHOE
M i n y employa quelquefois des accords hardît
oc dunhe l effet ; & comme l’on .confondoit alors
en b rance les accords avec la fcience - pratique
de 1 harmonie , ou le contre-point, on trouva
les choeurs très-favaiïs ; il en eft peu qui fuffent
regardés comme tels, fi on les entendoit aujour-
d hui, mais il en eft plufieurs dont le deffin étoit
grand 6c noble, le caraéïère é le v é , l’expreffion
jufte 8c dramatique. Ce'dernier mérite fe trouve
principalement dans le beau choeur de Caftor &
rollux:
Que tout gémiffe,
Que tout s'unifie, &c.
; le feul morceau peut-être de tous les opéras de
Rameau qui put exciter encore une véritable érao-
tion.
Entre ceux de nos maîtres qui occupèrent le
thtatre lyrique, depuis Rameau jufqu’à Gluck
& qui maintinrent , en France , la réputation des
choeurs françois , il faut diâinguer M. Philidor
qui fit dans fon Ernelinde des choeurs modelés ,
lur ceux des grànds maîtres de chapelle italiens.
Le choeur, jurons fur nos glaives far.glans,e& fans
contredit le plus beau qu’on eût iufqu’alors entendu
a 1 opéra, & malgré le nombre & la per- I
feetton de ceux qu’on y a entendus depuis, peut-
etre eft-il vrai de dire qu’il n’a point encore été
furpalfë.
Il refioit cependant un grand pas à faire, c’é-
toit de donner aux choeurs de l’agitation, de la
paflion, du mouvement; c’étoit fur-tout d’animer
ceux qui les chantoient, & qni, tbujours rangés
fur deux lignes , formoient, le long des codifiés,
quelle que tût l’aâion à laquelle ils étoient cenfés
prendre part, vin double efpallier immobile- C’étoit
à M. Gluck qu’étoitréfervéecette heureufe révolution.
Il eut befoin non-feulemerit du génie nécef-
faire pour^ concevoir des choeurs plus dramatiques
& plus aélifs qu ils ne 1 étoient auparavant, mais de
tous les moyens que lui avoit donnés la nature
pour les faire exécuter.
Il faut l’avoir vu , à fes répétitions , courir d’un
bout du théâtre a l’autre, pouffer, tirer, entraîner
par le bras , prier, gronder, cajoler tour-à tour les
choriftes, hommes & femmes , furpris de fe voir
mener ainfi, & pafiant de la furprife à fa docifté,
de la docilité à uto expreffion , à des effets qui les
échauffoient eux memes, & leur cotnmuniquoient
une partie de l’ame du compofiteur ; il faut l ’avoir
vu dans ce violent exercice, pour fentir toutes les
obligations que lui a notre théâtre , & quelle réunion
de forcés phyfiques & morales lui étoit nécef-
faire pour y répandre , comme il a fait, le mouve-
ment & la vie.
On fe rappelle la fenfation qu’éprouvèrent tous
jes fpeôateurs, lorfqu’au premier a&e d’ Iphigénie,
ils virent ui>e foule de foldâts grecs entourer, pour-
fuiyre Çalchas, le preffer tumuhueufement de leur
CH® , t
déclarer la volonté des dieux ; & lorfquapres avoir
entendu ce qu’anm nce prophétiquement ce grand
urètre, l’armée fembla fe réunir dans un enfemble
Harmonieux , les bras levés au c ie l, pour implorer
le fecoiirs de Diane. C ’étcit le premier fruit des
„eines que l’auteur s'étoit données : il eut lieu d vil
être content. 'L’expreffion de ces deux choeurt eft
fort jufte ; agitée & tumultueufe dans 1 un, noble
& feutenue dans-i’autre : chacun d’eux à le caractère
qui lui convient ; mais tous d’eux ont peu d e-
tèndue : l’harmonie en eft prefque toute fyllabique
& fimuitanée :1e motif y eft peu développé , dans
le fecôttd fur tout, où il pouvoit, où peut-etre meme
il devoit l’être davantage. Ils firent pointant le p.us
grand effet, parce qu’ils étoieot exécutés par des
aftsurs , au lieu de l’êire par des ftatùes. /
Quand M. Gluck vir.tà Paris avec fon Iphigénie,
j e me rappelle fort bien qu’on étoit fur-tout curieux
de favoir comment un allemand , qui avoit appris
la mufique en Italie , fe feroit tiré des airs <Je danfe
& des choeurs. On fut aufli furpris que fatisfait; car
on croyoit toujours , avec autant de modeftie que
de juftice, que la France avoit feule ce double fe-
cret. On fut plus furpris encore des choeurs d’Orphée
& d’Alcefte, opéras compofés depuis long-
tems fur des paroles italiennes. 11 fallut bien revenir
de fes préjugés contre l’Allemagne : le choeur
d’Arniicîe, pourfvivons ji. fquau repas acheva de les
vaincre ; mais ceux qu’on avoit contre 1 Italie n en
étoient que plus forts. Comptant pour rien tout le
refte de l’Europe, on fe crut alors , à 1 egard des
choeurs, deux nations contre une.
Le premier opéra de-M. Piccînni n’etoit pas capable
de convertir les incrédules. Les choeurs de Roland
n’effroient pas un champ vafte au génie de ce
célèbre compofiteur ; & comme un de fes principaux
mérites eft la convenance & la-vérité, il ne fe
piqua point de faire ce que le fujet ne vouloit pas
qu’il fît. Malgré la fraîcheur , les grâces, & la nouveauté
du choeur des amans, au fécond a&e , & de
celui des bergers, au troifième , le- public ne revint
donc pas encore de fes préventions. Atys fut plus
heureux , malgré le peu dç juftice qu’on rendit dans
fa nouveauté a ce bel ouvrage. Le choeur du fommed
enchanta tous les vrais connoiffeurs , toucha tous
les coeurs fenfibles, & guérit de leurs préjuges tous
les ignorans de bonne foi : les autres étoient incurables
, car ils ne fe rendirent pas même après Iphigénie
en Tauride. Dans cet opéra cependant, les
choeur> mis en aéiion réunifient tous les mérités &
dévoient enlever tous les fuffrages. Ceux des prê-
trefies, au premier & au troifième aâe , celui des
Scythes,pendant la tempère , & leur invocation,à la
fin du fi cond afte, font des chef-d’oeuvres d’harme-
nie, de cr mre-point 8c d’expreffion. Mais l’efprit de
parti ne (ent pas mieux qu’il ne raifonne, 8c des
bonnoifieurs prétendus , continuèrent de prouver
l ’injuftjce de leurs prétentions, en fermant l’oreille
àjant de beautés. A peine ont ils voulu l’euvrir
c h <ë m ,
aux choeurs fublimes de Didon, 8c fur-tout a cehu
des prêtres, qui eft dans le genre lugubre ce qu ca
celui d’Atys dans le genre gracieux.
Lorfque Sacchini pafia en France , il avoit, depuis
plufieurs années , compofc à Londres des
choeurs de la plus grande beauté. Ceux du C id , de
Perfée, de Montezume 8c d’Eriphile , étoient connus
des amateurs'; quelques uns même avoient ete
entendus & admirés dans une traduélion de 1 Olympiade
donnée au théâtre italien ; mais nos doReuis
en mufique ne favoient rien de tout cela i & lorfque,
malgré toi.tos les cabales , toutes les préventions «,
toutes les perféentirns, fon Renaud eut obtenu le
fuccès qu’il mérito.t, l’auteur put s’amufer à fon
aile de fa furprife naïve ne ceux qui ne pouvoient
concevoir qu’un Italien eût fait uitaufii beau choeur
que celui des amans d'Armide au premier a£te, oC
qui eurent la benne foi de le lui dire.
Enfin,'après Da'rdonus , (Edipe & Evelina, il
n’y eut plus moyen de douter, & M. Piccînm ayant
aufli vaincu à force-de ta’, en s 8c de courage 1 efprît
de parti qui avoit nui d’abord au fuccès de fes ouvrages
, on a reconnu que l’école italienne avoit
également excellé dans toutes les parties de la mufique,
8i que f i , pour faire de beaux airs, pour
traiter le récitatif d’une manière suffi favante que
naturelle, il fàlloit tâcher d imiter les grands maîtres
de cette éco’e , c’étoit aufli en les imitant qu on
pouvoit apprendre à éclaircir/, à épurer 1 harmonie
des choeurs,, à en bien difpofer les^ parties chantantes
, à les embellir, fans les étoufter jamais -, par le
deffin des parties inftrumentales ;en un mot, a former
de ces grandes mafias d’harmonie & de chant
où, pour me fervir des expreffions de M. Piccinni
lui même (i ) , « on,ne voit rien d’oifif, où toutes
» les parties te'nderitau même but, où l’on ne chf-
v tingue pas une mefure' inutile -, où enfin chaque
v partie forme féparément un chant fi bien fu iv i,
» fi bien modulé, que même ifolée elle devient un
» morceau capital ».
Cet ar t, de donner un chant agréable & fuivi à
chacune des parties, eft une des principales béantes
de l’harmonie italienne. Cela tient à la méthode
excellente des maîtres qui inPtruffi nt leurs élèves,
non pas à entaffier notes fur notes & accords fur accords,
mais à faire chanter d’abord une partie fur
une autre partie, puis deux, puis trois, quatre, fix ,
huit parties les unes fur les autres, 8c quelquefois
davantage.
Ils parviennent ainfi non feulement a defiîner
clairement les choeurs les plus multiples & les plus
compliqués, mais à compofer des morceaux à deux,
à trois & à quatre choeurs différens, qui ^ tantôt f?-
parés, & tantôt réunis, confervent la meme clarté
que de fimples choeurs à quatre parties. L eftet de
. (i)Notice fur Sacchini, imprimée dans le Journal de
Paris en 1707.