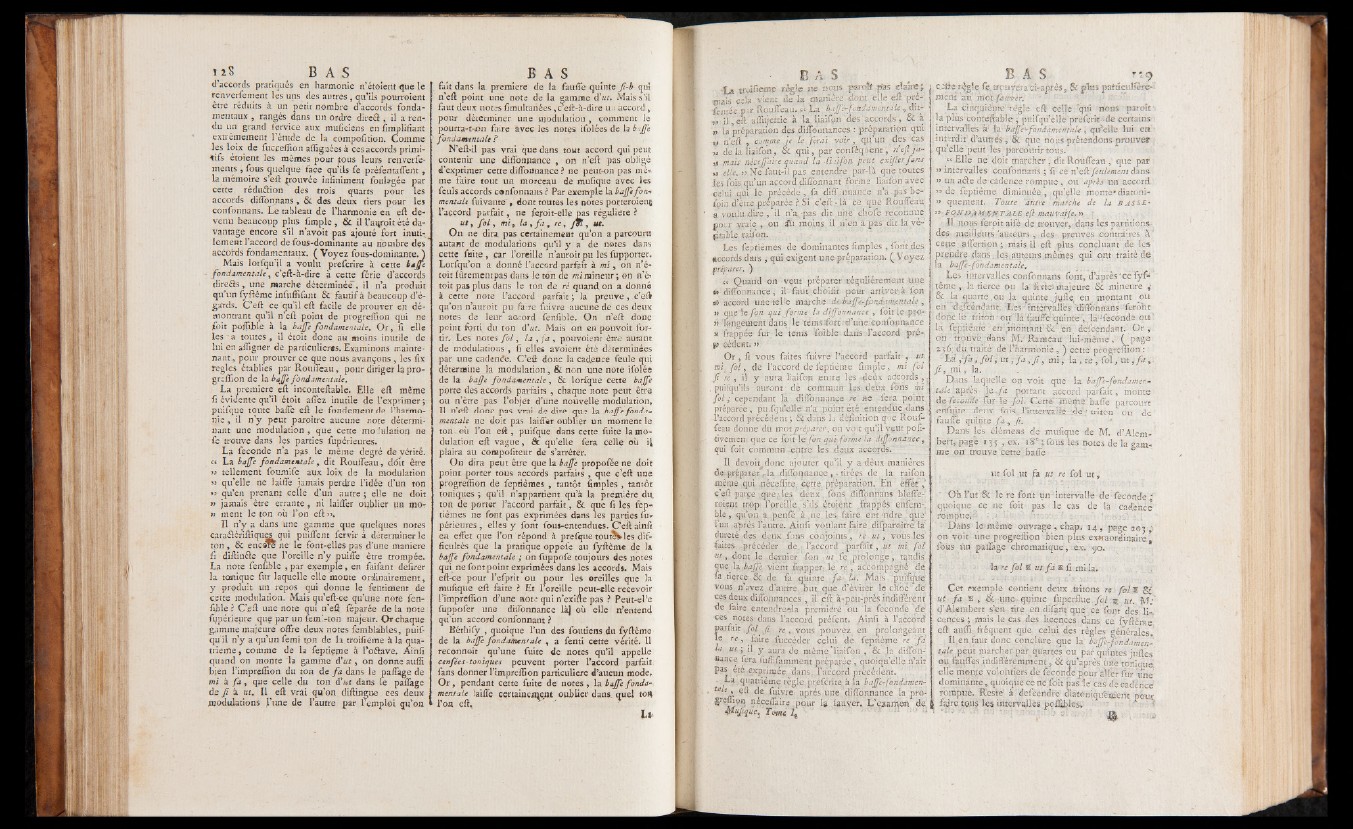
118 B A 5
d’accords pratiqués en harmonie n’étoient que le
renverfement les uns des autres , qu’ris pourraient
être réduits à un petit nombre d’accords fondamentaux
, rangés dans un ordre dire# , il a rendu
un grand l'ervice aux muficiens en Amplifiant
extrêmement l ’étude de la compofîtion. Comme '
les loix de fucpeflion afligaéesà çesaccords primitifs
étoient les mêmes pour jous leurs renverfe-
ments , fous quelque façe qu’ils fe préfentaffent,
la mémoire s’eft prouvée infiniment foubgée par
cette réduction des trois quarts pour les
accords diflonnans, & des deux tiers pour les
confonnans. Le tableau de l’harmonie en eft devenu
beaucoup plus fimple , & il l’aqroit été davantage
encore s’il n’avoit pas ajouté fort inutilement
l’accord de fous-dominante au nombre des'
accords fondamentaux. ( Voyez fous-dominante. )
Mais lorfqu’il a voulu prefcrire à cette baffe
fondamentale t c’eft-à-dire à cette férié d’accords
direéts, une marche déterminée', il n’a produit
qu'un fyftême infuffifam & fautif à beaucoup d’é-
ga'rds. C ’eft ce qu’il eft facile de prouver en démontrant
qu’il n’eft point de progrefiion qui ne
jfoit poflible à la baffe fondamentale. O r , A elle
les r a toutes , il étoit donc au moins inutile de
lui en afligner de particulières. Examinons maintenant
, pour prouver ce que nous avançons , les Ax
réglés établies par RoufTeau, pour diriger la pro-
gr£ filon de la bajfe fondamentale.
La première eft inconteftable. Elle eft même
A évidente qu’il étoit a fiez inutile de l’exprimer;
pmfque toute baffe eft Je fondement de l’harmonie
, il n’y peut paraître aucune note déterminant
une modulation , que cette moiulatiou ne
fè trouve dans les parties fupérieures.
La fécondé n’a pas le même degré de vérité.
et La bajfe fondamentale, dit RoufTeau, d<5it être
»a tellement foumife aux loix .de la modulation
>5 qu’elle ne laiffe jamais perdre l’idée d’un ton
yy qu’en prenant celle d’un autre ; elle ne doit
»> jamais être errante , ni laifler oublier un mo?
n ment le ton où l’on eft jj.
Il n’y a dans une gamme que quelques notes
caraâêriftiques qui puiflent fervir à, déterminer le
ton , & encore ne le font-çlles pas d’une maniéré
A diftinéfe que l’oreille n’y puilfe être trompée.
La note fenfible , par exemple, en faifant deArer
la tonique fur laquelle elle monte ordinairement,
y produit un repos qui donne le fentiment de
c.ette modulation. Mais qu’eft-ce qu’une note fen-
AJ}le ? C ’pft «ne note qui n’eft féparée de la note
fijpérieure que par un femirton majeur. Or chaque
gamme majeure offre deux notes femblâbles, puif-
qu il n’y a qu’un femi ton de la troifieme à la quatrième,
comme de la feptiepie à l’oéUve. Ain A
quand on monte la gamme d 'ut, on donne aufli
bien l’impreflion du ton de fa dans le paffage de
mi à fa y que celle du ton d'ut dans le paffage
de ƒ à ut. Il eft vrai qu’on diftingue ces deux
modulations l ’une de l’autre par l’emploi qu’on
B A S
fait dans la première de la fauffe quinte fi-b~ qui
n’eft point une note de la gamme d'ut. Mais s’il
faut deux notes Amultariées,ceft-à-dire lin accord,
pour déterminer une modulation , comment le
pourra-t-on faire avec les notçs ifolées de la bajfe
fondamentale ?
N’eft-il pas vrai que dans tout accord qui peut
contenir une diffonnance , on n’eft pas obligé
d’exprimer cette diffonnance ? ne pèut-on pas mè*
me faire tout un morceau de muftque avec les
fèuls accords confonnans ? Par exemple la baffe font
mentait fuivante , dont toutes les notes porteraient
Paccord parfait, ne feroit-elle pas régulière ?
u t, f o l , mi, la y fa 9 f i , Ut,
On ne dira, pas certainement qu’on a parcouru
autant de modulations qu’il y a de notes dans
cette faite , car l’oreille n’auroit pu les fupporter.
Lorfqu’on a donné l ’accord parfait à mi , on n’é-
toit fûrementpas dans le ton de mi mineur ; on r'&>
toit pas plus dans le tön de ré quand, on a donné
à cette note l’accord parfait ; la preuve, c’eft
qu’on n’auroit pu faire rùivre aucune de ces demç
notes de leur aoeord fenfible. On n’eft donc
peint forti du ton d'ut. Mais on en pouvoit for-
tir. Les notes f o l , la , f a , pouvoient être autant
de modulations, A elles avoient été déterminées
par une cadencfe. C ’eû donc la cadence feule quj
détermine la modulation, & non une note ifolée
de la baße fondamentale , & lorfque cette bajfe
porte des accords parfaits , chaque note peut être
ou n’être pas l’objet d’une nouvelle modulation,
Il n’eft donc pas vrai de dire que la bajfe fondamentale
ne doit pas laiffer oublier un moment le
ton©ù l’on eft , puifque dans cette fuite la modulation
eft vague, ôc qu’elle fera celle où il
plaira au compoftteur de s’arrêter.
On dira peut être que la baffe propofée ne doit
point porter tous accords parfaits , que c’eft une
progreflion de feptièmes , tantôt fimpies, tantôt
toniques ; qu’il n’appartient qu’à la première du,
ton de porter l’accord parfait., &. que A les fep-
tiimes ne font pas exprimées dans les parties fu*
périeures , elles y font fous-entendues. C ’eft ainfi
en effet que l’on répond à prefque tou telles difficultés
que la pratique oppofe au fyftême de la
bajfe fondamentale ; on fuppofe toujours des notes
qui ne font point exprimées dans les accords. Mais
eft-ce pour l’efprit ou pour les oreilles que la
muftque eft faite ? Et l’oreille peut-elle recevoir
Fimpreflion d?une note qui n’exifte pas ? Pem-el'e
fuppofer une diffonnance là) où elle n’entend
qu’un accord confonnant ?
Bétliify , quoique l’un des foutiens du fyftême
dé la bajfe fondamentale , a fenti cette vérité. 11
reconnoît qu’une fuite de notes qu’il appelle
cenfées-toniques peuvent porter l’accord parfait
fans donner l’impreffion particulière d’aucun mode,
O r , pendant cette fuite de notes , la bajfe fonda--,
mentale laiffe cçrtaineja^qnt oublier dans, quel ton
E A S
tt-oifieme règle ne c^ is perdit pas claire;
imaîs cela de.la 'pré-.
femée.p >r RoufTeau.,^ La baffe-fondamentale , dït-
Z i l , eft aflùjettie à la liaifpn des accords ", & à
,, la préparation des diffônnances : préparation qui
tji n’eft , comme je le ferai voir, qu’un des cas
M de ïa liai fou, & q ui, par conféq ùent', neff ja-
yf, mais néceffaire quand, la liaifon peut exijler fans
u elle, v Ne faut-il pas entendre par-là que tontes
Iles fois, qu’un açcord diifonnant forme liaifon avec
celui qui le précède. ,, fa diffonnance n’a pas'be-
fpin d’être préparée ?. Si c’eft -r là ce que Rquffeaü;
a .vQiiiir'Clire , il n’a,-pas dit .une çhofê reconnue
porr yraie ,, ou Æii moins il nlén à pas'dit làvé-
Çitable, raifon.
Les feptièmes de dominantes Amples , font des
accords durs ; qui .exigent une préparation. (. Voyez
f réparer. )
et Quand on veut préparer .régulière rdênt Ijine.
<•- difibnnance 1 il- faùt'choifif peur arriverà.'fon
^ àeeerd ime%éllê iA^chsadÉj1raffJéi^nÂ\mtii(tk »
» qpele fon qui firme la diffonnance , foit le pgo-
3v 'longement dans 'lé téms.fort rd’une; confopnance
» Fràppéè fur le tems foible daiis': l’accord
$> eéde«t.- »
O r , A vous faites fuivre-l’accord parfaire y-ut.
mi. fo l , de l’accord de feptième Ample , mi fo l
Ji re, il y aura liaifôp .entre les ^éeilix aefeords , .
. puifqu’ils auront d$ commun \les:ydeux fpns mi \
fol ; cependant la difibnnancè re ne .fera point
préparée , puXqU’e llé n’a point été ? entendue dans -
•l’accord précédent; dans la déftmtion que Rouf*
feau donne dû -mot préparer-7 on voit qu’il veut pofi-
tivement que ce foit \q fon qui for me!a diffonnance,
qui foit commun-entr'e les .deux accords.
Il déçoit, donc ajouter qu’il y a-dè-ux manières
de-,préparer ^la -diftçipiance., - tirées de la raifon
même qui ..nécçfilte- pftte. préparation. En e ffèt,'
c’eft parpe jque^.les deux, fôns diffpnnans bîèffer'
roient tr-ôp l’oreüle>Vi.l$'..étoiènt ^frappés enfepi-’
ble , qu’on-a. penféi à rné..lesr faire eirt fiidre . qiiê4
fini après l’autre. Ainfi voulant faire diïparoître! la
dureté des deux fans conjoints, ré u t, vous les
faites précéder de. l’accord parfait, ut mi fo ï
•«JN?, dont le dernier fon \ut fe p rolongetand is
que^X^jflffe vient frapper: le.. re y accôiii'pagiré- clé
fa tiercé & de, fa .qüinte fe\ U. Mais .piïifqûè;
vous n avez.. d’autre but. que d’éviter le choc de
ces de.ux diffônnances , i f ieft à -peu-près indifi'érent
de faire entendre-^la première ou là fécondé de
<ces notes dans l’accord préfent. Ainfi à l’açç'ofd
parfait - fo lff, re „ vous pouvez, en prolongeant
; T* * .faire fuccèder celui de 'feptième f é [ fa
la, ut ; il y aura de mênie liaifpn , & ,1a tliffon-
nance fera fufipamment préparée , quoiqu’elle i f ait
ÇxPl'nnée dans, l’accord précédent. \
■ -ka , quatrième règle prefcrire^ la baffe-fondamen-
■ * d® fuivre après une diffonnance la pro-
greffion néceffaire-pour la lauYer. L’examen de'
Tome 4
B A S
c.2Ûq r^gle fç. trpuve.ra'ci-ap/ês, Sc pins pataculîêre-
- mçnt au mot fzëverj
"La cinqnièm^ règle eft celle ‘qui nous parole-,
là plus bonteftiable ; puifijifellé prèfcriif -de certains
; intervalles à' ^ ‘■ -biyfe^firtdqme^ale \ -qi^elle "lui; en
interdit' d’aiitres , que nous prétendons prouver
.. qu’elle peut lès ; parcourir toûs.
>« Elle ne doit marcher , dit RoufTeau , que par
intervalles Confonnans ; fi ce n’eft feulement dans
» un aéte de-cadence rompue , ou apres im accord
■ 5Î de feptième diminiiée , qu’elle monte* diatoni-
:n quement. Toute âiifr'e marche de la BASSE-
53: EONd A MEfTTALE eft mauVaf[e,/n :
Il noos ferpit aifé de trouver, , dans les partitions-
des meill.êufs 'aïKéi^s ,::de§ . preuves pontrà:res à '
cette affertion ; mais il eft plus concluant dé les
. - prendre dans. les,auteurs^mêmes qui ont traité de
ila bajfe-fondamentale,
\ Les ntervalles confonnans font, d’après ' ceTyf* ’ '
j tême , la tierce ou la fixteî majeure & mineure
' & .la quarte,ou ja quinte^jyfte, en, montant ou
. en descendant. LeSv fnfçfvàllés dîftÔnfïàns; ferôbt
'y dont le fritoïi ' t>u'J rlà ^ tf:r?épquintèv,, jla^féGOndevbu'
là ïepdâwé eh\ptiéh&üP:6ci:jetij defc^ntjànt.'' Or
dri trç.ùvb dans M/Rameau lui-même , ( page
2.3 6. du traité de l’harmonie, ) cette progrefiion :
; La 9-fa '4 f o l , u t , f a , f i , mi.;’ l a , re , fo l, u t , fa ,.
f i , .mi , la.
Qans laquelle on voit que la baffe-fondamen-
, t4le '.après -Xp-ff1 portant accord parfait, monte
d^ffecerMe fur ie fol. Cette' rneûré baffe parcourt
.. e d f i ^ t e r r d é u x . t r i t o n ou de'
i fauffe quinte f a , Ji. .. '•*
DanS les élémeas de mufique de M. d’Alem-
bèrt, pagè 135 ;, èx. 18e ; foiis les notes d elà gamme
on trouve cette baffe
, ut fol ..ut fa ut re fol ut
' Où Fut .& le re font umintervalle de; fecon.de
\ quoique ce ne foit pas le cas de là cadence
; rompûejo - r •: ' ' '.o;0 ;
DànS le même ouvrage , ehap. 14 , page 203 p
on voit une progreflion • bien plus extraordinaire
fous ûn pàffàge chromatique, ex. y o ,
1 iâ ve fo l 2 ut; fâ 2 fi mi.la.
Cet exemple contient deux tritons re foÎM &
Ut fa 2 , & ;:ime-qqinte fuperfiuç./c/:^ ut. M-'
. d’ Ale.mberf s’en tire en difant que ce font des: fir-,
cences ; mais le cas des licences/dans ce. îyftème
: eft aufli. fréquent que celui des règles- générales^
Il.en Faut donc çpnclùre que la; baffe-fondamen-
, peut marcherpàr quartes ou par quiutes juftes
oufàpflqs indjifériemment, & qu’après Une tpriimie
; elle -une
' dominante, quoique ce rié.fdit pas ïeJ;cà£de eadence;
rompue. Reste* à :'defèêndle’ dlaténiqulîiBerit pour
j faire toupies intervalles poAiblesv