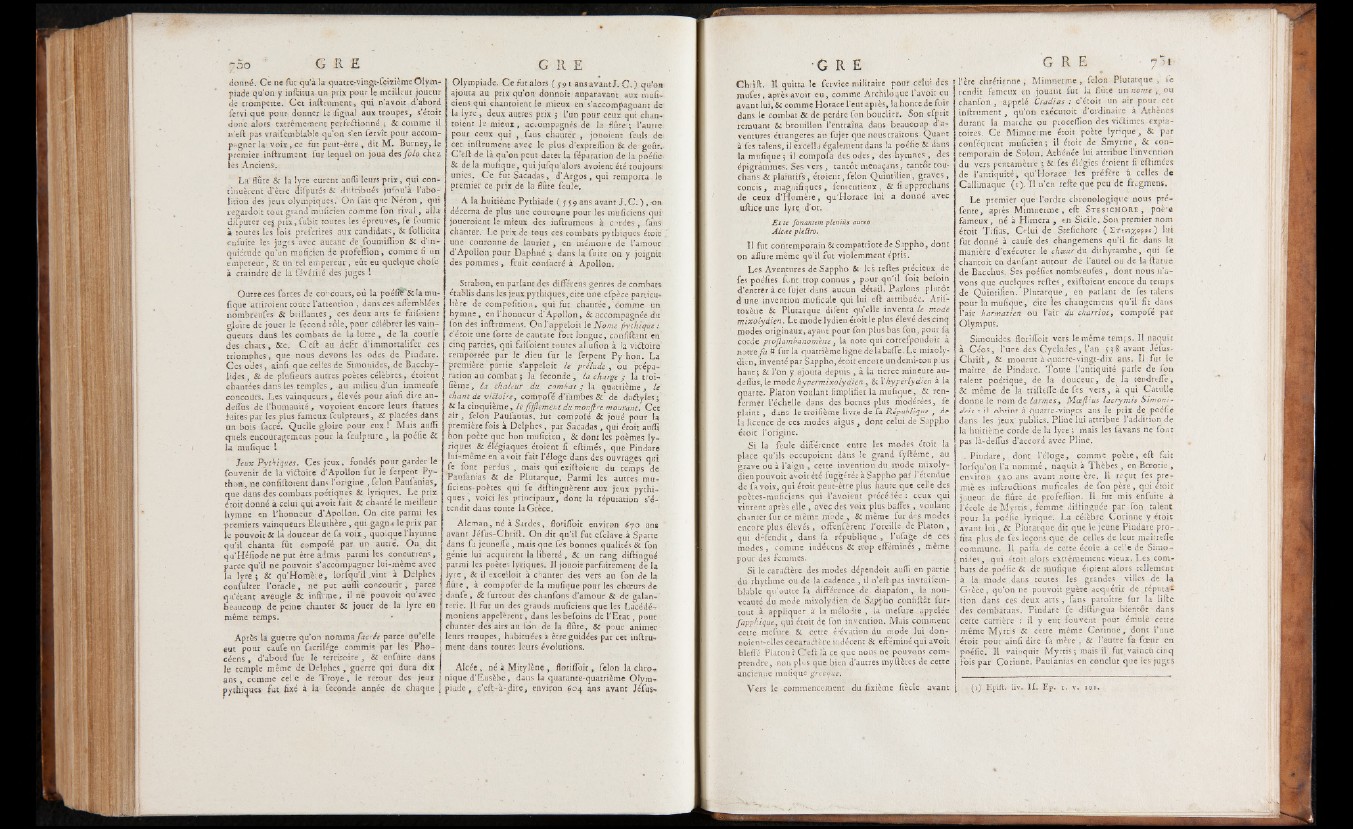
donné. C e ne fut qu’à la quatre-vingt-feizième Olympiade
qu’on y inflitua.un prix pour Te meilleur joueur
de trompette. C e t infiniment, qui n’avoit d’abord
fervi que pouis donner le ifigqal aux troupes, s’étoit
donc alors extrêmement perfectionné ; & comme il
n’eft pas vraifemblable qu’on s’en fervît pour accompagner
la- v o ix , ce fut peut-être , dit M. Burney, le
premier inftrument fur lequel on joua des folo chez
lès Anciens.
L a flûte & la lyre eurent auffi leurs prix, qui continuèrent
d’être difputés & diilribués jufou’à l’abolition
des jeux olympiques. On fait que Néron , qui
regardoit tout grand mufïcien comme fon r iv a l, alla
dilputer ce§ prix, fubit routes les épreuves, fe fournit
à toutes les lois preferites aux candidats, & follicîta
enfuite les juges avec autant de foumifîion & d’inquiétude
qu’un muficien de profeffion, comme fi un
empereur, 8c un tel empereur , eût eu quelque choie
à craindre de la févérité des juges l
Oiitre ces fortes de concours, où la poéfîe &Ia mu-
fique attiroient toute l’attention , dans ces affemblées
nômbreufes- & brillantes , ces deux arts fe faifoient
gloire de jouer le fécond rôle, pour célébrer les vain-
oueurs dans les combats de la lutte , de ‘la courfe
des chars , & c . C ’efl au defîr d’immortalifer ces
triomphes, que nous devons les odes de Pindare.
Ce s odes, ainfî que celles de Simouides,de Bacchy-
Jides, & de pîufieurs aucres poètes célèbres-, éloient
chantées dans les temples , au milieu d’un immenfe
concoilrs. Les vainqueurs , élevés pour ainfî dire au-
deflus de l’humanité , voyoient encore leurs fiâmes
faites par les plus fameux fculpteurs, & placées dans
un bois facré. Quelle gloire pour eux ! Mais auffi
quels encouragemens pour la fculpture , la poéfîe &
la mufique 1.
Jeux Pythiques. Ces jeux, fondés pour garder le
fouvenir de la vïdoire d’ Apollon fur lé ferpent Python,
ne confifloient dans l’origine , félon Paufanias,
que dans des combats poétiques & lyriques. Le prix
étoir donné à celui qui avoit fait & chanté le meilleur
hymne en l’ honneur d’Apollon. On cite parmi les
premiers vainqueurs Eleuthère, qui gagna le prix par
Je pouvoir & la douceur de fa v o ix , quoique l’hymne
qu’il chanta fut compofé par un autre. On dit
qu’Héfiode ne put être admis parmi les concurrent,
parce qu’il ne pouvoir s’accompagner lui-même avec
la ly re ; & qu’Hom'èie, lorfqu?iL vin t à Delphes
çonfulcer l’oracle, ne put auffi concourir, parce
qu’étant aveugle 8ç infirme, il né pouvôit qu avec
beaucoup de peine chanter & jouer de la lyre en
jnême temps. - •
Après la guerre qu’on nomma fàcrée parce qu’elle
eut pour caufe un facrilége commis par les Pho- 1
céens , d’abord fur le territoire , & enfuite dans
le temple même de Delphes , guerre qui dura dix f
an s , comme c e le de T r ô ÿ e , le retour des jeux
pythiques fut fi*é à la fécondé année 4« chaque j
Olympiade. C e fut alors ( jj> i ans avant J. C . ) qu’on
ajoura au prix qu’on donnoit auparavant aux mufî-
ciens qui chancoient le mieux en s’accompagnant de
la ly r e , deux autres prix ; l’un pour ceux qui chancoient
le mieux, accompagnés de la flûte ; l’autre
pour ceux qui , fans chanrér , jouoient fe.uls.de
cet infiniment avec le plus- d’expreffion & de"goût.
C ’efl de là qu’on peut dater la féparation de la poéfîe
& de la mufîque, qui jufqu’alors avoient été toujours!
unies. C e futSacada s , d’A rg o s , qui remporta le
premier ce prix de la flûte feule;
A la huitième Pythiade ( ; 59 ans avant J. C . ) , on
décerna de plus une couronne pour les muficiens qui
joueroient le mieux des inftrumcns à cordes , fans
chanter. Le prix de tous cescombats pythiques étoic
une couronne de laurier , en mémoire de l’amour
d’Apollon pour Daphné ; dans la fuite on y joignit
des pommes , fruit confacré à Apollon.
Strabon, en parlant des diffêrens genres de combats
établis dans les jeux pythiques, cite une efpèce particulière
de compofition, qui fut chantée , comme un
hymne, en l’honneur d’Apollon, & accompagnée du
fon des inflrumens. On l ’appeloit le Nome pythique :
cetoit une forte de cantate fort longue, confiftant en
cinq parties, qui faifoient toutes aliufion à la victoire
remportée par le dieu fur le fcrpenc Py hon. La
première partie s’appeloit le prélude , ô u prépa-
ration au combat ; la fécondé , la charge y la troi-
fième, la chaleur du combat y la quatrième, le
chant de victoire, compofé d’ïàmbes & de daétyics;
& la cinquième, le fifflemer.tdumonftre mourant. Ce t
[ a i r , félon Paufanias, fut compofé & joué pour la
première fois à Delphes, par Sacadas , qui étoit auffi
bon poète que bon muficien, & dont les poèmes lyriques
& élégiaques étoient fi eflimés, que Pindare
lui-même en avoir fait l’éloge dans des ouvrages qui
fe font per lus , mais qui exifloient du temps de
'Paufanias & de Plutarque. Parmi les autres mu-
ficiens-poètcs qui fe distinguèrent aux jeux pythie
ques , voici les principaux, dont la réputation s'étendit
dans toute la Grèce.
Àlcman, né à Sardes, flori/Toit environ 6jo ans
avant Jéfus-Chrifl. On dit qu’il fut efclave.à Sparte
dans fa jeunefTe , mais que fes bonnes qualités & fon
génie lui acquirent la liberté, & un rang diflingué
parmi les poètes lyriques. Il jouoit parfaitement de 1a
ly re , & il excelloit à chanter des vers au fon de I4
flûte , à compofer de la mufique pour les choeurs de
danfe, & furrouc des chanfons d’amour & de ga lan t
terie. Il fut un des grands muficiens que les Lacédé-r
moniens appelèrent, dans lesbefoins de l’E ta t , pour
chanter des airs au fon d e là flûte, & pour animer
leurs troupes, habituées à être guidées par cet inflru-
ment dans toutes leurs évolutions.
Alcée , né à Mitylène , floriflbic , félon la chro*
nique d’Eusèbe, dans la quarante-quatrième Olym-*
piade, ç’ç ff-à -d irç , environ 604 ans ^vant Jéfus-*
G R E TH
C h î if l. Il quitta le fervicc militaire pour celui des
mufes, après avoir eu, comme Avchiloque-l’avoir eu
avant lui, & comme Horace l'eut après, la honte de fuir
dans le combat & de perdre fon bouclier. Son efprit
remuant & brouillon l’entraîna dans beaucoup d a-
ventures étrangères au fujet que nous traitons. Quant
à fes talens, il excella également dans la poéfîe & dans
la mufique j il compoia des odes, des nymnes , des
épigràmmes. Ses v er s, tantôt menaçans, tantôt tou-
chans & plaintifs, étoient, félon Quintilien, graves ,
concis , magnifiques , fententieux , & fi approchans
de ceux d’Homère, qu'Horace lui a donné avec
uflice une lyrç d’or.
E t te fonantem pleniùs aureo
ALc.ce pleltro.
Il fut contemporain & compatriote de Sappho, dont
on allure même qu’il fut violemment épris.
Les Aventures de Sappho & les refies précieux de
fes poéfies font trop connus , pour qu’il foit befoin
d ’entrer à ce fujec dans aucun détail. Parlons plutôt
d une invention mufiçale qui lui efl attribuée. Arif-
toxène & Plutarque difent qu’elle inventa A mode
mixolydien. Le-mode lydien étoit le plus élevé des,cinq
modes originaux, ayant pour fon plus bas fon, pour fa
corde projlambanoijiéne, la note qui correfpondoic a
notre fa # fur la quatrième ligne de la baffe. Le mixolydien,
inventé par Sappho, étoit encore un demi-ton p us
haut; & l’on y ajouta depuis , à la tierce mineure au-
ddlîis, le mode hypermixolydien , & l'hyper lydien à la
quarte- Platon voulant Amplifier la mufique, 8c renfermer
l’échelle dans des bornes plus modérées, fe
plaint , dans le troifième livre de fa République , de
la licence de ces modes aigus , dont celui de Sappho
étoit l ’origine.
Si la feule différence entre les modes étoit la
place qu’ils occupoient dans le grand fyfïêmç, au
grave ou à l’aigu , cette invention du mode mixoly-
dienpouvoit avoir été fuggéréc à Sappho par l’ etendue
de fa voix, qui étoit peut-être plus haute que celle des
poètes-rauficiens qui l’avoient précédée : ceux qui
vinrent après elle , avec des voix plus baffes , voulant
chanter,fur ce même, mode , & même fur des modes
encore plus élevés , offenfèrent l’ oreille de Platon ,
qui défendit, dans fa république , l’ufage de ces
modes , comme indécens & trop efféminé?, même
pour des femmes.
Si le caractère des modes dépendoit auffi en partie
du rhythme ou de- la cadence , il n’efLpas invraifem-
blablc qu’outre l’a différence , de diapafon, la nouveauté
du mode mixolydien de Sappho eonfîflât fur-
tout à appliquer à1 la mélodie , la mefure .appelée
fapphique, qui étoit de fon invention. Mais comment
cette mçfure & cette élévation du mode lui don-
noicnt-ellescecaraélère indécent & efféminé qui avoit
bleffé Platon? G ’çfl là ce que nous ne pouvons comprendre,
non plus que bien d’autres myflères de cette
ancienne mufique grecque.
Vers le commencement du fixième fiècle avant j
GRE
I'ère chrétienne , Mimnerme, félon Plutarque , le
rendit Fameux en jouant fut la flûte un nome ,, ou
chanfon , appelé Cradias : c’étoic un air pour cet
infiniment, qu’on exécutoit d’ordinaire à Athènes
durant la marche ou proceffion des viélimes expiatoires.
C e Mimnerme étoit poète lyriqu e, & par
conféquent muficien; il étoit de Smyrne, & contemporain
de Solon. Athénée lui attribue 1 invention
du vers pentamètre ; & fes élégies étoient fi eflimées
de l’antiquité', qu’Horace les préfère à celles de
Callimaque (1). Il n’en refte que peu de fragment.
Le premier que l’ordre chronologique nous préfente,
après Mimnerme, efl St e s ic h o r e , poè'e
fameux, né à Himera , en Sicile. Son premier nom
étoit Tifîas. O 'lu i de Stefichore ( "ZTtiri^ofos ) lui
fut donné à caufe des changemens qu’il fit dans la
manière d’exécuter le choeur du dithyrambe, qui fe
chantoit en danfant autour de l’autel- ou de la flatuc
de Bacchus. Ses poéfies nômbreufes, dont nous n’avons
que quelques refies, exifloient encore du temps
de Quintilien. Plutarque, en parlant de fes talens
pour la mufîque, cire les changemens qu’il fit dans
l’air harmatien ou l’air du charriot, compofé par
Olympus.
Simonides floriffoit vers le même temps. Il naquit
à C é o s , l'âne des Cy c lad e s, l’an 538 avant Jéfus-
C h r i f l, & mourut à quatre-vingt-dix ans. Il fut le
maître de Pindare. Toute l’antiquité parle de fon
talent poétique, de la douceur, de la tendrefïe,
& même de la triflefle de fes v ers, à qui Catulle
donne le nom de larmes, Moejlius lacrymis Simoni-
deis : il obtint à quatre-vingts ans le prix de poéfîe
dans les jeux publics. Pline lui attribue l’addirion de
la huitième corde de la lyre ; mais les favans ne font
pas là-deffus d’accord avec Pline,
. Pindare, dont l’é lo g e , comme poète, efl fait
lorfqu’on l’a nommé , naquit à Thèbes , en Boeotie ,
environ 5 2.0 ans avant notre ère. Il reçut fes premières
inllruélions muficales de fon père, qui étoit
joueur de flûte de profeffion. Il fut mis enfuite à
l ’école de Myrtis , femme diflinguée par fon raient
pour la poéfîe lyrique. La célèbre Corinne y étoit
avant lu i , & Plutarque dit que le jeune Pindare profita
plus de (es leçons que de celles de leur manrefle
commune. Il pafia de cette école à celle de Simo-
nides, qui étoit alors extrêmement vieux. Les combats
de poéfîe & de mufique étoient alors tellement
à la mode .dans toutes Jes grandes villes de la
Grè ce , qu’on ne pouvoit guère acquérir de réputation
dans ces deux arts , fans paroître fur la lifle
des dombatans. Pindare fe diflingua bientôt dans
cette carrière : il y eut fouvént pour émule cette
même Myrtis & cette même Corinn e, dont l’une
étoit pour ainfî dire fa mère , & l’autre fa foeur en
poéfîe. 11 vainquit Myrtis ; mais il fut. vaincu cinq
fois par Corinne. Paufanias en conclut que les juges
j (1)\Epift.- liv. II. Ep. 1. v. 101.