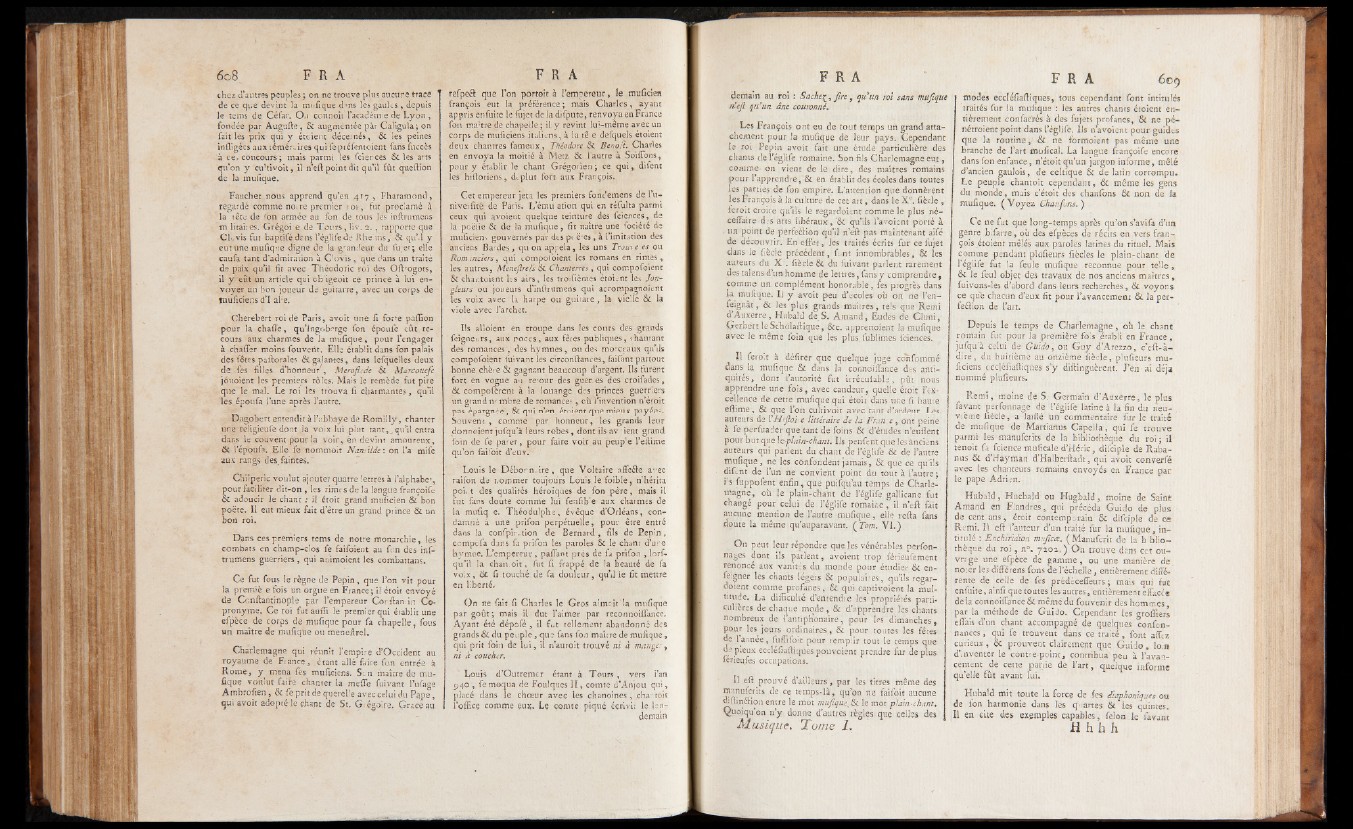
chez d’autres peuples ; on ne trouve plus aucure trace •
de ce que devint la mufique dms les gauks, depuis
le te ms de. Céfar. On connoît l’académie de Lyon ,
fondée par Augufte, & augmentée par Caligula; on
fait les prix qui y étcient décernés, ôc les peines
infligées aux témérùres qui fepréfentoient fans fuccès
à cea concours; mais parmi les fcierces & les arts
qu’on y cukivoit, il n’eft point dit qu’il fût queflion
de la muftque.
Fauchet nous apprend qu’en 4T7 , Fharamond,
regardé comme noire premier roi , fut proclamé à
la tête de fon armée au fon de tous lés inftrumens
m lirai;es. Grégoi e de Tours, liv. 2. , rapporte que
CLvis fut baptifédans l’églifede Rhe ms, & qu’.l y
eut une mufique digne de la grandeur du fujet; elle
caufa tant d’admiration à CUwis , que ('ans un traité
ds paix qu’il fit avec Théodoric roi des Ofkogots,
il y eût un article qui cb’igeoit ce prince à lui envoyer
un bon joueur de guitarre, avec un corps de
jnuficiens d’I al-e.
Cherebert roi dé Paris, avoit une fi forte pafiion
pour la chafle, qu’lngobsrge fon époufe eût recours
aux charmes de la mufique, pour l’engager
à chaffer moins fouverit. Elle établit dans fon palais
des fêtes paftorales & galantes, dans lefqüélles deux
de fës filles d’honneur , Mcroflede Ôc Marcouefie
jouoient les premiers rôles. Mais le remède fut pire
que le mal. Le roi les trouva fi charmantes , qu’il
les époufa l’une après l’autre.
Dagobert entendît à l’abbaye de Romilly, chanter
ur.e religieufe dont ,1a voix lui .plut tant,,qu’il entra
dans le couvent pour la voir, èn devint amoureux,
& l’époufa. Elle- fenommoit Nannlde : on l’a mife
aux rangs des, fairites.
Chilperic voulut ajouter quatre lettres à l’alphabe',
pour faciliter dit-on , les rimes de la langue françoife
& adoucir le chant : il étoit grand muficien & bon
poète. Il eut mieux fait d’être un grand piince ôc un
bon roi.
Dans ces premiers tems de notre monarchie, les
combats en champ-clos fe faifoient au fon des inftrumens
guerriers, qui animoient les combattans.
Ce fut fous le règne de Pépin, que l’on vit pour
la premiè e fois un orgue en France; il étoit envoyé
de Ccnftantinople par l’empereur Cor flan.in Co-
pronyme, Ce roi fut aum lè premier qui établit une
efpèce de corps de mufique pour fa chapelle fous
»n maître de mufique ou meneflrel.
Charlemagne qui réunit l’empire d’Occident au
royaume de Fiance, étant allé faire fon entrée à
Rome, y mena fes muficiens. 5c.n maître de mm-
fique vouiut faire chanter la mefTe fuivant l’ufage
Ambrofien, & fe prit de querelle avec celui du Pape,
(jui avoit adopté le phant de St. Grégoire. Grâce au
rêfpeéf que l’on portoit à l’empereur, le muficien
françois eut la préférence ; mais Charles, ayant
appris enfuite le fujet de la difpute, renvoya en France
fon tna'tre de chapelle ; il y revint lui-même avec un
corps de muficiens italiens, à la te è defquels étoient
deux chantres fameux, Théodore & Benoit. Charles
en envoya la moitié à Metz & l'autre à Soiflons,
pour y établir le chant Grégorien ; ce qui, difent
les hiftoriens, déplut fort aux François.
Cet empereur jeta les premiers fondemens de l’u-
niveifité de Paris. L ’ému ation qui en réfulta parmi
ceux qui avoient quelque teinture des fciences, de
la pcëlie & de la mufique, fit naître une fociété de
muficien-. gouvernés par des pi ë*es, à l’imitation des
anciens Bardes, qu on appela, les uns Trouve es ou
Romanciers, qui compofoient les romans en rimes,
les autres, MenefireCs Ôc Chanterré’s , qui compofoient
& char.toient k s airs, les troifièmes étoient les Jongleurs
ou joueurs d’inftrumens qui accompagnoient
les voix avec la harpe ou guitare , la vielle ôc la
viole avec l’archet.
Ils alloient en troupe dans les cours des grands
feigneurs, aux noces, aux fêtes publiques, (hantant
des romances, des hymnes, ou des morceaux qu’ils
compofoient fuivant les circonftances, faifant partout
bonne chère & gagnant beaucoup d’argent. Ils turent
fort en vogue au rerour des guer.es des croifades,
& compofèrent à la louange des princes guerriers
un grand n' mbre de romances, où l’invention n’étoit
pas épargnée, & qui n’en étoient que mieux payée'.
Souvent , comme par. honneur, les grands leur
donnoient jufqu’à leurs robes, dont ils av rient grand
foin de fe parer, pour faire voir au peup’e l’eftime
qu’on faifoit d’eux.
Louis le Débornrire, que Voltaire affeéle arec
raifon de nommer toujours Louis, le foible, n hérita
pot. t des qualités héroïques de fon père, mais il
fut fans doute comme lui fenftb'e aux charmes de
la mufiq. e. Théodulphe, évêque d’Orléans, condamné
à une prifon perpétuelle, pour être entré
dans la confpir<.tion de Bernard, fils de P.epin,
compcfa dans fa prifon les paroles & le chant d’ure
hymne. L’empereur , paflant près de fa prifon , lorsqu'il
la chan.oit, fut fl frappé de la beauté de fa
voix, Ôc fl touché de fa douleur, qu’il le fit mettre
en libertés
On ne fait fl Charles le Gros aimeit la mufique
par goût ; mais il dut l’aimer par reconnoiffance.
Ayant été dépofé, il fut tellement abandonné des
grands & du peuple , que fans fon maître de mufique,
qui prit foin de lui, il n’auroit trouvé ni à manger,
ni à coucher.
Louis d’Outremer étant à Tours, vers l’an
940 , fe moqua de Foulques I I , comté d’Anjou qui,
placé dans le choeur avec les chanoines, ,cha ;toit
l’pfficç comme çux, Le comte piqué écrivit le lsndemain
demain au roi : Sache1 , fire, qu*un roi sans mufique
rCefi qu’un âne couronné.
Les François ont eu de tout tenjps un grand attachement
pour la mufique de leur pays. Cependant
le roi Pépin avoit fait une étude particulière des
chants de l’églife romaine. Son fils Charlemagne eut,
comme- on vient de le dire, des maîtres romains
pour l’apprendre, & en établit des écoles dans toutes
les parties de fon empire. L'attention que donnèrent
les François à la culture de cet art, dans le X e. fiècle,
feroit croire qu’ils le regardoient comme le plus né-
ceffaire drs arts libéraux, 'ôc qu’ils l’a voient porté à
- un point de perfection- qu’il n’eft pas maintenant aifé
de découvrir. En effet, les traités écrits fur ce fujet
dans le fiècle précédent, font innombrables, & les
auteurs du X '. fiècle ôc du fuivant parlent rarement
des talensd’un homme de lettres, fans y comprendre,
comme un.complément honorable, fes progrès dans i
la mufique. Il y avoit peu d’écoles oh on ne l’en-
feignât, & les plus grands maîtres, tels que Remi
d’Auxerre, Hubald de S. Amand, Eudes de Cluni,
Getbèrt le Sthdlaftique, &c. apprenoient la mufique
avec le même foin que les plus, fublimes fciences.
Il feroit à délirer que quelque juge cohfommé
dans la mufique & dans la connoiflance des antiquités,
dont i’autprité fut irréculable , put nous
apprendre une fois, avec candeur, quelle étoit l’excellence
de cette mufique qui étoit dans une fi haute
eftime, & que l’on cultivoit avec tant d’ardeur. Les
auteurs de \ H fiohe littéraire de la Bram e , ont peine
à fe perfuadêr que tant de foins & d’études n’euflent
pour but que 1 eplain-chànt. Ils penfent que les "anciens
auteurs qui parlent du chant de Péglife & de l’autre
mufique, ne les confondent jamais, & que ce qu'ils
diftnt de l’un ne convient point du tout à l’autre;
i s fuppofent enfin, que puifqu’au temps de Charlemagne,
où le plain-chant de l’églife gallicane fut
changé pour celui de l’églife romaine, il n’eft fait
aucune mention de l’autre mufique, elle refta fans
doute la même qu’auparavant. ( Tom. V I.)
On peut leur répondre que les vénérables perfon-
nages dont ils parlent, avoient trop férieufement
renoncé aux vanités du monde pour étudier & en-
feigner les chants légers & populaires, qu’ils regar-
êoient comme profanes, & qui captivoient la multitude.
La difficulté d’entendre les propriétés particulières
de chaque mode, & d’apprendre les chants
nombreux de l’antiph'onaire, pour les dimanches,
pour les jours ordinaires., & pour toutes les fêtes
de l’année, fuffifoit pour remplir tout le temps que
de preux eedéfiaftiques pouvoient prendre fur déplus
férieqfes occupations.
Il eft prouvé d’ailleurs, par les titres même des
manuferits de ce temps-là, qu’on ne faifoit aucune
diftin&ion entre le mot mufique. & le mot p/ain-ckant.
Quoiqu’on n’y donne d’autres règles que celles des
Musique. Tome 1.
modes eedéfiaftiques, tous cependant font intitulés
traités fur la mufique : les autres chants étoient entièrement
confacrés à des fujets profanes, & ne pé-
nétroient point dans l’églife. Ils n’a voient pour guides
que la routine, & ne formoient pas même une
branche de l’art mufical. La langue françoife encore
dans fon enfance, n’étoit qu’un jargon informe, mêlé
d’ancien gaulois, de celtique & de latin corrompu.
Le peuple chantoit cependant, & même les gens
du monde , mais c’étoit des chanfbns ÔC non de la
mufique. (V o y e z Chanfions.)
Ce ne fut que long-temps après qu’on s’avifa d’un
genre hifarre, où des efpèces de récits en vers françois
étoient mêlés aux paroles latines du rituel. Mais
| comme pendant plufieurs fiècles le plain-chant de
l’églife fut la feule mufique reconnue pour telle,
& le feul objet des travaux de nos anciens maîtres,
fuivons-les d’abord dans leurs recherches, & voyons
ce que chacun d’eux fit pour l’avancement &. la per-
feéfion de l’art.
Depuis le temps de Charlemagne, où le chant
romain fut pour la première fois .établi en France,
jufqu à celui de Guïdo, ou Guy d’Arezzo, c’eft-à-
dire, du huitième au onzième fiècle, plufieurs muficiens
eedéfiaftiques s’y diftinguèrent. J’en ai déjà
nommé plufieurs.
Rémi, moine de S. Germain d’Auxerre, le plus
favarit perfonnage de Péglife latine à la fin du neuvième
fiècle, a laifle un commentaire fur le traité
de mufique de Martianus Capeila, qui fe trouve
parmi les manuferits de la bibliothèque du roi; il
tenoit fa fcience muficale d’Héric, difciple de Raba-
nus ôc d’Hayman d’Halberftadt, qui avoit converfé
avec les chanteurs romains envoyés en France par
le pape Adrien.
Hubald, Hucbald ou Hugbald, moine de Saint
Amand en Flandres, qui précéda Guido de plus
de cent ans, étoit contemporain & difciple de ce
Remi. Il eft l’auteur d’un traité fur la mufique, intitulé
: Enchiridion muficæ. (Manufcrit de la b blio-
thèque du roi , ri0. 7202.) On trouve dans cet ou-
vrrge une efpèce de gamme, ou une manière de.
rioier les différens fons de l’échelle, entièrement différente
de celle de fes prédéceffeurs ; mais qui fut
enfuite, ainfi que toutes les autres, entièrement effacée
delà connoiflance & même du fouvenir des hommes
par la méthode de Guido. Cependant les greffiers
effais d’un chant accompagné de quelques confcn-
nances, qui fe trouvent dans ce traité, font allez
curieux, & prouvent clairement que Guido, loin
d’inventer le contre-point, contribua peu à l’avancement
de cette partie de l’art, quelque informe
qu’elle fût avant lui.
Hubald mit toute la force de fes diaphoniques ou
de fon harmonie dans les quartes & les quintes.
Il en cite des exemples capables, félon le lavant
H h h h