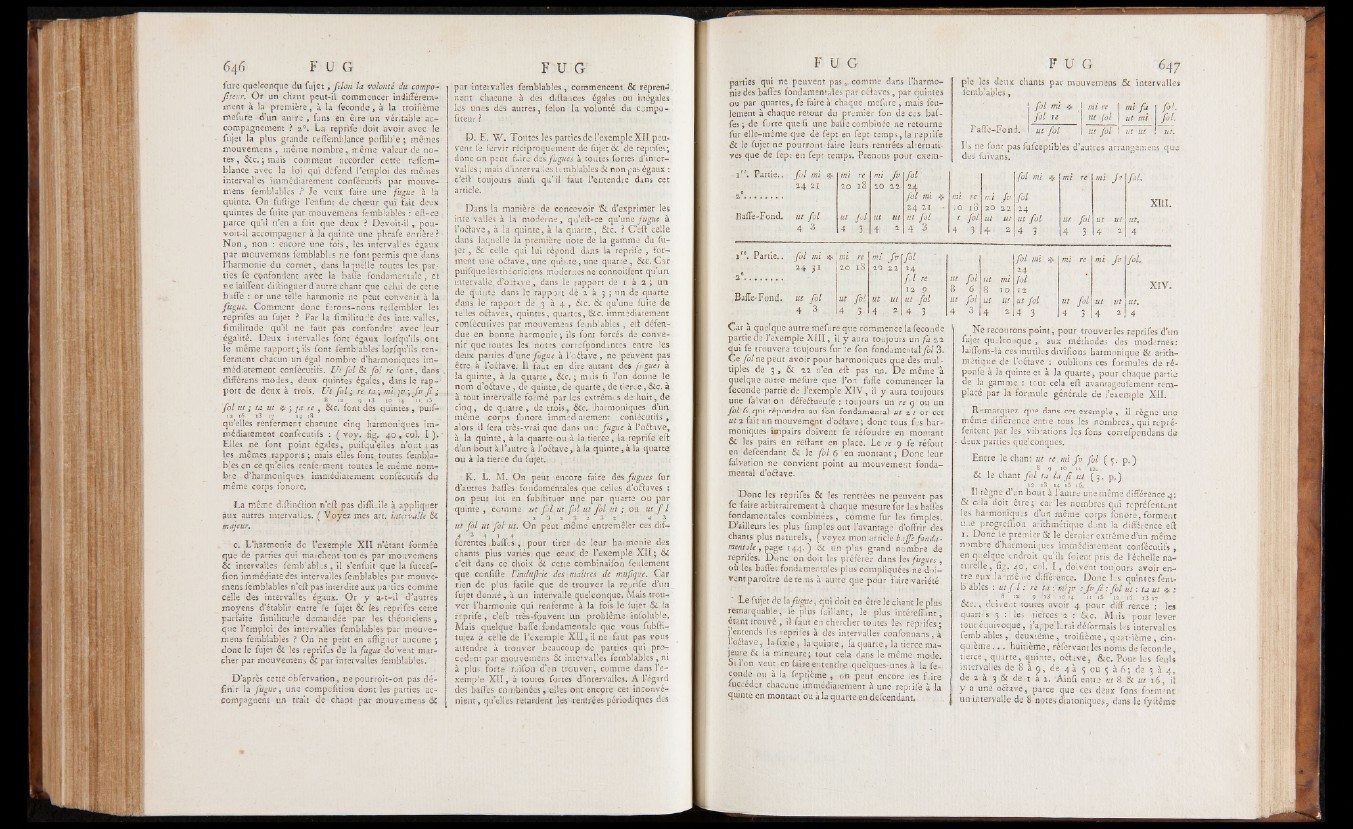
fu r e que lconque du f u j e t , félon la volonté du cornpo-
fiteur. O r un chant p eu t-il c om m en c e r indifféremm
en t à la p r em iè r e , à la fé c o n d é , à la troifième
m e fu r e d’un a u tre , fans en ê tre un v é r itab le ' a c com
p a gn em en t ? 20. L a reprïfe d o it a v o ir a v e c le
fuje t la plus grande reflemblance p o f îib le ; mêmes
m o u v em en s , m êm e n om b r e , m êm e v a leu r de no tes
, & c . ; mais com m en t a c co rd er c e tte r e ffem -
b lance a v e c la lo i q u i dé fend l’ em p lo i des mêmes
in te rv a lle s immédiatement confécutifs p a r m o u v e mens
femb lab les ? Je v eu x faire un e fugue à la
quinte . O n fu flig e le n f a n t .d e choe u r q u i fait deux
qu in te s de fu ite par m o u v em en s femb lab les : e i l- c e
p a rc e quM n’en a fait q ue deux ? D e v o i t - i l , p o u -
v o it - il a c com p a gn e r à la quinte une phra fe entiè re?
N o n , n on : encore une f o i s , les in te rv a lle s é g a u x
p a r m ou vemen s fem b lab lts ne font permis qu e dans
l ’ha rmonie d u c o rn e t , dans la q u e lle toutes les p a r t
ie s fe confondent a v e c la baffe fo n d am e n ta le , et
n e laiffent diftingu er d ’au tre chant q ue ce lu i de cette
b a f fe : o r une telle h a rmonie ne peut con v en ir à la
fugue. C om m e n t d o n c fe ro n s -n o u s re ffem b le r les
rep r ife s au fujet ? Par la f im ilitu fe des in te .v a lle s ,
fim ilitu d e qu ’il n e fau t pas confondre a v e c leur
é g a lité . D e u x interv a lle s fon t ég au x loi-fqu’ils o n t
l e m êm e r a p p o r t ; ils fo n t femb lab les’ lorsqu’ils ren ferm
en t ch acun un ég a l nombre- d’harmoniques im m
éd ia tement confécutifs. Ut fol & fo l re f o n t , dans
d ifféren s m o d e s , d e u x q uinte s é g a lé s , dans le r a p - :
p o r t de d e u x à trois. Ut fol ; re ta\mi.iv,',Jvfi;
8 12 9 i 3 10 14 h . id
fo l ut ; ta ut ; ja. re , & c . fon t des q u in te s , puif--
12 16 i 3 17 14 18
q u ’elles renferment ch acune cinq ha rmonique s im méd
ia tement co n fé cu tifs : f y o y . fig. 40 ,, co l. I ) . •
E lle s ne fon t p o in t é g a le s , pu ifqu ’e lle s n ’o n t pas
le s mêmes rapports ; mais elles fo n t toutes fem b la -
b es en ce qu’elle s renferment tou te s le m êm e nomb
re: d’ha rmoniquçs. immédiatement confécutifs du
m êm e co rps fon ore .
L a même diftinêlion n’eft pas d ifficile à ap pliquer
au x autres in tervalle s. ( V o y e z mes art: intervalle &
piajeur.
c . L ’ha rmonie d e l’ e x em p le X I I n’ étant formée,
q u e de parties qu i marchent -tou-, es par m ou v em en s
& intervalle s fèm b ’a b k s , il s’enfuit' q u e la fu ce e f-
fion immédiate des intervalle s fem b la b le s par m o u v e mens
femblables n’eft pas interdite au x parties com m e
c e lle des interv a lle s égaux . O r y a r t - i l ' d ’autres
m o y e n s d’é tablir entre le fujet & les reprife s cette
pa rfa ite fim ilitu d e demandée par les -théoriciens ,
q u e l’em p lo i des interv a lle s femblables par m o u v e m
en s femblables ? O n ne peùt en a flign er aucune ;
d o n c le fujet & les reprife s d e la fugue d o 'v en t march
e r p a r m ou v em en s ôç par intervalle s femb lab les. '
D ’après c e tte o b fe r v a tio n , ne p o u r ro it-o n pas d é fin
ir la fugue, une com p c fitio n dont les parties accomp
agn en t un trait de chant pa r m o u y em en s &
par intervalles femblables , commencent & reprennent
chacune à des d,fiances égales ou inégales
les unes des autres, félon la volonté du cornpo-
fiteur ?■
D. E. W . Toutes les parties de l’exemple XII peuvent
fe fervir réciproquement de fujet ÔC de reprifes;
donc on peut faire des fugues à toutes fortes d’intervalles
; maïs d’intervalles ltmblables & non pas égaux :
c’eft toujours ainfi qu’ il faut l’entendre dans cet
article.
Dans la manière de concevoir ’& d’exprimer les
intervalles à la moderne, qu’eft-ce qu’une fugue à
l’oétave, à la quinte, à la quarte, &c. ? C ’eft celle
dans laquelle la première note de la gamme du fujet
, & celle qui lui répond dans la reprife , forment
une oêlave, une quinte, une quarte, &c. Car
puifque les théoriciens modernes ne connoiffent qu’un
intervalle d’o Slave , dans le rapport de 1 à 2 ; un
de quinte dans le rapport dé 2 à 3 ; un de quarte
dans le'rapport de .3 à 4 , &c. & qu’une fuite de
telles oélaves, quintes, quartes, &c, immédiatement
confécutives par mouvemens femblables , eft défendue
en. bonne, harmonie; ils font forcés de convenir
que routes les notes correfpondantes entre les
deux parties-d’une fugue à l’oélave, ne peuvent pas
être à l’ociave. Il faut en dire ^autant des fugues à
la quinte, à la quarte, &c. ; nuis fi l’on donne le
nom d’o â a v e , de quinte, de quarte, de tierce, &c. à
à tout intervalle formé par les extrêmes de'huit, de
cinq, de quatre , de trois, &c. .harmoniques d’un
même -corps fonore immédiatement confécutifs,
alors il fera très-vrai que dans uns fugue à Poêlavë,
à la quinté, à la quarte ou à la tierce, la reprife :eft
d’un bout à. l’autre à i’o6tave,à,la quinte , à la quarte'
ou à la tierce du fujet.,
K. L. M. On peut '.encore faire des fugues fur
d’autres baffes fondamentales que celles d’oélaves ;
on peut lui en fubftjtuer une par quarte ou par
quinte, comme ut f i l ut.fol ut fo lu t ou ut f l
’ • 2 3 ; 2 13 ' 2 . 3 2 ' a 4' ' j
ut fol ut fol' üt. On peut même entremêlef ces dif-
4 3 4 3 4
féréntes .baffes , pour tirer ;de leur harmonie des
chants plus variés que ceux de l’exemple XII; &
c’eft dans cè; choix 6c cette combinaifon feulement
que confifte l’induJlrïè des maîtres de mufique. Cap
rien de plus facile que de trouver la reprife d’un
fujet donné, à un intervalle quelconque. Mais troun
ver l’harmonie qui renferme à la fois le fujet ôc la
nprife, c’eft très-fouvent un problème infoluble.
Mais quelque -baffefondamentale que vous fubfti-
tuiez à cèllë dè l’exemple X I I , il ne faut pas vous
attendre à trouver beaucoup de parties qui procèdent
par mouvemens & intervalles femblables , ni
à plu, forte raïfond’én trouver, comme dans l’exemple
X II, à toutes fortes d’intervalles. A l’égard
des baffes combinées, elles Ont encore cet inconvénient,
quelles retardent les 'rentrées périodiques des
parties qui ne peuvent p ascomme dans l’harmonie
des baffes fondamentales par oélaves, par quintes
ou par quartes, fs faire à chaque mefure , mais feulement
à chaque retour du premier fon de ces baffes;
de forte que fi Une baffe combinée ne retourne
fur elle-même que de fept en fept temps, la reprife
& le fujet né pourront faire leurs rentrées alternatives
que de fept en fept temps. Prenons pour exem-
F U G 6 4 7
pie les deux chants par mouvemens
femblables,
Sl intervalles
! fol mi # j mi re I mi fa 1 f o l
' J fo l re 1 u t fo l 1 ut mi \ fol.
Faffe-Fond. 1 u t fol 1 u t fo l ! u t u t . u t .
IU ne font pas fufceptibles d’autres arrangemens que
des fuïvans.
i re. P a r tie .. f o l mi % rni re mi f v m m ' fo l mi ❖ mi re mi J ? fo l.
2 4 21 20 18 20 22 H
2 e......... .. fo l m\ # mi re. mi k fo l
24 2 1 - 18 20 22 24
B a lle -F o n d . ut fo l ut M Ut Ut ut fo l . j t fo l ut ut ut fo l ut fo l ut ut Ut.
4 3 , . 4 3 4 * 4: ?. 4 •*v 4 - 2 4 3 4 3 4 ' 2 4
i re. P a r tie .. fo l mi & mi re mi Jv m fo l mi ❖ mi re mi > fol.
2 4 31 20 18 20 22 24 24
2 e.................... f i l re ut fol ut mi (ol
1 2 9 8 ô 8 10 •12
B a ffe-P on d. ut fo l ut M ut . ut ut fo l Ut fol ut ut ut fol ut fol ut ut ut.
4 , £ a ;.. 4 3 4 . * 4 3 4 3 4 * 4 3 4 3 4 2 4
Car à quelque autre mefure que commence la fécondé
partie de l’exemple XIII, il y aura toujours un fa 22
qui fe trouvera toujours fur îe fon fondamental./^/ 3.
Ce fol ne peut avoir pour harmoniques que des multiples
de 3 , & 22 n’en eft pas un. De même a
quelque autre mefure que l’on faffe commencer la
fécondé partie de l’exemple X IV , il y aura toujours
une falvatlon défeâueufe : toujours un re q ou un
f o l 6 qui répondra au fon fondamental ut 2: or cet
ut 2 fait un mouvement d’oéWe ; donc tous fes harmoniques
impairs doivent fe réfoudre eh montant
& les pairs en reliant en place. Le re 9 fe réfout
en defeendant & le fo l 6 en montant ; Donc leur
falvation ne convient point au mouvement fondamental
d’oélave.
Donc les reprifes & les rentrées ne peuvent pas
fe faire arbitrairement à chaque mesure fur les baffes
fondamentales-combinées , comme fur les fimples.
D ’ailleurs les plus fimples' ont l’avantage d’offrir des
chants plus naturels, ( voyez mon article baffe fondamentale
, page 144.) & un plus grand nombre de
reprifes. Donc on doit les préférer dans les fugues,
où les baffes fondamentales* plus compliquées ne doivent
paroître- de te ms à autre que pour faire variété.
' Le fujet dé la fugue, qui doit en être le chant le plus
remarquable ; le plus Iaillant, le plus ihtéfeffant,
étant trouvé , il faut en chercher toutes les reprifes;
j’entends fes reprifes à des intervalles confonnans, à
lloêlave, la-fixte, la quinte , la quarte, la tierce majeure
& la mineure; tout cela clan,s le même mode.
Si l’on veut,-en faire entendre quelques-unes à la fécondé
ou à la feptjème * oh peut encore i.es Tire
fuçcéder chacune immédiatement à une reprife à la
quinte en montant ou à la quarte en defeendant.
Né recourons point, pour trouver les reprifes d’un
fujet quelconque, aux méthodes des modernes:
! laifforts-là ces inutiles divifions harmonique & arithmétique
de l’oêlave : oublions ces formules de ré-
ponfe à la quinte et à la quarte, pour chaque partie
de la gamme : tout cela eft avantageufement remplacé
par la formule générale de l’exemple XII.
Remarquez que dans cet exemple, il règne une
meme différence entie tous les nombres,, qui repré-
fentent par les. vibrations les fon,s correfpondans de
_* deux parties quelconques.
Entre le chant ut re mi Jv fol ( 5 . p .)
& le chant fo l ta lat f i ut ( 3. p.)
■ 12 i 3 14 i5 16., , .. t .
Il règne d’un bout à l'autre une même différence 4:
- & cela doit être; car les nombres qui repréfentent
les harmoniques d’un même corps fonore, forment
une progrèffion arithmétique dont la différence eft
1. Donc le premier & le dernier extrême d’un même
nombre d’harmoniques immédiatement confécutifs ,
en quelque endroit qu’ils foient pris de l’échelle na-
tufèlle, fig. 40, col. I , doivent toujours avoir entre
eux la'même différence. Donc les quintes feni-
b abîes : ut f A : re ta : mi jv : Jv f i : fo l ut : ta ut # ;
0 . 8 . 12 . 9 ;>3 " W 14 11 i S 12 i :6, i 3 17 '
; otc: , douent toutes avoir 4 pour diff.rence : les
| quart, s 3 : les tierces 2 : &c. Mais pour lever
tout équivoque, j’appe Lrai déformais les intervalles
femblables, deuxième , troifième,'quatrième , cin-
j quième. . . huitième, réfervant les noms de fécondé,
! tierce, quarte, quinte, odave, &c. Pour les feuls
; intervalles de 8 à 9 , de 4 à 5 ou 5 à 6 ; de 3 à 4 ,
de 2 .à 3 & de 1 a 2. Ainfi entre ut 8 & ut 16 , il
i y a une oêlave, parce que ces deux fons forment
|. un intervalle de 8 notes diatoniques 7 dans le fyftême