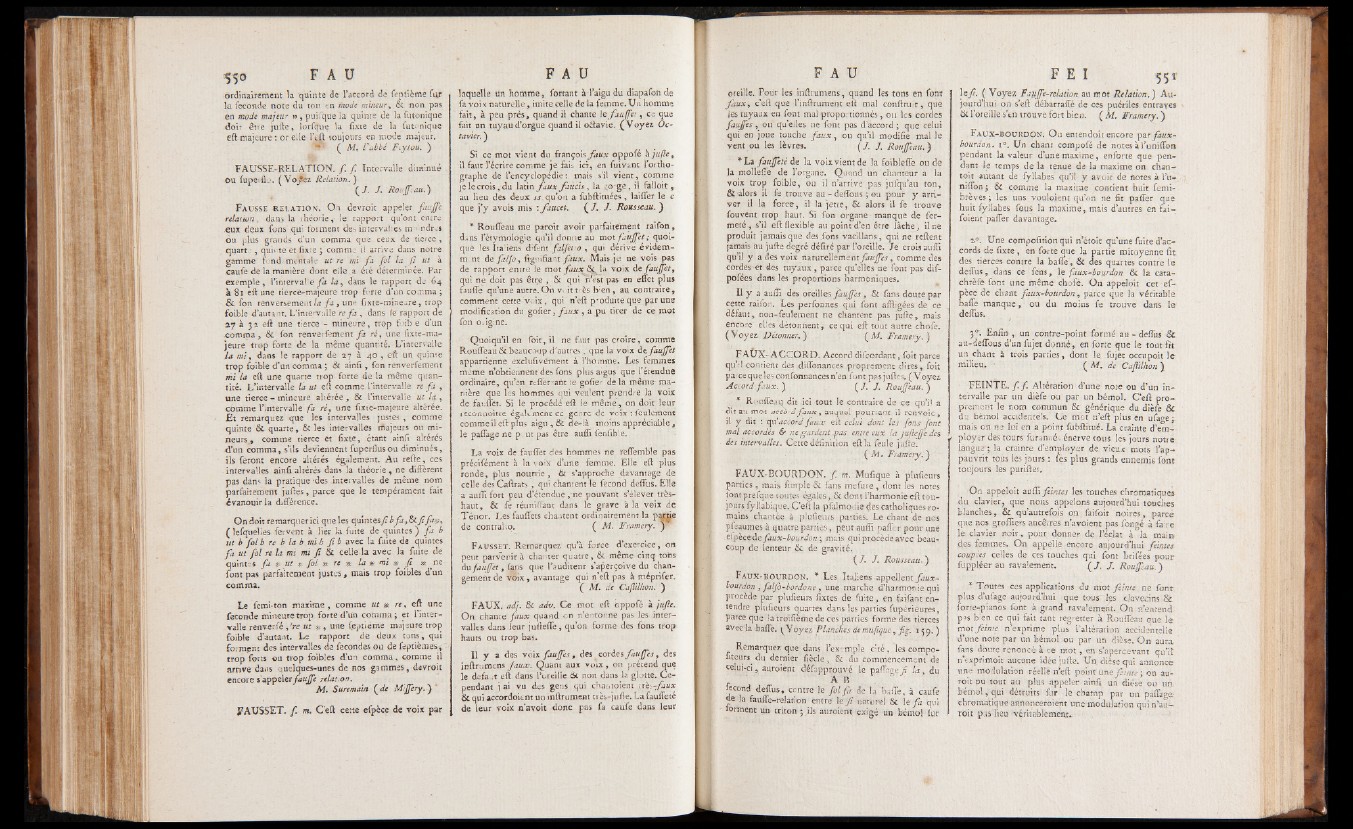
ordinairement la quinte de l’accord de feptième fur
la fécondé, note du ton en mode mineur, & non pas
en mode majeur- » , puifque'la quinte de la fütonique
doit être ju fte, lorfque la fixte de la futonique
eft majeure : or elle ! | f t toujours en mode majeur.
‘W* ( M. l ’abbé Fcyjou. )
F A U S S E -R E L A T IO N . f . f. Intervalle diminué
ou fuperflu. (V o jk z Relation. )
( 7 . J. Rouffeau.)
F aus se r e l a t io n . On devroit appeler fauffe
relation, dans la théorie, le rapport qu’ont entre
eu x deux fons qui forment des intervalles moindres
ou plus grands d’un comtna que ceux de tierce,
quarto , quinte et fixte ; comme il arrive dans notre
gamme fond- mentale ut re mi fa fol la f i ut à
.eaufe de la.manière dont elle ,a été déterminée. Par
exemple, l’intervalle fa la , dans le rapport de 64
à 81 eft une tierce-majeure trop fnrte d’un comma ;
& fon renversement la fa , une fixte-mineure, trop
foible d ’autant. L ’intervalle re fa , dans le rapport de
3 7 à 32 eft une tierce - mineure, trop foib e d’un
c om m a , & fon renverfement fa ré, une fixtë-ma-
jeure trop forte de la même quantité. L ’intervalle
la mi y dans le rapport de 27 à 40 , eft un quinte
trop foible d’un comraa ; & ainfi , ion renverfement
mi la eft une quarte trop forte de la même quantité.
L ’intervalle la ut eft comme l'intervalle re fa ,
une tierce - mineure a ltérée , & l’intervalle ut /<£,
comme l’ intervalle fa ré, une fixie-majeure altérée,
f it remarquez que les intervalles justes , comme
quinte & quarte, & les intervalles rfiajeurs ou mineurs
, comme tierce et fixte, étant ainfi altérés
d’un comma,.s’ils deviennent fu perdus ou diminués,
ils feront encore altérés également. A u refte, ces
intervalles ainfi altérés dans la th éo rie , ne different
pas dan« la pratique 'des intervalles de même nom
parfaitement juftes, parce que le tempérament fait
évanouir la différence.
O n doit remarquer ici que les quintesfib fa 38>Lfîfax,
( lefqueiies fervent à lier la fuite de quintes ) fa b
ut b fol b re b la b mi b f i b avec la fuite de quintes
fa ut fol re la mi mi f i & celle-là avec la fuite de
quintes fa & ut fol ■ » re % la » mi % f i * ne
font pas parfaitement justes , mais trop foibles d’un
comma.
L e femi-ton m ax ime , comme ut * re, eft une
fécondé mineure trop forte d’un comma ; et l’intervalle
renverfé, 're ut # , une Ijeptième majeure trop
foible d’autant. Le rapport de deux tons; qui
formant des intervalles de fécondés ou de feptièmes,
trop forts ou trop foibîes d’un comma , comme il
arrive dans uuelques-unes de nos gammes, devroit
encore s’appeler faujfe rclat.on.
M. Suremain ( de Miffery. ) '
J?AUSSET, f m. C ’eft certe efpèce de vo ix par
laquelle un homme, fortant à l’aigu du diapafon de
fa v o ix naturelle, imite celle de la femme. Un homme
fait, à peu près , quand il chante le fauffet, ce que
fait un tuyau d’orgue quand il oéiavie. £ V o y e z Oc-
tavier. )
Si ce mot vient du françoisjfoi«: oppofé &jufte,
il faut l’écrire comme je fais» ic i, en fuivant l’orthographe
de l’encyclopédie: mais s’il v ien t, comme
je le crois, du latin faux faùcis, la 40-ge, il falloit ,
au lieu des deux ss. qu’on a fubftituées, laiffer le c
que j’y avois mis : fiucet. { J , J. Rousseau. )
* Rouffeau me paroit avoir parfaitement raifon,
dins l’étymologie qü’il donne au mot fatijfet; quoique
les Itaiens dfient falfet/o , qui dérivé évidem-
m nt de falfo, figuifiant faux. Mais je ne vois pas
de rapport entre le mot faux la vo ix de fauffet,
qui ne doit pas êtr,e , & qui n'est pas en effet plus
fauffe qu’une autre. Orv voit très b :en , au contraire,
comment cette v o ix , qui n’eft produite que par une
modification du gofier, faux , a pu tirer de ce mot
fon origine.
Quoiqu’il en foit, il ne faut pas c ro ire , comme
Rouffeau & beaucoup d 'autres , que la voix àt fauffet
appartienne exclufivëment à l’homme. Les femmes
meme n’obtiennent des fons plus aigus que l’étendue
ordinaire, qu’en refferrant le gofie-- de la même- manière
que les hommes qui veulent prendre la voix
de fauffet. Si le procédé eft le mêmè, on doit leur
reconnoître également ce genre de voix : feulement
comme il eft plus a i g u ,& de-là moins appréciable,
le paffage ne p ut pas être auffi fenfible.
L a voix de.fauffet des hommes ne reffemble pas
précifément à la voix d’une femme. Elle eft plus
ronde, plus nourrie , & s’approche davantage de
celle des Caftrats, qui chantent le fécond deffus. Elle
a auffi fort peu d’étendue , ’ne pouvant s’élever très-
haut, & fe réunifiant dans le grave à la voix de
T én o r . Les fauffets chantent ordinairement la parfis
de contralto. ( M. Framery. y
Fausset. Remarquez q\i*à force d’exercice, on
peut parvenir à chanter quatre, & même cinq toits
du fauffet, fans que l’auditenr s’aperçoive du changement
de v ô ix , avantage qui n’eft pas à méprifer.
( M. de Cajlilhon. )
F A U X . ad). & adv. C e mot eft oppofé à jufle.
O n chante faux quand en n’entonne pas les intervalles
dans leur jufteffe, qu’on forme des fons trop
hauts ou trop bas.
Il y a des voix fauffes, des cordes fauffes, des
inftrumens faux . Quant aux v o ix , on prétend que
le defaut eft dans l’oreille 6c non dans la glotte. C e pendant
j ai vu des gens qui chantoient ixhb-faux
& qui accordoient un inftrument très-jufte. La fauffeté
de leur voix n’avoit donc pas fa caufe dans leur
oreille. Pour les inftrumens, quand les tons en font
faux-, c’eft que l’inftrument eft mal conftruit, que
les tuyaux en font mal proportionnés , ou les cordes
fauffes, ou quelles ne font pas d’accord ; que celui
qui en joue touche fa u x , ou qu’il modifie mal le
vent ou les lèvres. (J. J. Rouffeau.)
* La fauffeté de la vo ix vient de la foibleffe ou de
la molleffe de l’orgaiie. Qu*md un chanteur à la
voix trop foib le , ou il n’arrive- pas jufqu’au ton,
& alors il fe trouve au - deffous ; ou pour y arriver
il la fo r c e , il la je tte, & alors il fe trouve
fouvent trop haut. Si fon organe - manque de fermeté
, s’il eft flexible au point d.’en être lâch e, il ne
produit jamais que des fions vacillans, qui ne reftent
jamais au jufte degré défiré par l’oreille. Je crois aufli
qu’il y a des voix naturellement fauffes, comme des
cordes-et des tuyaux , parce qu’elles ne font pas dif-
pofées dans les proportions harmoniques.
Il y a aufli des oreilles fauffes , & fans doute par
cette raifon. Les perfonnes qui font affligées de ce
défaut, non-feulement ne chantent pas ju fte, mais
encore elles détonnent,' ce qui eft tout autre chofe.
(V o y e z Détonner. ) . (M . Framery.)
F A Ü X - A C C O R D. Accord difeordant, foit parce
qu’;! contient des diffonances proprement dite s, foit
parce queles confonnances n’en font pas juftes. (V o y e z
Accord faux. ) ( J. J. Rouffeau. )
* Rouffeau dit ici tout le contraire de ce qu’il a
dit au mot acco’d fa u x , auquel pourtant il ren vo ie ,
il y dit : a f accord faux eft celui dont les fons font
mal accordés & ne gardent,pas entre eux là jufteffe des
des intervalles. Cette définition eft la feule jufte.
( M. Framery. f
F A U X -B O U R D O N , f m. Mufique à plufieurs
parties , mais fini pie & fans mefure , dont les notes
lontprefque toutes égales, & dont l’harmonie eft toujours
fyllabique. C ’eft la pfalmouie des catholiques romains
chantée à plufieurs parties. Le chant de nos
pfeaumes à quatre parties, peut aufli paffer pour une
efpècede faux-bourdon ; mais qui procède avec beaucoup
de lenteur & de gravité.
( 7 . J. Rousseau, )
Faux-bourdon. * Les Italiens appellent faux-
bourdon, falfo-bordone , une marche d’harmonie qui
procède par plufieurs fixtes de fu ite, en faifant entendre
plufieurs quartes dans les parties fupérieures,
parce que latroifième de ces parties forme dès tierces
avec la baffe. ^ V o y e z Planches de mufique, fig. 1 5 9 .)
vitiiia icAvuipjç t.ic , .1« tüuipofiteurs
du dernier fiècle, & du commencement de
celui-ci, auroiènt défapprouvé le paffagejï l a , du
I 8 A B
lecond deffus, centre le fo l fa de la baffe, à caufe
de la fauffe-relatlon entre le f i naturel & le ƒ■ * qui
forment un triton ; ils auroiènt exigé un bémol fur
1zfi. ( V o y e z Fauffe-relatlon au mot Relation.) A u jourd’hui
on s’eft débarraffé de ces puériles entrayes
& l’oreille s tn trouve fort bien. ( M. Framery. )
Faux- bourdon. On entendoit encore par faux-
bourdon. i° . Un chant compofé de notes à l’uniffon
pendant la valeur d’une maxime, enforte que pendant
le temps de la tenue de la maxime on chan-
toit autant de fyllabes qu’il y avoit de notes à l’ü-
niffon ; & comme la maxime contient huit femi-
brèves; les uns vouloient qu’on ne fit paffer que
huit fyllabes fous la maxime, mais d’autres en fa i-
foient paffer davantage.
2°. Une compofitionqüi n’étoit qu’une fuite d’accords
de fixte , en forte que la partie mitoyenne fit
des tierces contre la b affe, & des quartes contre le
deffus, dans ce fens, le faux-bourdon & la cata-
chrèfe>font une même chofè. O n appeloit cet efpèce
de chant faux-bourdon, parce que la véritable
baffe man que, ou du moins fe trouve dans le
deffus. t
30. Enfin un contre-point formé au - deffus &
au-deffous d’un fujet donné, en forte que le tout fk
un chant à trois parties, dont le. -fujet occupait le
milieu. • ( M. de Cajlilhon )
F E IN T E , f . f. Altération d’une note ou d’un intervalle
par un dièfe ou par un bémol. C ’eft proprement
le nom commun & générique du dièfe &
du bémol accidentels. C e met n’eft plus èn ufage;
mais on ne lui en a point fubftitué. La crainte d’employer
des tours furannés énerve tous lés jours notre
langue ; la crainte d’employer de vieux mots l’appauvrit
tous les jours : fes plus grands ennemis font
toujours les puriftes.
O n appeloit auffi feintes les touches chromatiques
du clavier, que nous appelons aujourd’hui touches
blanches, & qu’autrefois on faifoit noire s, parce
que nos greffiers ancêtres n’a voient pas fongé à fa:re
le clavier noir , pour donner de leclat à la main
des femmesv O n appelle encore aujourd’hui feintes
coupées celles de ces touches qui font brifées pour
fuppléer au ravalement. ( J, / . Rouffeau. )
* Toutes ces applications du mot feinte ne font:
plus d’ufage aujourd’hui que tous les clavecins &
forre-,pianos font à grand ravalement. O n n’entend:
p?s bien ce qui fait tant regretter à Rouffeau que le
mot feinte n’exprime plus 'l’altération accidentelle
d ’une note par un bémoL ou par un dièse. O n aura,
fans doute renoncé à ce m o t , en s’apercevant qu’il
n ’exprimoit aucune idée jufte. Un dièse qui annonce-
une modulation réelle ffeft point une feinte ; on au-
roit pu tout au plus appeler ainfi un dièse ou un.
b émol, qui détruits fur le champ par un pafiaga
chromatique annonceroient une modulation qui n’aifi-
xoit pas lieu véritablement^