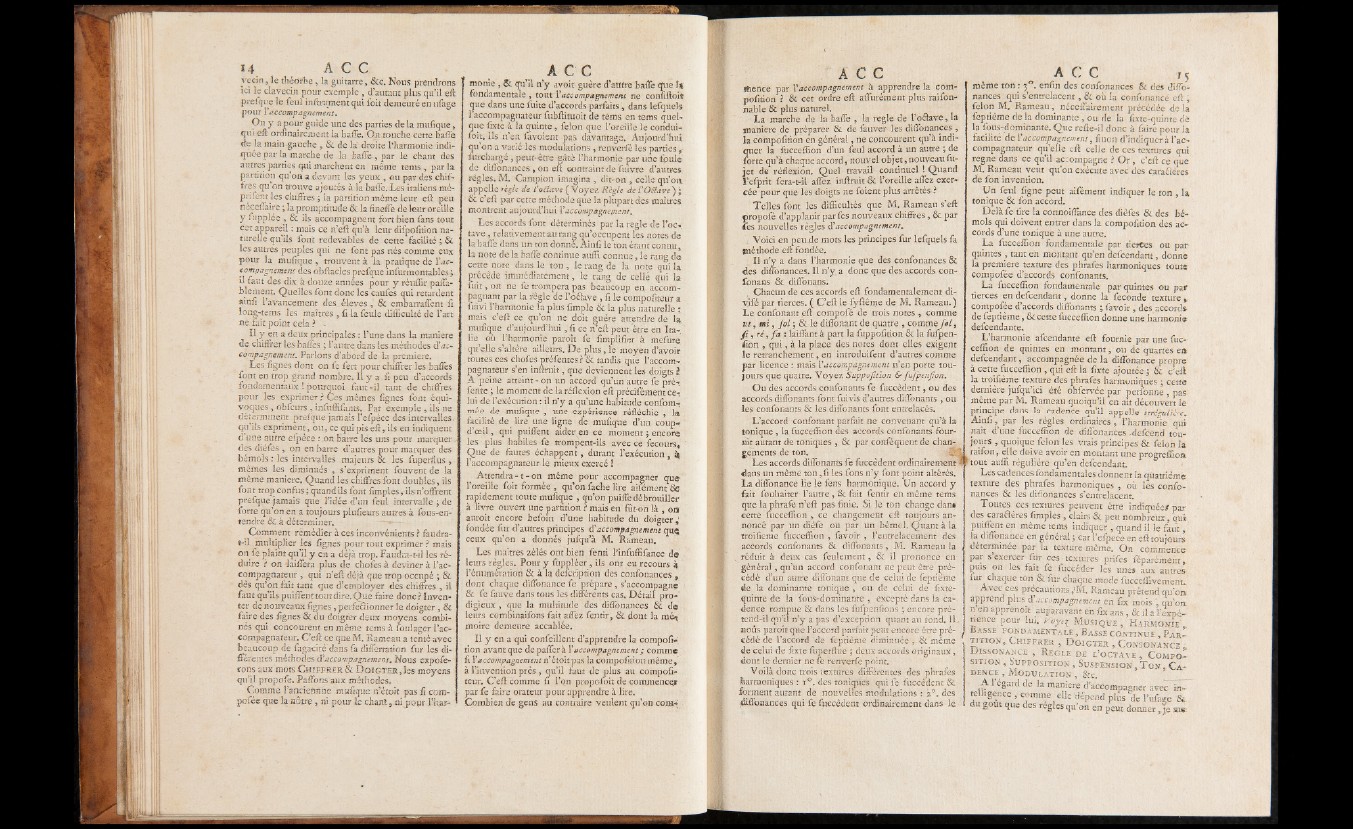
S 4 A C C
vecin, le théorbe, la guitarre, &c. Nous prendrons
ici le clavecin pour exemple , d’autant plus qu’il eft
prefque le feul infiniment qui foit demeuré en ufage
pour Y accompagnement.
On y a pour guide une des parties de la mufique,
qui Cxl ordinairement la baffe. On,touche cette baffe
de la main gauche , & de la' droite l’harmonie indiquée
par la marche de la baffe-, par le chant des
autres parties qui marchent en même tems , par la
partition qu’on a devant les yeux , ou par des chiffres
qu’on trouve ajoutés à la baffe. Les italiens mé-
prifent les chiffres ; la partition même leur efl peu
neceffaire ; la promptitude & la fineffe de leur oreille
y fupplée , & ils accompagnent fort bien fans tour
cet appareil : mais ce n’efl qu’à leur difpoiition naturelle
qu’ils font redevables de cette facilité ; &
les autres peuples qui ne font pas nés comme eux
pour la mufique , trouvent à la pratique de ¥ accompagnement
des obftacles prefque infurmontables ;
il faut des dix à douze années pour y réuffir paffa-
blement. Quelles font donc les caufes qui retardent
ainfi l’avancement des é l e v e s & embarraffent fi
^ong"tems. ^es maîtres , fi la feule difficulté de l’art
nè fait point cela ?
Il y en a deux principales : l’une dans la maniéré
de chiffrer les baffes ; l’autre dans les méthodes d’accompagnement.
Parlons d’abord 5e la première.
Les lignés dont on fe fert pour chiffrer les baffes
font en trop grand nombre. Il y a fi peu d’accords
fondamentaux ! pourquoi faut -il tant de chiffres
pour les exprimer ? Ces mêmes lignes font équivoques
, obfcurs , infuffifants. Par exemple , ils ne
déterminent prefque jamais Fefpèce des intervalles,
qu’ils expriment, ou, ce qui pis eft, ils en indiquent
d’une autre efpèce : on barre les uns pour marquer ,
des dièfes , on en barre d’autres pour marquer des
bémols : les intervalles majeurs & les fuperflus ,
meines les diminués , s’expriment fouvent de la
même maniéré. Quand les chiffres font doubles, ils
font trop confus ; quand ils font fimples, ils n’offrent
prefque jamais que l’idée d’un feul intervalle ; de
forte qu’on en à toujours plufieurs autres à fbus-en-
tendre & à déterminer.
Comment rèmédîer à cos inconvénients ? faudra-
t-il multiplier les lignes pour tout exprimer ? mais
on fe plaint qu’il y en a déjà trop. Faudra-t-il les réduire
? on Jaiffera plus de chofes à deviner à l’accompagnateur
, qui n’eft déjà que trop occupé ; &
dès qu’on fait tant que d’employer des chiffres , il
faut qu’ ils puiffent tout dire. Que faire donc? Inventer
de nouveaux fignes, perfectionner le doigter, &
faire des fignes & du doigter deux moyens combinés
qui concourent en même tems à fouiager l’accompagnateur.
C ’eft ce que M. Rameau a tenté avec
beaucoup de fagacitédans fa differration fur les differentes
méthodes daccompagnement. Nous expofe-
rons aux mots C hiffrer & D oigter , les moyens
qu’il propofe. Paffons aux méthodes.
Comme l’anciennhe manque n’étoit pas fi com- 1
pofée que la nôtre, ni pour le chant, ni pour l’har- ?
A c C
monie , & qu’il n’y avoit guère d’autre baffe que h
fondamentale , tout Y accompagnement ne confiftoit
que dans une fuite d’accords parfaits, dans lefquels
l’accompagnateur fubftituoit de tems en tems quelque
fixte à la quinte, félon que l’oreille le conduis
i t . Ils n’en favoient pas davantage. Aujourd’hui
qu’on a varié les modulations, renverfé les parties
xurchargé , peut- être gâté 1*harmonie par une fpule
de diffonances , on eft contraint de fuivre d’autres
règles. M. Campion imagina , dit-on , celle qu’on,
appelle règle de C octave (V oy e z Règle de VOElave') ;
6c c’eft par cette méthode que la plupart des maîtres
montrent aujourd’hui Y accompagnement.
Les accords font déterminés par la regie de Foc«;
tave., relativement au rang qu’occupent lès notes de
la baffe dans un ton donné. Ainfi le ton étant connu,
la note de la baftè continue auffi connue, le rang do
cette note dans le ton , le rang de la note qui la
précède immédiatement, le rang de celle qui la
fuit, on ne fe trompera pas beaucoup en accompagnant
par la règle de l’oéiave, ft le compofiteur a
fuiyi l’harmonie la plus Ample 8c la plus naturelle |
mais c’eft ce qu’on ne doit guère attendre de la
mufique d’aujourd’h u i, fi ce n’eft peut -être en Italie
où l’harmonie paroît fe fimplifier à mefure
qu’elle s’altère ailleurs. De plus., le moyen d’avoir
toutes ces chofes préfentes ? 8c tandis què l’accompagnateur
s’en inftruit, que deviennent les doigts 1
A "peine atteint - on un accord qu’un autre fe préfente
; le moment de la réflexion eft précifémentce-.
lui de l’exécution : il n’y a qu’une habitude confom-
mée de mufique , une expérience réfléchie | la
facilité de lire une ligne de mufique d’un coup«»
d’oe il, qui puiffent aider en ce moment ; encore
les plus habiles fe trompent-ils avec ce fecours.
Que de fautes échappent, durant l’exéçution, k
l’accompagnateur le mieux exercé !
Attendra-1-on même pour accompagner que
l’oreille fort formée , qu’on fâche lire aifement 8c
rapidement toute mufique , qu’on puiffe débrouiller
à livre ouvert une partition ? mais en fût-on là , on
auroit encore befoin d’une habitude du doigter,’
fondée fur d’autres principes d’accompagnement quq
ceux qu’on a donnés jufqu’à M. Rameau.
Les maîtres zélés ont bien fenti l’infuffifance de
leurs règles. Pour y fuppléer., ils ont eu recours à
l’énumération 8c à la defeription des confonançes ,
dont chaque diffonance fe prépare, s’accompagne
8c fe fauve dans tous les différents cas. Détail prodigieux
, que la multitude des diffonances 8c de
leurs combinaifons fait affez fentir, 8c dont la nié*
moire demeure accablée.
Il y en a qui confeillent d’apprendre la compofi»
tion avant que depafferà \accompagnement ; comme
fi Y accompagnement n’étoit pas la composition même ,
à l’invention près , qu’il faut de plus au compofiteur.
C ’eft comme h l ’on propofoit de commencer
par fe faire orateur pour apprendre à lire.
Combien de gens au contraire veulent qu’on coma
c e
Jhence par F accompagnement à apprendre la com-
pofitiori ? 8c cet ordre eft affurément plus raifon-
nable 8c plus naturel.
La marche de la baffe , la réglé de l’od a v e , la
maniéré de préparer 8c de fauver les diffonances ,
la compofition en général, ne concourent qu’à indiquer
la fucceffion d’un feul accord à un autre ; de
forte qu’à chaque accord, nouvel objet, nouveau fu-
jet de réflexion. Quel travail continuel l Quand
l ’efprit fera-t-il affez inftruit 8c l’oreille affez exercée
pour que les doigts ne foient plus arrêtés ?
Telles font les difficultés que M. Rameau s’eft
propofé d’applanir par fes nouveaux chiffres, 8c par
(fes nouvelles règles d accompagnement.
Voici en peu.de mots les principes fur lefquels fa
méthode eft fondée.
. Il n’y a dans l’harmonie que des confonànces 8c
des diffonances. Il n’y. a donc que des accords con-,
fonans 8c diffonans.
Chacun de ces accords eft fondamentalement di-
yifé par tierces. ( C ’eft le fyftême de M. Rameau.)
Le confonant eft comp ofé de trois notes , comme
u t, mi, fol ; 8c le diffonant de quatre , comme fo l,
f i , ré, fa : laiffant à part la fuppofition 8c la fufpen-
fîon , q u i, à la place des notes dont elles exigent
le retranchement, en introduifent d’autres comme
par licence : mais Y accompagnement n’en porte toujours
que quatre. Voyez Suppofition & fufpenfion.
Ou des accords coiifonants fe fuccèdent, ou des
accords diffonants font fuivis d’autres diffpnants , ou
les confonants 8c les diffonants font entrelacés.
L’accord confonant parfait ne convenant qu’à la
tonique, la fucceffion des accords confonants fournit
autant de toniques , 8c par conféquent de changements
de ton.
Les accords diflonants fe fuccèdent ordinairement
dans un même ton, fi les fons n’y font point altérés.
La diffonance lie le fens harmonique. Un accord y
fait fouhaiter l’autre , 8c fait fentir en même tems
que la phrafe n’eft pas finie. Si le ton change dan#
cette fucceffion , ce changement eft toujours annoncé
par un dièfe ou par un bémol. Quant à la
troifieme fucceffion , favoir , l’entrelacement des
accords confonants 8c diflonants, M. Rameau la
réduit à deux cas feulement, 8c il prononce en
général, qu’un accord confonant ne peut être précédé
d’un autre diflonant que de celui de feptieme
de la dominante tonique , ou de celui de fixte-
quinte de la fous-dominante, excepté dans la cadence
rompue 8c dans les fufpenfions ; encore pré-
tend-il qu’il n’y a pas d’exception quant au fond. 11.
nous paroît que l’accord parfait peut encore être pré- .
cédé de l’accord de feptieme diminuée | 'm ê m e *.
de celui de fixte fuperflue | deux accords, originaux,
dont le dernier ne fe renverfe point.
Voilà donc trois textures différentes des phrafes
harmoniques : i ° . des toniques qui fe. fùccêdent 8c
forment autant de nouvelles modulations : 2°. des
diffonances qui fe fuccèdent ordinairement dans le
a c c i5
même ton : 30. enfin des confonànces & des diffo-
nances qui s’entrelacent, & où la confonancé efl ,
félon M. Rameau, néceffairement précédée de la
feptième de la dominante, ou de la fixte-quinte de
la fous-dominante. Que reûe-il donc à faire pour la
facilité de Vaccompagnement, finon d’indiquer à l’accompagnateur
qu’elle eft celle de ces textures qui
régné dans ce qu’il accompagne ! Or , c’eft ce que
M. Rameau veut qu’on exécute avec des caraâères
de fon invention.
Un feul ligne peut aifément indiquer le ton , la
tonique & fon accord.
Delà fe tire la connoiffance des dièfes & des bémols
qui doivent entrer dans la compofition des accords
d’une tonique à une autre,
La fucceffion fondamentale par tierces ou par
quintes , tant en montant qu’en defeendant, donne
la première texture des phrafes harmoniques toute
compofée d’accords confonants.
La fucceffion fondamentale par quintes ou par
tierces en defeendant, donne la fécondé texture ,
compofée d’accords diffonants ; favoir , des accords
de feptième, & cette fucceffion donne une.harmonie
defeendante.
L’harmonie afeendante eft fournie par une fucceffion
de quintes en montant , ou de quartes en
defeendant, accompagnée de la diffonance propre
à cette fucceffion , qui eft la fixte ajoutée ; & c’eft
la troifieme texture des phrafes harmoniques ; cette
dernière jufqu’ici été obfervée par perfonne , pas
même par M. Rameau quoiqu’il en ait découvert le
principe dans la cadence qu’il appelle irrégulière.
A in fi, par les règles ordinaires, l’harmonie qui
naît d’une fucceffion de diffonances -defeend toujours
, quoique félon les vrais principes & félon la
ra ifo n e lle doive avoir en montant une prpgrefîion
tout auffi régulière qu’en defeendant.
Les cadences fondamentales donnent la quatrième
texture des phrafes harmoniques , ou les confo-
nances & les diffonances s’entrelacent.
Toutes ces textures peuvent être indiquées par
des caiaéieres fimples , clairs & peu nombreux, qui
puiffent en même tems indiquer , quand il le faut,
la diffonance en général ; car l’efpece en eft toujours
déterminée par la texture même. On commence
par s’exercer fur ces textures prifes féparément
puis on les fait fe fuccéder les unes aux autres
fur chaque ton & fur chaque mode fucceflivement.
Avec ces précautions ,'M. Rameau prétend qu’on
apprend plus S accompagnement en fix mois , qu’on,
n en apprenoit auparavant e'n fix ans, & il a l'expérience
pour Im; Voy,[ Mu sique , Harmonie ,,
Basse fondamentale , Basse continue , Pa r t
it io n , C hiffrer , D oig te r , C onsonance c
D issonance , Réglé de l’o c ta v e , C om po_ sm°N , Su p po s ition , Suspension , T on , C a -
b en ce , Mo d u la t ion , &c.
A 1 égard de la maniéré d’accompagner avec intelligence
, comme elle dépend plus de l’ufaee &
du goût que des réglés qu'on en peut donner,je m*