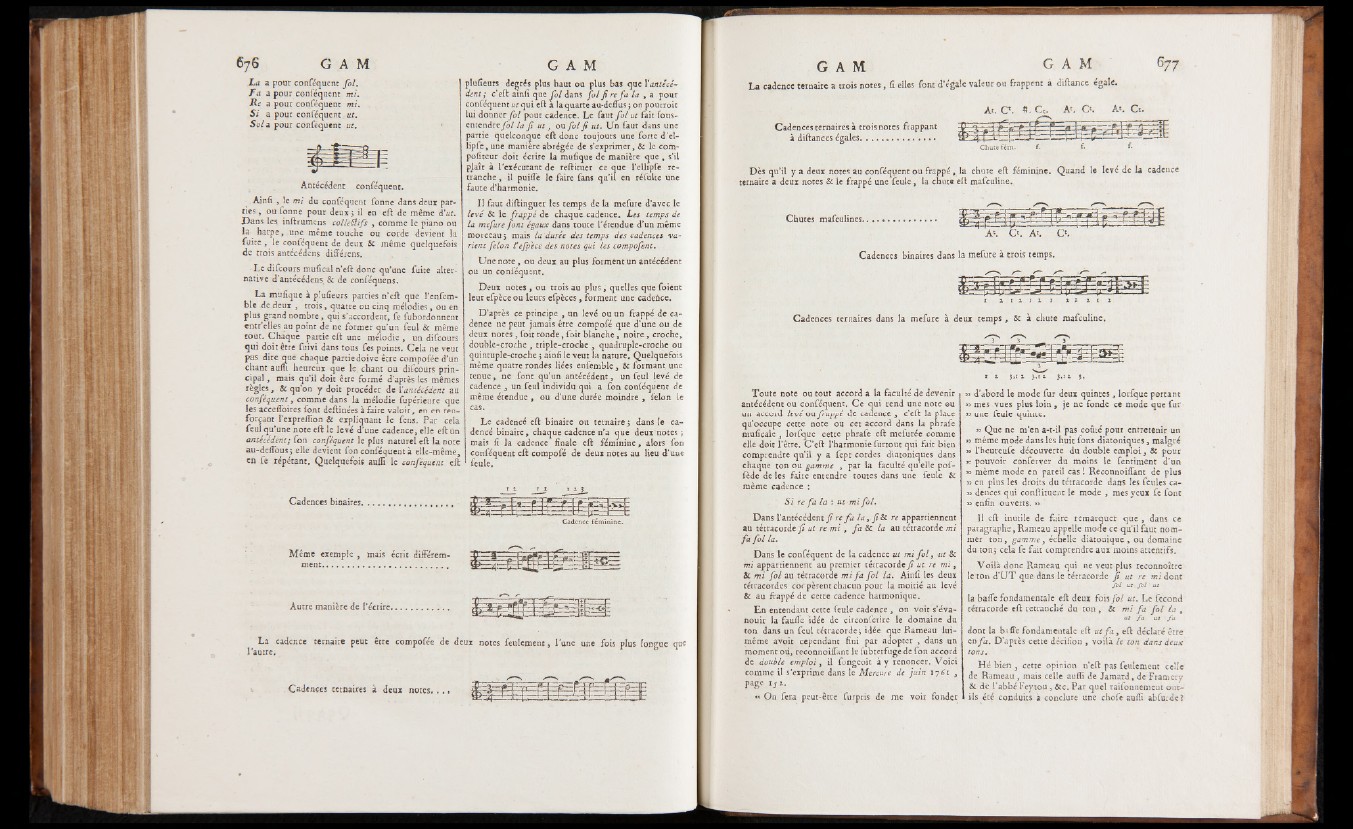
La a pour conféquent fol.
Fa a pour conféquent mi.
Re a pour conféquent mi. ,
S i a pour conféquent ut.
Sola pour conféquent ut.
Antécédent conféquent.
Ainfî , le mi du conféquent fonne dans deux parties
, ou fonne pour deux 5 il en eft de même à'ut.
£)ans les inftrumens colleSlifs , comme le piano ou
la harpe, une même touche ou corde devient la
fuite y le conféquent de deux & même quelquefois
de trois antécédens difFércns.
-Le difeours mufical n’eft donc qu’une fuite alternative
d’antécédens & de conféquens.
La mufîque à pîufîeurs parties n’eft que l’cnfem-
ble de deux , trois, quatre ou cinq mélodies, ou en
plus grand nombre y qui s’accordent, fe fubordonnent
entr’elles au point de ne former qu’un feul & même
tout. Chaque partie eft une mélodie , un difeours
qui doit être fuivi dans tous fes points. Cela ne veut
pas dire que chaque partie doive être compofée d’un
chant aulü heureux que le. chant ou difeours principal
, mais qu’il doit être formé d’après les mêmes
règles , & qu’on y doit procéder de l'antécédent au
conféquent r comme dans la mélodie fupérieure que
les accelîbires font deftinées à faire valoir, en en renforçant
l’cxpreflîon & expliquant le fens. Par cela
feul qu’une note eft le levé d'une cadence, elle eft un
antécédentj fon conféquent le plus naturel eft la note
au-defîbusj elle’ devient fon conféquent à elle-même,
en fe répétant. Quelquefois audi le conféquent eft
Cadences binaires.
Même exemple , mais écrit différemment.
.....................................
Autre manière de l’écrire.
pîufîeurs degrés plus haut ou plus bas que Xantécédent
y c’eft ainfî que fo l dans fo l f i re fa la , a pour
conféquent ut qui eft a la quarte au-defTus j on pourroit
lui donner fol pour cadence. Le faut fo l ut fait fons-
entendr t fo l la f i u t, ou fo l f i ut. Un faut dans une
partie quelconque eft donc toujours une forte d’el-
lipfe, une manière abrégée de s’exprimer, & le composteur
doit écrire la mufîque de manière que , s’il
plaît à l'exécutant de reftiruer ce que l’eUipfe retranche
, il puifîe le faire fans qu’il en réfultc une
faute d’harmonie.
Il faut diftinguer les temps de la mefure d’avec le
levé & le frappé de chaque cadence. Les temps de
la mefure font égaux dans toute l'étendue d’un même
morceau 5 mais la durée des temps des cadences va-
rient félon tefpece des notes qui les compofent.
Une note, ou deux au plus forment un antécédent
ou un conféquent.
Deux notes , ou trois au plus, quelles que foient
leurefpèceou leurs efpèces, forment une cadence.
D’après ce principe , un levé ou un frappé de cadence
ne peut jamais être compofé que d’une ou de
deux notes , foit ronde, foit blanche, noire, croche,
double-croche , triple-croche , quadruple-croche ou
quintuple-croche 5 ainfî le veut la nature. Quelquefois
même quatre rondes liées enfemble , & formant une
tenue, ne font qu’un antécédent, un feul levé de
cadence , un feul individu qui a fon conféquent de
même étendue, ou d’une durée moindre , félon le
cas.
Le cadencé eft binaire ou ternaire j dans le cadencé
binaire, chaque cadence n’a que deux notes ;
mais fi la cadence finale eft féminine, alors fon
conféquent eft compofé de deux notes au lieu d’une
feule.
i i i i t i I
La cadence ternaire peut être compofée de deux notes feulement, l'une une fois plus longue que
l'autre.
Cadences ternaires à deux notes.. . ,
La cadence ternaire a trois notes, fi elles font d’égale valeur ou frappent à diftancc égale.
Cadences ternaires a trois notes frappant
à diftances égales................................
A t . C l . # C t . A 1. O . A t . C t .
Chute fém. £ £ £
Dès qu’il y a deux notes au conféqyentou frappé, la chute eft féminine. Quand le levé de la cadence
ternaire a deux notes & le frappé une feule, la chuté eft mafeuline.
Chutes mafeulines.
A s. C t . A t . O .
Cadences binaires dans la mefure à trois temps.
I £ I £ ,/ iv £ I. £ X £ I £
Cadences ternaires dans la mefure à deux temps, & à chute mafeuline.
Toute note ou tout accord a la faculté de devenir
antécédent ou conféquent. Ce qui rend une note ou
un accord levé ou frappé de cadence , c’eft la place j
qu’occupe cette note ou cet accord dans la pnrafe i
mufîcale, lorfque cette phrafe eft mefurée comme
elle doit l’être. C ’eft l’harmonie furtout qui fait bien
comprendre qu’il y a fept cordes diatoniques dans
chaque ton ou gamme , par la faculté quelle pof-
fède de les faire entendre toutes dans une feule &
même cadence :
Si re fa la : ut mi fol.
Dans l’antécédent f i re fa la , f i & re appartiennent
au tétracorde f i ut re mi » fa & la au tétracorde mi
fa fo l la.
Dans le conféquent de la cadence ut mi f o l , ut &
mi appartiennent au premier tétracorde f i ut re m i,
& mi fol au tétracorde mi fa fo l la. Ainfî les deux
tétracordes coopèrent chacun pour la moitié au levé
& au frappé de cette cadence harmonique.
En entendant cette feule cadence , on voit s’évanouir
la faufîe idée de circonfcrire le domaine du
ton dans un feul tétracorde i idée que Rameau lui-
même avoit cependant fini par adopter , dans un
moment où, reconnoiffant le fubterfugede fon accord
de double emploi, il fongeoit à y renoncer. Voici
comme il s'exprime dans le Mercure de juin 1761 ,
page ij i.
« On fera peut-être furpris de me voir fonder
I £ J ,I 1 3,11 3,1 £ 3,
» d’abord le mode fur deux quintes , lorfque portant
» mes vues plus loin , je ne fonde ce mode que fur
33 une feule quinte.
»» Que ne m’en a-t-il pas coûté pour entretenir un
33 même mode dans les huit fons diatoniques, malgré
3» l’beureufe découverte du double emploi, & pour
k pouvoir conferver du moins le fentiment d’un
» même mode en pareil cas l ReconnoifTant de plus
33 en plus les droits du tétracorde dans les feules ca-
33 dences qui condiment le mode , mes yeux fe fonc
33 enfin ouverts. 33 '
Il eft inutile de faire remarquer que , dans ce
paragraphe, Rameau appelle mode ce qu’il faut nommer
ton, gamme, échelle diatonique, ou domaine
du ton j cela fe fait comprendre aux moins attentifs.
Voilà donc Rameau qui ne veut plus reconnaître
le ton d’U T que dans le tétracorde f i ut re mi donc
fol Ut ; fol ' Ut
la bafTe fondamentale eft deux fois fo l ut. Le fécond
tétracorde eft retranché du ton, & mi fa fo l la ,
ut fa ut fa
dont la bsffe fondamentale eft ut f a , eft déclaré être
en fa . D’après cette décifîon , voilà le ton dans deux
tons..
Hé bien , cette opinion n’eft pas feulement celle
de Rameau, mais celle auffi de Jamard, de Framery
1 & de l’abbé Feytou, &c. Par quel raifonnement onc-
I ils été conduits à conclure une chofe aufîî abfurde?