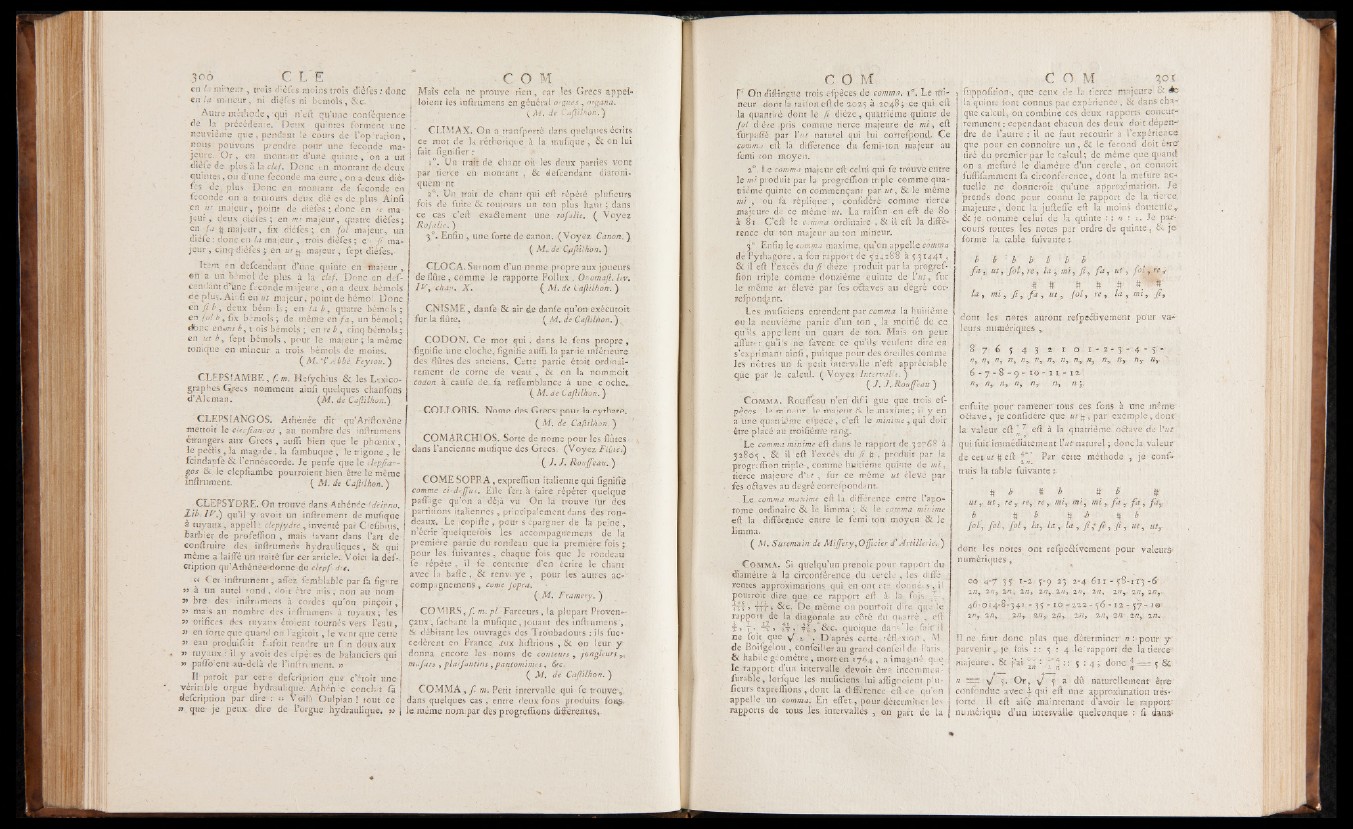
3oô C L E
en la nnaeur , trois-dièfes moins trois die Tes : donc
en la mineur, ni diêfes ni b émo ls, & c .
Autre méthode, qui n’eft qu’une ' conféquence
de la précédente. D eu x quintes forment une
neuvième que , pendant !e cours de l’opéra tion,
nous pouvons prendre pour une fécondé majeure.
O r , en montant d’une quinte , ©n a un
diète de plus à la clef. D on c tn montant de deux
quin te s , ou d une fécondé majeure, o n a -deux'diè-
fe§ dev plus D o n c en montant de fécondé en
fécondé on a toujours deux diè es de plus Ainfi
en ut majeur , point de dièfes ; donc en re majeur
, deux diètes en mi m ajeu r, quatre dièfes;
en fa # majeu r, fix dièfes ; en fol majeur, un.
dièfe : donc en-la majeur , trois, dièfes ; e ' // maje
u r , Cinq-dièfes en. ut # majeur , fept dièfes.•
Item en defcendant d’une, quinte en majeur ,
©n a un bémol de p lus à la clef D on c en defcendant
d’ iine féconde majeure , on a deux bémols
d e plus. Ain fi èn ut majeu r, point de bémol. Donc.
en f i b » deux bémols ; en la. b , quatre bémols ;
en fol b , fix b émo ls; de même en fa-, un bémol ;
A>nc en »/ni b, t-ois bémols ; en re b , cinq bémols ;:
en ut b, fept bémols , pour Te majeur ; la même
tonique en mineur a trois bémols de moins.
(' M. 'l'Abbé Feytou. )
C L EPS ÏAMBE , f m. Hefychius & les L exi cographes
Qr-ecs nomment ainfi quelques chanfons.
d’Alcman. (Àf. de Caflilhon?)
C L E P S IA N G O S . Athénée d i f qn’Ariftoxèhe
mettoit le cleçjîanzos , au nombre des inftrumens
étrangers aux G r e c s , auflî bien que le p boe n ix ,
le p e â is , la magsde , la fambuque , le trigone , le
fcindapfe & l’ennéacorde. Je penfe que le clepfian-
gos & te clepfiambe pourroient bien être le même
Infiniment. ( M. de Caflilhon.)
CLEPSYDRE. On trouvé dans Athénéefdèipno. j
JLïb.lV.) qu’il y. avoit un infiniment de mufique
à tuyaux , appelli clepjydre , inventé par C efibuis,
Barbier de profeffion mais (avant dans l’art dè
confiruire des inftrumens hydrauliques , & qui
même a laiffé un traité fur cet-article;. Voici la déf-.
cription qu’Athénéefdonne- du clepf dre,
et Cet inûrument, affez fembla-ble par fa figure
» a un autel rond, doitêtre mis, non au nom
s» bre des inftrumens à cordés qu’on pinçoit,
35 mais au nombre des irftrumens à tuyaux; les
» orifices des tuyaux étoient tournés vers l’éau ,
« en forte que quand on la g i t o i t , lé vent que cette !
3) eau produifr.it f .ifo ir rendre un f in doux aux
y> tuyaux : i l y avoit des efpèces de balanciers qui
» paflb ent.au-delà de l ’inftriment. »
Il paroîi par cetre defeription que c’étoit une-
véritable orgue hydraulique. Athénée conclut fâ
defeription par dire : « V o ilà 'Oulpian ! tout ce
» que je peux, dire de. l ’orgue hydraulique, » j
- C O M ,
Maïs cela ne prouve rien, car lès Grecs appeï-
loient les inftrumens en général orgues , organa.
A ( AL de Caflilhon.)
I ' CLT MAX.. On a tranfporté dans quelques écrits
j ce mot de la réthorique à la mufique, ,& on lui
fait lignifier r
i°. Un trait de chant ou les deux parties vont
par tierce en montant , & defcendant diatoni-
quem nt
Un trait de chant qui eft répété plufieurs
fois de fuite & toujours un ton plus haut ; dans
ce cas c’eft exactement une rofolie. ( Voyez
Ro faite.)
3°. Enfin , une. forte de canon. (V oy e z Canon, y
( M.. de'. Cpftilhon. )
C LOCA. Surnom d’un nome propre aux joueurs
de flûte , comme le rapporte Pollux , Onomafl, hy.
chay. X . ( Al. de Caflilhon. )
CNTSME, danfe & air de dan(e qu’on exécutoit.
fur la flûte. . (M . de Caflilhon.yv
CO D O N . Ce mot q u id a n s le fens propre,
fignifie une, cloche, fignifie aufïi Ta partie inférieure
des flûtes des anciens. Çette partie étoit ordinairement
de corne de veau', & on la nommoit
codon à.caufe de,, fa reflemblance à une c oche*.
( M. de Caflilhon. )
COLLOBIS. Nome des Grecs- pour la cythare..
( M. de, Caflilhon. )
COMARCHIOS-Sorte dé nome pour les flûtes
dans l’ancienne mufique des Grecs. (Voyez Flûte*)
(, J. J. Rouffeau. y
COME SOPRA, expreflion italienne qui fignifie
comme ci-de-[fus. Elle fer,t à faire ^répéter quelque
pafîage qu’on a déjà vu On la trouve fur des
partitions italiennes , principalement dans dès rondeaux.
Le l'eopifte pour s épargner de là peine,
n’écrit ‘quelquefois les accompagnemens de la
première partie du rondeau que la première fois ;;
pour les fuivantes , chaque fois que. le rondeau
fe répète . il fe contente d’en écrire le chant
avec la baffe , & renv< y e , pour les autres ac-^'
c.omp?.gnemens , corne Jopra. ■
(. M. Framery. )’
CO VH R S , f . tn: pi - Farceurs, la plupart Proven çaux,
fâchant la mufique, jouant des infirnmens .
& débitant les ouvrages des Troubadours : ils fuc*
cédèrent en France àux hiftrions , Sc on leur y.
donna encore les 'noms de conteurs , jongleurs „
mu f ars , plaifantins , pantomimes, &c.
( M. de Càflilhon. )
COMMA , ƒ m. Petit intervalle qui fe trouve-,',
dans quelques cas , entre deux fons produits fou£.
le .m êm e n om .p a r des p ro g r e f lio n s d iffé ren te s ,.
C O M
P On difiingne trois efpèces dé comma. i° . Le mineur
dont la raifonefi de Z025 à 204S; ce qui eft
la quantité dont le f dièzê, quatrième quinte de
fo l d èiQ pris comme tierce majeure de mi, eft
furpaflé par Vue naturel qui lui correfponff. Ce
comma eft là différence du femi-ton majeur au
femi ton moyen.
i°. l e comma majeur eft celui qui fe trouve entre
le mi produit par la progreffion triple comme quatrième
quinte en commençant par «£, & le même
mi , ou fa réplique , cônfidéré comme tierce
majeure de ce même1 m£. La raifon en eft de So
à 81 C ’eft le c.tmrna ordinaire , & i-1 eft la différence
du ton majeur au ton mineur.
30 Enfin le comma maxime, qu’.Cn appel!q.comma
de Pythagore, a fôn rapport de 524.2.88 à 5 31441 ,
& il eft l’excès du f i dièze produit par là progref-
fion triple comme douzième quinte de l'u i, fur
le' même «r élevé par fes oéfaves au degré cor;
refpondant.
Les muficiens entendent par comma la huitième
ou la neuvième partie d’un ton , la moitié de. ee.
qu'ils appellent un quart de ton. Mais on peut
a'flurer qu’ils Ine favent ce qu’ils" veulent dire en
s’exprimant ainfi , puiique pour des oreilles comme j
les nôtres un fi. petit intervalle n’eft appréciable j
qiie par le. calcul. ( Voyez Intervalle. ):
( J. J. RouJfeau y
C omma. Rouffeau n’en d ifi gue que trois e f pèces
, le mlneuf, le majeur & le maxime ; il y en
z - une quatrième efpéce , c’eft le minime , qui .doit-
être placé au troifièm’e rang.
Le comma minime eft dans le rapport de 32768 à
328Ô5 , & il eft l’excès du fi tt , produit par la
progrcflion triple-, comme huitième quinte de mi,
tierce majeure dVt , fur ce même' ut élevé par
fes oéfavçs au degré eorrefpondant.
Le., comma maxime eft la différence entre l’apo-
tome ordinaire le linima ; & le comma minime
eft la différence entre le femi ton moyen & le
limma.
( M. Surema in de Miffery, Officier d'Artillerie. )
C omma. Si quelqu’un prenoit-pour rapport 'du-
diamètre à la circonférence du cercle , les diftè
rentes approximations qui, en ont été données, il
pourroit dire que ce rapport eft à. la fois JÇ ,
fl?» TTT» ^ c : Dexmême' on.pouitoit 'dire qiie le
rapport de la diagonale au côté du quatre , eft
è j T \ tt j t j i f l , &c. quoique dans ’ le fait' il
ne foit que 3/ . D ’après cette réflexion , M
de Boifgelou , confeiber au grand-confeil de Paris,
& habile géomètre , mort en « 764 , a imaginé qi(e
le rapport d’url intervalle devoit être incommen-'
fürable, lorfque les muficiens lui afligroient plu-
fieurs éxpreflions , dont la différence eft ce qu'ori
appelle un comma. En effet, pour déterminer les
rapports de tous l’es, intervallês ori part de la
C O M ^ o r
fuppôfitiôn-', que ceux de Ta tierce' majeure & és-
•:lâ quinte font connus par expérience, & dans chaque
calcul, on combine ces deux rapports concur-
.remment : cependant chacun des deux doit dépendre
de l’autre :' il ne faut recourir à l’expérience
que pour en connoître un , & le fécond doit être'
tiré du premier par le calcul; de mêmeque .quand
on a mefuré le diamètre d’un cercle, on connoît.
■ jfuffifamment fa circonférence, dont la mefure actuelle
. ne donneroit qu’une approximation. Je
prends donc pour connu le rapport de la tierce,
majeure, dont la juftefle eft la moins doutenlé 9-
& je nomme celui de la quinte : : n : 1. Je parcours
toutes les notes par ordre de quinte, & je-'
forme la table fuivante
b b ' b . b b '■ b h
f a % ut y fo l ,r e , ta , mi, fi-, f a , ut', fo h re ?
y " ' #' t ' % # #•
la , mi, f i , f a , u t , fo l , re, la , mi, f i ,
dont tes notes auront refpeêftvemént pour va*
leurs numériques ,
8 7 6 5 4 3 2 r 0 1 - 2 - 3 - 4 - 5; -
n ,.n , n,. 11, n , . n , n,. n , n , rt, n r n y, n,- n v ^
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 1 1 - 12 ;
%. n,. n,. n, n,- n, n\,
enfuite pour ram’ener tous' ces fons à une même-
oéfave, je confidère que ut ^., par exemple, dont
: la valeur, eft" 7 eft à la .quatrième- oâave de Y ut
qui fuit immédiatement-Mut naturel; donc Ja valeur
de cettu # eft Par cette méthode , je confia
truis la table fuivante
# b . # b tf B #
ut,. ut, re r re, re,, m im i , mi fa ,. fa , fa,,
b fj: b ^ J) |j: b
f o l , fo l, f o l , la, la,, la - ,fi ,• f i , f i , ut, ut,
dont les notes ont refpeéKvement pour valeurs-'
numériques,
c® 4-7 3 5- 1-2 5-9 23 2-4 611 - 5’8- i ï '3’ -6
t m, m, 111, 2/2, 2/2,. 2/2, in, 2/2, 2»,- 2/2, 2/7,.
I 46- OI4-8-341 -3 5 - IO 222 - 5 6 - 12 - 57 - 1 &
2n, in,. _2n, s.nr in , m, 2/2, 2/2- 2/2,. 2/2.
II ne faut donc plus que déterminer n :• pour y
parvenir,, je fais : : 5 : 4 .le rapport de la tierce"
majeure, & j-’ai.“ : :: 5 : 4 ; donc 5 &
n r r O r , ^ 5 a dû naturellement- être'
confondue avec ~ qui eft une approximation très-
forte Il eft aifé maintenant d’avoir le rapport'
numérique d’un intervalle quelconque : fi. dans;