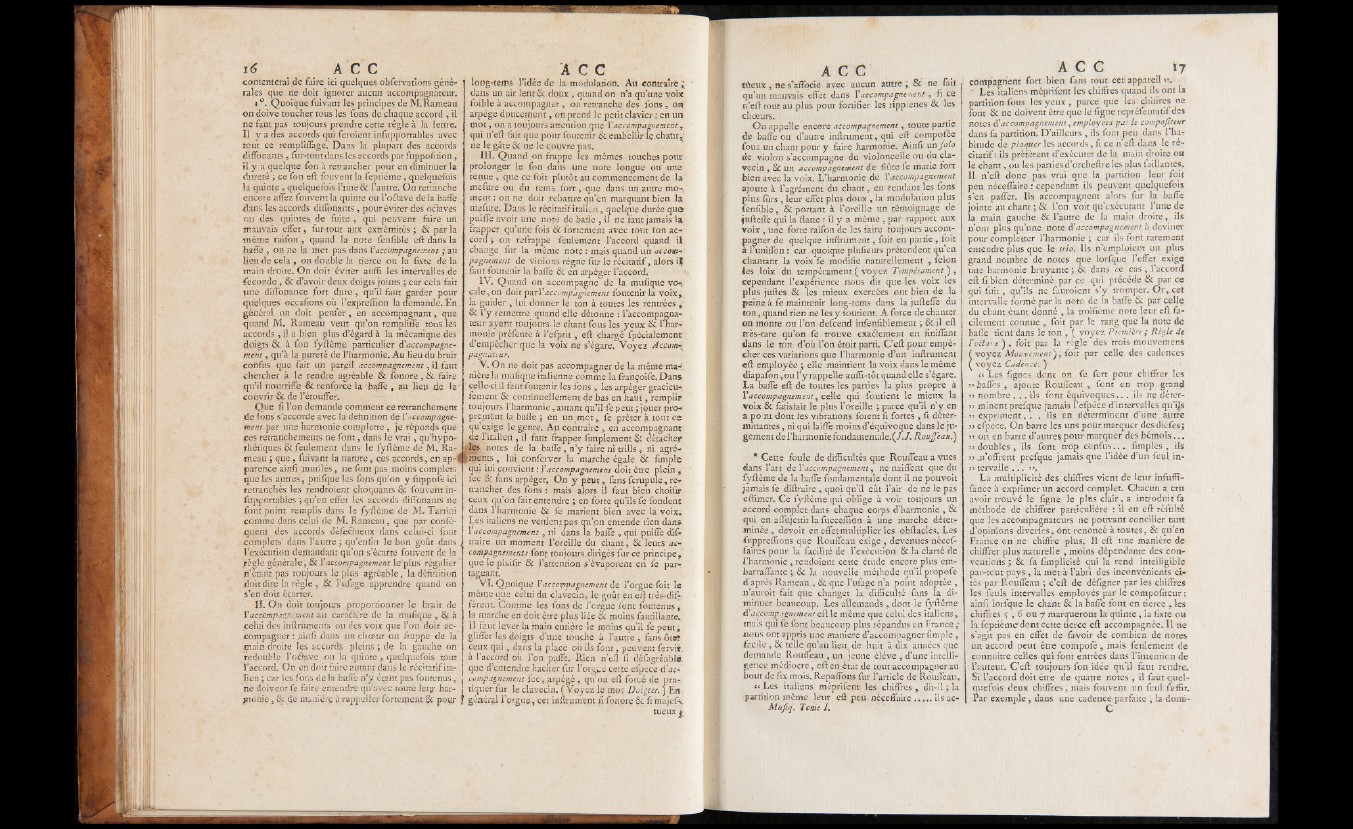
i« A C C
contenterai de faire ici quelques obfervations gériê-*
raies que ne doit ignorer aucun accompagnateur.
i ° . Quoique fuivant les principes de M. Rameau
on doive toucher tous les fons de chaque accord , il
ne faut pas toujours prendre cette règle à la lettre.
Il y a des accords qui feroient infupportables avec
tout ce rempliffage: Dans la plupart des accords
diffonants , fur-tout dans les accords par fuppofition,
il y a quelque fon à retrancher pour en diminuer la
dureté ; ce fon eft fouvent la feptième | quelquefois
la quinte , quelquefois l’une & l’autre. On retranche
encore affez fouvent la quinte ou l’oétave de la baffe
dans les accords diffonants , pour éyiter des oélaves
ou des quintes de fuite , qui peuvent faire un
mauvais effet, fur-tout aux extrémités ; & par la
même raifon, quand la note fenfible eft dans la
baffe , on ne la met pas dans Vaccompagnement ; au
lien de cela , on double la tiercé ou la fixte de la
main droite. On doit éviter aufli les intervalles de
fécondé , 8c d’avoir deux doigts joints ; car cela fait
une diffonance fort dure, qu’il faut garder pour
quelques oçcafions où l’expreftion la demande. En
général on doit penfer, en accompagnant, que
quand M. Rameau veut qu’on rempliffe tous les
accords , $ a bien plus d’égard à la mécanique des
doigts 8ç à fon fyffême particulier $ accompagnement
, qu’à la pureté de l’harmonie. Au lieu du bruit
çoîifus que fait un pareil accompagnement, il faut
chercher à le rendre agréable & fonore , & faire
qu’il nourriffe & renforce la baffe, au lieu 4e la'
couvrir 8c de l’étouffer.
Que fi l’on demande comment ce retranchement
de fons s’accorde avec la définition de Y accompagnement
par une harmonie éomplette, je réponds que
,ces retranchements ne fon t, dans le vrai, qu’hypo-
thétiques §c feulement dans le fyffême de M. Rax
meau ; que , fuivant la nature, ç.es accords, en ap-^
parence ainfi mutilés 9 ne font pas moins complets
que les autres, puifque les fons qu’on y fuppofe ici
retranchés les rendroient choquants fouvent infupportables
; qu’en effet les accords diffonants ne
font point remplis dans le fyffême de M. Tartini
comine dans celui de M. Rameau, que par .corifé-
quent des accords défectueux dans celui-ci font
complets dans l’autre ; qu’enfin le bon goût dans
l’exécution demandant qu’on s’écarte fouvent de la
jrèglé générale , & Y accompagnement \e plus régulier
n’etant pas toujours le plus agréable, la définition
doit dire la règle , ,& l’ufage apprendre quand on
s’en doit écarter.
II. On doit toujours proportionner le bruit de
Y accompagnement au caractère de la mufique , 8c à
celui des inffniments on des voix que l’on doit accompagner
: ainff dans choeur on frappe de la
$nain droite les accords pleins ; de la gauche on
redouble f oéiave ou la quinte , quelquefois tout
î’accord. On en doit faire autant dans le récitatif italien
; car les fons delà baffe n’y étant pas foutenus,
ne doivent fe faire entendre qu’avec toute leur harmonie
? 8ç de manière à rappeller fortement §c pour
A C C
long-tems l’idée de la modulation. Au contraire ;
dans un air lent de doux , quand on n’a qu’une voix
foible à accompagner, on retranche des fons , o»
arpège doucement, on prend le petit clavier ; en un
mot, on a toujours attention que Y accompagnement,
qui ri’eft fait que pour foutenir 8c embellir le chant ^
ne le gâte & ne le couvre pas.
- III. Quand on frappe les mêmes touches pour
prolonger le fon dans une note longue ou une
tenue , que ce foit plutôt au commencement de la
mefure ou du tems for t, que dans un autre mo-.
mçnt : on ne doit .rebattre qu’en marquant bien la
mefure. Dans le récitatif italien, quelque durée que*
puiffe avoir une note de baffe , il ne faut jamais la.
frapper qu’une fois 8c fortement avec tout Ion accord
; on refrappe feulement l’accord quand il
change fur la même note : mais quand un atcom-*.
pagnement de Violons règne fur le récitatif, alors i$
faut foutenir la bafiè & en arpéger l’açcord.
IV. Quand on accompagne de la mufique vo^
cale, on doit par Y accompagnement foutenir la voix,'
la guider , lui donner le ton à toutes les rentrées ;
& T’y remettre quand elle détonne : l’accompagna-*,
teur ayant toujours le chant fous les yeux & l’har»
monie préfente à l’efprit, eft chargé fpécialement
d’empêcher que la voix ne s’égare. Voyez Acçom^
pagnateur.
' V On ne doit pas accompagner de la même ma-!
niere la mufique italienne comme la françoife. Dans,
celle-ci il faut foutenir les fons , les arpéger gracieu-.
fement & continuellement de bas en haut, remplir
toujours T harmonie, autant qu’il fe peut; jouer proprement
labaffe ; en un mot, fe prêter à tout ce.
qu’exige Je genre. Aji contraire , en accompagnant
de. l’italien , il faut frapper fimplement & détacher
lejs notes de la baffe , n’y faire ni trills , nj agré-
Mnents , lui conferver la marche égale & fimple
qui lui convient : Yaccompagnement doit être plein ,
fec & fans arpéger. On y peut, fans fcrupule, re-r
trancher des fons : mais alors il faut bien choifir
ceux qu’on fait entendre ; en forte qu’ils fe fondent
dans l’harmonie de fe marient bien avec la voix;.
Les italiens ne veulent pas qu’pn entende rien dans
Y accompagnement, ni dans la b^ffe , qui puiffe dif-r
traire un moment l’oreille du chant, 8c leurs accompagnements
fonf toujo.urs^dirigés fur ce principe,
que le plaifir 8ç l’attention s’évaporent en fe par-;
tageant.
VT. Quoique Y accompagnement de l’orgue foit le
même que. celui du clavecin, le goût en eft très-différent.
Comme les fons de l’orgue font foutenus ,
la marchç en doit être plus liée & moins fautillante.
11 faut lever la main entière le moins qu’il fe peut;
gliffer les doigts d’une touche à l’autre fans ôte?
ceux qui, dans la place où ils font, peuvent fervit.
à l’accord où l’on paffe. Rien n’eft fi défagréable.
que d’entendre hacher fur l ’org*é cette efpècedW-
iompagnement fec , arpégé , qu'on eft forcé de pratiquer
fur le clavecin. (V o y e z le mot Doigter. ) En
général l’orgue, cet infiniment fi fonore & fi majeft.
tueux i.
a c c
tûeu x , ne s’ affocie avec aucun autres & ne fait
qu’un mauvais effet dans Y accompagnement 9 fi ce
n’eft tout au plus pour fortifier les rippienes & les
choeurs. ' .
On appelle encore accompagnement, toute partie
de baffe ou d’autre inftrument, qui eft compofée
fous un chant pour y faire harmonie. Ainff un folo
de violon s’accompagne du violoncelle ou du clavecin
, 8c un accompagnement de flûte le marie fort
bien avec la voix. L’harmonie de Y accompagnement
ajoute à l’agrément du chant, en rendant les fons
plus fûrs , leur effet plus doux , la modulation plus
ienfible, & portant à l’oreille un témoignage de
fufteffe qui la flatte : il y a même , par rapport aux
voix , une forte raifon de les faire toujours accompagner
de quelque inftrument, foit en partie, foit
à 1 uniffon : car quoique plufieurs prétendent qu’en
chantant la voix fe modifie naturellement , félon
les loix du tempérament ( voyez Tempérament ) ,
cependant l’expérience nous dit que les voix les
plus juftes les mieux exercées ont bien de la
peine à fe maintenir long-tems dans la jufteffe du
ton, quand rien ne les y loutient. A force de chanter
on monte ou l’on defeend infenfiblement ; & il eft
très-rare qu’on fe trouve exactement en finiffant
dans le ton d’où l’on étoit parti. C ’eft pour empêcher
ces variations que l’harmônie d’un inftrument
«fl: employée ; elle maintient la voix dans le même
diapafon ,ou l’y rappelle aufff-tôt quand elle s’égare.
La baffe efl de toutes les parties la plus propre à i
l ’accompagnement, celle qui foutient le mieux la
voix .& fatisfait le plus l’oreille ; parce qu’il n’y en
a po:nt dont les vibrations foient fl fortes , fl déterminantes
, ni qui laiffe moins d’équivoque dans le jugement
de l’harmonie fondamentale.(/./. RouJJ'eau.')
* Cette foule de difficultés que. Rouffeau a vues
dans l’art de Y accompagnement, ne naiffent que du
fyftême de la baffe fondamentale dont il ne pouvoit
jamais fe diflraire , quoi qu’il eût l’air de ne le pas
effimer. Ce fyftême qui oblige à voir toujours un
accord complet dans chaque corps d’harmonie , &
qui en affujettit la fucceffion à une marche déterminée
, devoit en effet multiplier les obflacles. Les
fuppreflions que Rouffeau exige , devenues nécef-
faires pour la facilité de l’exécution & la clarté de
l’harmonie , rendoient cette étude encore plus em>-
barraffante ; & la nouvelle méthode qu’il propofe
d’après Rameau , & que l’ufage n’a point adoptée ,
n’auroit fait que changer la difficulté fans la diminuer
beaucoup. Les allemands , dont le fyftême
& accompagnement efl le même que celui des italiens,
mais qui fe font beaucoup plus répandus en France
nous ont appris une maniéré d’accompagner fimple,
■ facile , ôc telle qu’au lieu. de huit à dix années que
demande Rouffeau , un jeune élève , d’une intelligence
médiocre, eft en état de tout accompagner au
bout de fix mois. Repaffons fur l’article de Rouffeau,
a Les italiens méprifent les chiffres , dit-il ; la
partitipn même leur eft peu néceffaire.......ils ae-
Mujiq. Tome 1,
A c c 17
compagnent fort bien fans tout cet appareil ».
Les italiens méprifent les chiffres quand ils ont la
partition fous les yeux , parce que îes^ chiffres ne
font & ne doivent être que le flgne repréfentatif des
notes d'accompagnement, employées par le cornpofiteur
dans fa partition. D ’ailleurs , ils font peu dans l’ha?
bitude de plaquer les accords, fl ce n’eft dans le récitatif
: ils préfèrent d’exécuter de la main droite ou
le chant, ou les parties d’orcheftre les plus faiilantes.
Il n’eft donc pas vrai que la partition leur foit
peu néceffaire : cependant ils peuvent quelquefois
s’en paffer. Ils accompagnent alors fur la baffe
jointe au chant ; & l ’on voit qu’exécutant l’une de
la main gauche & l’autre de la main droite, ils
n’onî plus qu’une note d'accompagnement à deviner
pour completter l’harmonie ; car ils font rarement
entendre plus que le trio. Ils n’emploient un plus
grand nombre de notes que lorfque l’effet exige
une harmonie bruyante ; de dans ce cas , l’accord
eft fi bien déterminé par çe qui précède & par ce
qui fu it, qu’ils ne fauroient s’y tromper. O r , cet
intervalle formé par la note de la baffe de par celle
du chant étant donné , la troifième note leur eft facilement
connue , foit par le rang que la note de
baffe tient dans le ton , ( voyez Première ; Règle de
l'oftace) , foit par la règle des trois mouvemens
voyez Mouvement)9 foit par celle des cadences
voyez Cadence. )
ci L fs lignes dont on fe fert pour chiffrer les
»'baffes , ajoute Rouffeau , font en trop grand
» nombre . . . ils font équivoques. . . ils ne déter-
53 minent prefque jamais l’efpèce d’intervalles qu’jjs
.53 expriment-,, . ils en déterminent d’une. autre
33 efpëce. On barre les uns pour marquer desdièfes;
53 on en barre d’autres pour marquer des bémols. . ,
53 doubles, ils font trop con fu s ... Amples, ils
s? m’offrent prefque jamais que l’idée d’un feul in-
33 tervalle . . . 31,
La multiplicité des chiffres vient de leur infuffi-
fance à exprimer un accord complet Chacun a cru
avoir trouvé le ligne le pins clair, a introduit fa
méthode de chiffrer particulière : il en eft réfulté
que les accompagnateurs ne pouvant concilier tant
d’opinions diverles, ont renoncé à tontes, & qu’en
France on ne chiffre plus. Il eft une manière de
chiffrer plus naturelle , moins dépendante des conventions
; & fa limplicité qui la rend intelligible
par-tcut pays , la met à l’abri des inconvénients cités
par Rouffeau ; c’eft de défigner par les chiffres
les feuls intervalles employés par le cornpofiteur :
ainfi lorfque le chant & la baffe font en tierce , les
chiffres 5 , 6 ou 7 marqueront la quinte, la fixte ou
la feptième dont cette tierce eft accompagnée. Il ne
s’agit pas en effet de fa voir de combien de notes
un accord peut être compofé, mais feulement de
connoître celles qui font entrées dans l’ intenticn de
l’auteur. C ’eft toujours fon idée qu’il faut rendre.
Si l’accord doit être de quatre notes , il faut quelquefois
deux chiffres, mais fouvent un feul îyffit.
Par exemple, dans une cadence parfaite , la dorai