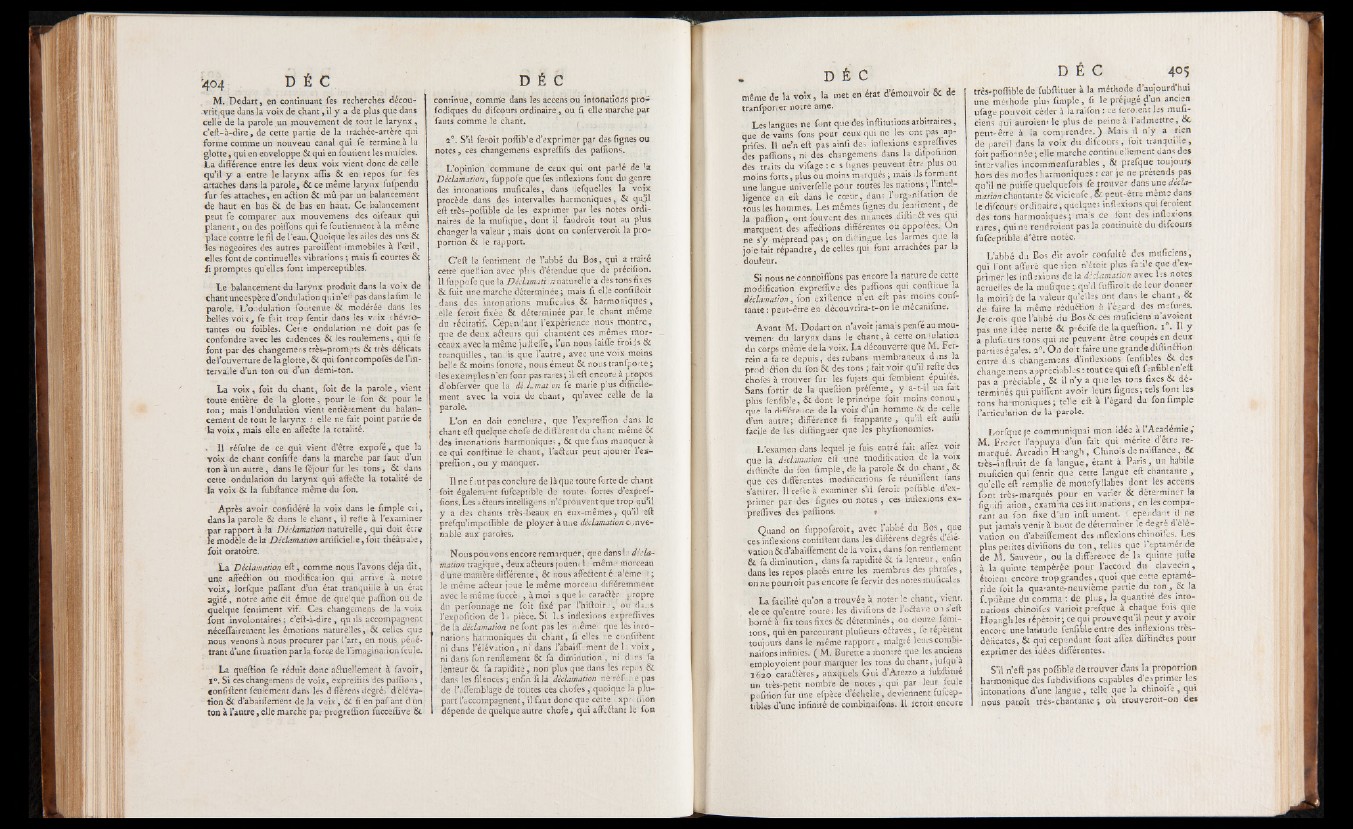
M. Dedart, en continuant fes recherches décou- 1
vrit.que dans la voix de chant, il y a de plus que dans
celle de la parole un mouvement de tout le larynx,
c’eft-à-dire, de cette partie de la trachée-artère qui
forme comme un nouveau canal, qui fe termine à la
glotte, qui en enveloppe & qui en foutient les mufcles.
JLa différence entre les' deux voix vient donc de celle
qu’il y a entre le larynx affis & en repos fur fes
attaches dans la parole, & ce même larynx fulpendu
fur fes attaches, en aélion & mû par un balancement
de haut en bas & de bas en haut. Ge balancement
peut fe comparer aux mouvemens des oifeaux qui
planent, ou des poiffons qui fe foutiennent à la même
place contre le fil de l ’eau. Quoique les ailes des uns &
les nageoires des autres paroiffen: immobiles à l’oe il,
elles font de continuelles vibrations ; mais fi courtes &
fi promptes quelles font imperceptibles.
Le balancement du larynx produit dans la vo;x de
chant une espèce d’ondulation qui n’e^ pas dans lafim le
parole. L ’ondulation foutenue & modérée dans les
telles v oix , fe fait trop fentir dans les v<;ix chévro-
tantes ou foibles. Cette ondulation ne doit pas fe
confondre avec les cadences & les routemens, qui fe
font par des changemens très-prompts & très délicats
de l’ouverture de la glotte, & qui font compofés de l’in-
tervalle d’un ton ou d’un demi-ton.
La voix , foit du chant, foit de la parole, vient
toute entière de la glotte, pour le fon & pour le
ton ; mais l’ondulation vient entièrement du balancement
de tout le larynx : elle ne fait point partie de
la voix, mais elle en affefle la totalité.
. 11 réfulte de ce qui vient d’être expofé, que la
voix de chant confifte dans la marche par faut d’un
ton à un autre, dans le féjour fur les tons, & dans
cette ondulation du larynx qui àffeéle la totalité de
la voix & la fubftance même du fon.
Après avoir confidéré la voix dans le {impie cri,
dans la parole & dans le chant, il refie à l’examiner
par rapport à la Déclamation naturelle, qui doit être
le modèle de la Déclamation artificielle, foit théâtral-e,
foit oratoire.
La Déclamation eff, comme nous l’avons déjà dit,
une aft'eétion ou modification qui arrive à notre
voix, lorfque paffant d’un état tranquille à un état
agité, notre ame eff émue de quelque paflion ou.de
quelque fentimeitt vif. Ces changemens de la voix
font involontaires ; c’eft-à-dire , qu ils accompagnent
néceflairement les émotions naturelles, & celles que
nous venons à nous procurer par l’art, en nous pénétrant
d’une fituation parla force de l’imagination feule.
La quéftion fe réduit donc a&üeltement à favoir,
1°. Si ces changemens de voix, exp refit fs des pallions,
confiftent feulement, dans les d fférens degrés ’ d élévation
& d’abaiffement de la voix, &. fi en paffant d un
ton à l’autre, elle marche par progrefiion mcceflàve &.
continue, comme dans les accens ou intonations pro-
fodiques du difcours ordinaire., ou fi elle marche par
fauts comme le chant.
a°. S’il feroit poflib’e d’exprimer par des fignes ou
notes, ces changemens expreflifs des pafiions.
L’opinion commune de ceux qui ont parlé de
Déclamation, fuppofe que fes inflexions font du genre
des intonations muficales, dans iefqueîles la voix
procède dans des intervalles harmoniques,^ & qi$l
eft très-poflible de les exprimer par les notes ordinaires
de la mufique, dont il faudrait tout au plus
changer la valeur ; mais dont on conferveroit la proportion
& le rapport.
C ’eft le fentiment de l’abbé du Bos, qui a traité
cette quefiion avec plus d’étendue que de précifion.
11 fuppofe que la Déclamaticn naturelle a des tons fixes
& fuit une marche déterminée; mais fi elle confiftoit
dans des intonations muficales & harmoniques ,
elle feroit fixée & déterminée par le chant meme
du récitatif. Cependant l’expérience nous montre,
que de deux afteurs qui chantent ces mêmes mor- _
cèaux avec la même jufleffe, l’un nous Iaiffe froids &
tranquilles, tan.-is.que l’autre, avec une voix moins
belle & moins fonore, nous émeut & nous tranfporte ;
les exemples n’en fonr pas rares ; il eft encore à propos
d’obferver que la déJcmat.on fe marie plus difficilement
avec la voix de chant, qu’avec celle de la
parole.
L’on en doit conclure, que l’expreflion dans le
chant eft quelque chofe de différent du chant même 6C
des intonations harmoniques, & que fans manquer a
ce qui conliitue le chant, l’a&eur peut ajouter l’ex-
' preffion, ou y manquer.
Il ne f ;ut pas conclure de là que toute forte de chant
foit également fufceptible de toute, fortes d’expref-
fions. Les a&eurs intelligens n’éprouvent que trop quai
y a des chants très-beaux en eux-mêmes, qu’il eft
prefqu’impoflible de ployet à Une déclamation convenable
aux paroles.
Nouspôuvons encore remarquer, que dans \: déclamation
tragique, deux a&éurs jouent 1. même morceau
d’une manière différente, & nous affeélent é la’éme
le meme afteur joue le même morceau .différemment
avec le même fiuccè: , à moi s que le caraftèr propre
du perfonnage ne foit fixé par l’hiftoir.-,' ou"da;;s
! l’expofition de la pièce. Si Ls inflexions exprefîives
de la déclamation ne font pas les même- que lès into-
nations harmoniques du chant, fi elles :.e confiftent
ni dans l’élévation, ni dans l’àbaiff. mënt de 1 a voix ,
ni dans fon renflement & fa diminution , ni d ns fa
lenteur & fa rapidité, non plus que dans les repos &
dans les filences; enfin fi la déclamation ne réfil e pas
de l’aflembiagë de toutes ces chofes, quoique la plupart
l’accompagnent, il faut donc que cette i xpr. lfion
dépende de quelque autre chofe , qui affcftanr lé fon
même de la voix, la met en état d’émouvoir & de
tranfponer notre ame.
Les langues ne font que des inftitutions arbitraires,
que de vains fons pour ceux qui ne les ont pas ap-
prifes. Il ne’n eft pas ainfi des inflexions expreffiyes
des pallions, ni des changemens dans h difpofiuon
des traits du vifage : e s lignes peuventetre plus ou
moins forts, plus ou moins marqués ; mais ils forment
une langue univerfelle pour toutes les nations ; 1 intelligence
en eft dans le coeur, dans l’orgr.mfation de
tous les hommes. Les mêmes fignes du fennment, de
la paflion, ont fouvent des nuances diftin& yes qui
marquent des affections différentes ou oppofees. On
ne s’y méprend pas; on di flingue les larmes que la
joie fait répandre, de celles qui' font arrachées par la
douleur.
Si nous ne connoiffons pas encore la nature de cette
modification expreifive des pafiions qui conftitue la
déclamation, fon exiffence n en eft pas-moins conf-
tante : peut-être en découvrira-t-on le mecanifme.
Avant M. Dodart on n’avoit jamais penfé au mou-
vemen: du larynx dans le chant, à cette on iulation
du corps même de la voix. La découverte que M. Fer-
rein a fa te depuis, des rubans membraneux d ms la
production du fon & des tons ; fait voir qu’il reftedes
chofes à trouver fur les fujets qui femblent épuilés.
Sans fortir de la quefiion préfente, y a-t-il un fart
plus fenfible, & dont le principe foit moins connu,
que la différence de la voix d un homme de celle
d’un autre ; différence fi frappante , qu’il eft aufîi
facile de les diftinguer que les phyfionomies.
L ’examen dans lequel je fuis entre fait affez voir
que la. déclamation eff mne modification de la voix
difiinCte du fon fimple, de la parole & du chant , &
que ces différentes modifications fe réunifient fans
s’attirer. 11 refie à examiner s’il feroit pofiible d’exprimer
par des figues ou notes, ces inflexions ex-
preflives des pafiions. t
Quand on fuppoferoit, avec l’abbé du Bos., ^que
ces inflexions confiftent dans les différens degrés d’élévation
& d’abaiffement de la voix, dans fon renflement
& fa diminution, dans fa rapidité &. fa lenteur, enfin
dans les repos placés entre les membres des phrafes,
on ne pourrait pas encore fe feryi.r des notes muficales
La facilité qu’on a trouvée à noter le chant, vient,
de ce qu’entre route.; les divifions de 1 oftave 01 s eft
borné à fix tons fixes & déterminés, ou douze^ femi-
tons, qui en parcourant plusieurs oCîaves, fe repetent
toujours dans le même rapport, maigre leurs combi-
naifons infinies. ( M. Burette a montré que les anciens
employoient pour marquer les tons du chant, jufqu a
j 620 caraCtères, auxquels Gui d’Arezzo a fubftitue
un très-petit nombre de notes , qui par leur feule
pofition fur une efpèce d’échelie, deviennent fufeep-
tibles d’une infinité de combinaifons. Il lcroit encore
tfès-poflible de fubftituer à la méthode d’aujourd’hui
une méthode plus fimple, fi le préjugé d un ancien
ufage pouvoit céder à laraifon : ce fero;er.t les mufi-
ciens qui auraient le plus de peine à l admettre, oc
peut-être à la comprendre.) Mais il n’y a rien
de pareil dans la voix du difcours, foit tranquille,
foit paflior.née; elle marche continuellement dans des
intervalles incommenfurâbles , & prefque toujours
hors des modes harmoniques : car je ne prétends pas
qu’il ne puiffe quelquefois fe trouver dans une déclamation
chantante & vicieufe, o1 peut-être même dans
le difcours ordinaire, quelques inflexions qui feraient
des tons harmoniques; mais ce font des inflexions
rares, qui ne rendraient pas la continuité du difcours
fufceptible d’être notée.
L’abbé du Bos dit avoir confulté des muficens,
qui l’ont affuré que rien n’étoit plus facile que d exprimer
les inflexions de la déclamation avec les notes
actuelles de la mufique ;. qu’il fuffiroit de leur donner
la moitié de la valeur qu’elles ont dans le chant, &
de faire la même réduction à l’égard des me fur es.
Je crois que l’abbé du Bos & ces muficiens n’avoient
pas une idée nette & précife de la quéftion. 1 . Il y
a plufieurs tons qui ne peuvent être coupés en deux
parties éga’es. 20. On doit faire une grande difiinCtion
entre d.s changemens d inflexions fenfibies & des
changemens appréciables : tout ce qui eft fenfible n eft
pas a .préciable, & il n’y a que les tons fixes & déterminés
qui puiffent avoir leurs fignes ; tels font les
tons harmoniques; telle eft a l’égard du fon fimple
l’articulation de la parole.
Lorfque je communiquai mon idée à l’Académie,
M. Freret l’apjDuya d’un fait qui mérite detre remarqué.
Arcadio Hoangh , Chinois de naiffance, ÔC
très-inftruit de fa langue, étant à Paris, un habile
muficien qui fenrit que cette langue eft chantante ,
qu’elle eft remplie de monofyllabes dont les accens
font très-marqués pour en varier & déterminer la
fignifi arion, examina ces intonations, en les comparant
au fon fixe d’un inft ument. C ependant U ne
put jamais venir à bout de déterminer le degré d’élévation
ou d’abaiffement des inflexions chinoifes. Les
plus peûtes divifions du ton, telles que l ep ta mer; de
de M! Sauveur, ou la différence de la quinte jufte
à la quinte tempérée pour l’accovd du clavecin,
étoient encore trop grandes, quoi que cette eptame-
fide foit la qua-ante-neuvième partie du ton , & la
Lptième du comma : de plus, la quantité des^ intonations
chinoifes varioit prefque a chaque fois que
Hoangh les répétoit; ce qui prouve qu’il peut y avoir
encore une latitude fenfible entre des inflexions tres-
déiicates, & qui cependant font affez diftin&es pour
exprimer des idées différentes.
S’il n’eft pas poffible de trouver dans la proportion
harmonique des fubdivifions capables d exprimer les
intonations d’une langue, telle que la chinoife, qui
nous paraît très-chantante ; oh trouyeroft^on